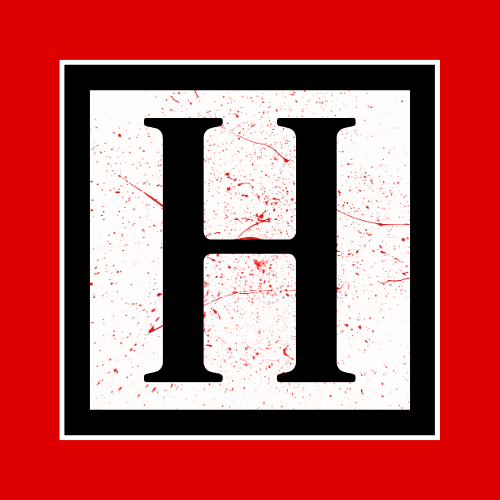Mein Kampf Tome 2

Mein Kampf Tome 2
Je vous présente « Mein Kampf Tome 2 », une œuvre historique d’une grande importance, désormais accessible sur HistoireDu3Reich. Avant de plonger dans cette lecture, je tiens à vous rappeler que mon site ne fait en aucun cas l’apologie des crimes ou des idéologies associées à cette période de l’histoire. Mon objectif est de fournir un accès à des documents historiques afin de promouvoir la compréhension.
Compréhension du contexte
Après la défaite de l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le pays a été plongé dans une crise économique et politique. L’inflation galopante, le mécontentement populaire et la fragilité du gouvernement de Weimar ont créé un climat propice à l’émergence de mouvements radicaux, dont le NSDAP.
Le putsch de Munic, également connu sous le nom de putsch de la Brasserie, est un coup d’État manqué survenu le 8 novembre 1923 à Munic, en Bavière, en Allemagne. Il a été mené par Adolf Hitler et le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), dans le but de renverser le gouvernement de la République de Weimar.
« Mein Kampf tome 1 », est l’œuvre emblématique d’Adolf Hitler, écrite entre 1924 et 1925 alors qu’il était emprisonné dans la forteresse de Landsberg-am-Lech, à la suite du putsch manqué de la Brasserie en 1923. Ce premier tome, plonge le lecteur dans l’univers idéologique du futur dictateur allemand et expose les fondements de sa vision politique.
Dans ce livre, Hitler expose son parcours personnel, de sa jeunesse à Linz à son engagement dans l’armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Il partage ses réflexions sur la politique, la race, le nationalisme et l’antisémitisme, posant les bases de ce qui deviendra plus tard l’idéologie nazie.
Le titre même de l’ouvrage, Mein Kampf, traduit littéralement par « Mon Combat », annonce la nature combative et idéologique de l’œuvre. Hitler y exprime sa volonté de lutte pour une Allemagne qu’il imagine purifiée et débarrassée de ce qu’il considère comme les éléments destructeurs de la société.
À travers les pages de « Mein Kampf tome 1 », se dessine la figure d’un leader charismatique et autoritaire, convaincu de sa mission de redressement national. Il expose sa vision d’un État fort et centralisé, dirigé par un leader incontesté, et prône une politique expansionniste visant à assurer la domination de l’Allemagne sur l’Europe.
Ce premier tome offre également un éclairage sur les circonstances de sa rédaction. Écrit en prison, Mein Kampf est à la fois le fruit de la frustration et de la colère de Hitler face à l’échec de sa tentative de coup d’État et de ses aspirations politiques. C’est dans ce contexte particulier que naissent les idées qui façonneront le futur du régime nazi.
La lecture de « Mein Kampf tome 2 », est donc bien plus qu’un simple exercice historique. C’est une plongée dans mon esprit, dont les idées ont marqué tragiquement l’histoire du XXe siècle. En le présentant sur notre site, je souhaite offrir aux lecteurs un accès à une œuvre majeure tout en les invitant à réfléchir aux leçons que l’on peut en tirer pour l’avenir.
Avertissement
Refus de propager la haine ou l’hostilité :
Je rejette fermement toute forme de propagation de la haine ou de l’hostilité. Je crois en la promotion de la compréhension et de la tolérance.
Mise à disposition du public français :
Mon objectif est simplement de rendre accessible au public français un document dont je crois qu’il est important qu’il le possède. Je souhaite offrir une source d’information afin que chacun puisse se forger sa propre opinion en ayant accès aux faits.
Conservation de l’authenticité du texte :
Pour garantir l’authenticité du document, je n’ai effectué aucune modification au texte original. Je pense qu’il est essentiel de préserver l’intégrité de l’œuvre pour permettre une compréhension fidèle de son contenu.
Inclusion de passages moins pertinents :
Bien que certains passages puissent sembler moins pertinents pour les lecteurs français, j’ai choisi de les conserver afin de présenter le texte dans son intégralité. Chaque partie de l’œuvre contribue à sa compréhension globale.
Évitement d’annotations ou de commentaires ajoutés :
Dans un souci de neutralité, j’ai délibérément évité d’ajouter des annotations ou des commentaires au texte. Je préfère laisser aux lecteurs le soin d’interpréter les propos eux-mêmes, sans influence extérieure.
Origine et référence de l’édition utilisée :
Les passages en italique proviennent de l’édition allemande publiée chez Franz Eher à Munich en 1933. Cette référence permet de situer le contexte et l’origine du texte.
Nature particulière de Mein Kampf :
Mein Kampf, en raison de sa nature particulière et de sa diffusion gratuite en Allemagne, est davantage perçu comme un manifeste électoral que comme une œuvre littéraire. Il s’agit d’un document historique et politique d’une importance significative.
Droit du public à connaître :
Je suis convaincu que les paroles et les écrits publics d’une personnalité publique appartiennent au public. Lorsqu’une personne exprime des idées ou des menaces aussi explicites, il est de la responsabilité du public de les connaître et de les comprendre.
• • •
Dans cet esprit, je souhaite souligner que la lecture de « Mein Kampf Tome 2 » nécessite une approche critique et réfléchie. Les idées présentées dans cet ouvrage sont souvent teintées d’idéologies, et il est essentiel de les aborder avec discernement. Je rappelle également l’importance de contextualiser ces écrits dans l’histoire pour en comprendre pleinement les implications.
En offrant ce texte en libre accès, mon objectif est de favoriser le dialogue et la réflexion sur cette période complexe de l’histoire. Je vous encourage donc à explorer ce document avec un esprit ouvert, tout en gardant à l’esprit les leçons du passé. En outre, je tiens à souligner que mon site est fermement opposé à toute forme de discrimination envers les religions, les peuples ou tout autre groupe.
~ Merci de votre attention et bonne lecture ! ~
Tome Second
Le mouvement national-socialiste
Chapitre I – OPINION PHILOSOPHIQUE ET PARTI
Chapitre II – L’ÉTAT
Chapitre III – SUJETS DE L’ÉTAT ET CITOYENS
Chapitre IV – LA PERSONNALITÉ ET LA CONCEPTION RACISTE DE L’ÉTAT
Chapitre V – CONCEPTION PHILOSOPHIQUE ET ORGANISATION
Chapitre VI – LUTTE DES PREMIERS TEMPS – L’IMPORTANCE DE LA PAROLE
Chapitre VII – LA LUTTE CONTRE LE FRONT ROUGE
Chapitre VIII – LE FORT ET PLUS FORT QUAND IL RESTE SEUL
Chapitre IX – CONSÉQUENCES SUR LE SENS ET L’ORGANISATION DES SECTIONS D’ASSAULT
Chapitre X – LE FÉDÉRALISME N’EST QU’UN MASQUE
Chapitre XI – PROPAGANDE ET ORGANISATION
Chapitre XII – LA QUESTION CORPORATIVE
Chapitre XIII – LA POLITIQUE ALLEMANDE DES ALLIANCES APRÉS LA GUERRE
Chapitre XIV – ORIENTATION VERS L’EST OU POLITIQUE DE L’EST
Chapitre XV – LE DROIT DE LÉGITIME DEFENSE
Conclusion – CONCLUSION
Chapitre 1 – Opinion philosophique et parti
Le 24 février 1920 eut lieu le premier grand meeting de notre jeune mouvement. Dans la salle des fêtes du Hofbraühaus, à Munich, les vingt-cinq points de notre programme furent exposés à une foule de près de deux mille hommes, et chacun de ces points reçut une approbation enthousiaste. Ainsi furent livrés au public, pour la première fois, les principes et les directives du combat qui devait nous débarrasser d’un véritable fatras d’idées et d’opinions périmées de tendances obscures ou même nuisibles. Il fallait qu’une puissance nouvelle se manifestât dans le paresseux et lâche monde bourgeois, comme devant la triomphante vague marxiste, pour arrêter au dernier moment le char du destin.
Il était évident que le nouveau mouvement ne pouvait espérer acquérir l’importance et la force nécessaires à cette lutte gigantesque, que s’il réussissait dès le premier jour à éveiller dans le cœur de ses adhérents la conviction sacrée que la vie politique n’en recevrait pas simplement une formule électorale nouvelle, mais qu’elle se trouverait en présence d’une conception philosophique nouvelle d’une importance fondamentale.
Il faut se représenter le misérable ramassis d’idées qui sert normalement à bâcler ce qu’on appelle le
« programme d’un parti », puis comment, de temps en temps, celui-ci est fignolé et léché. On doit surtout regarder à la loupe les mobiles des commissions de programme bourgeoises, pour pouvoir estimer à leur valeur ces accouchements programmatiques :
Un souci unique détermine immanquablement, soit l’établissement d’un programme nouveau, soit la modification du précédent : le souci du résultat des prochaines élections. Aussitôt que commence à poindre dans la cervelle de ces artistes de la politique parlementaire le soupçon que le bon peuple veut se révolter et s’échapper des harnais du vieux char des partis, voici qu’ils se mettent à en repeindre le timon. Alors surviennent les observateurs d’étoiles et astrologues des partis, les « gens expérimentés » et les
« experts », le plus souvent de vieux parlementaires susceptibles de se remémorer des cas analogues du
« temps riche en enseignements de leur apprentissage politique », des cas où la patience de la masse avait rompu les traits ; ils sentent à nouveau se rapprocher de son attelage une menace analogue. Alors ils ont recours aux vieilles recettes, ils constituent une « commission », écoutent partout dans le bon peuple, flairent les articles de presse et reniflent longtemps pour savoir ce qu’aimerait le cher grand public, ce qui lui déplaît et ce qu’il espère. On étudie avec le plus grand soin tout groupe professionnel, toute classe d’employés et on scrute leurs désirs les plus intimes. Alors aussi les « formules » de la dangereuse opposition deviennent d’un coup mûres pour un sérieux examen, et le plus souvent d’ailleurs cette parcelle du trésor de science des vieux partis se révèle tout à fait pitoyable, au grand étonnement de ceux qui l’ont découverte et propagée. Et les commissions se réunissent, procèdent à la révision de l’ancien programme (et ces messieurs changent de convictions tout à fait comme les soldats en campagne changent leurs chemises, quand la précédente est partie en morceaux).
Ils en créent un nouveau dans lequel on donne à chacun ce qui lui revient. Au paysan, on garantit la protection de son agriculture ; à l’industriel, la protection de ses produits ; au consommateur, la protection de ce qu’il achète ; les traitements des instituteurs sont augmentés, les pensions des fonctionnaires sont améliorées, l’État doit faire dans une large mesure des situations aux veuves et orphelins, le trafic doit être favorisé, les tarifs abaissés et même les impôts doivent être, sinon totalement, du moins en grande partie supprimés. Souvent il arrive que l’on a oublié une corporation ou que l’on n’a pas eu connaissance d’une exigence ayant cours dans le peuple. Alors, en toute hâte, on rajoute encore des pièces jusqu’à ce que l’on puisse à bon droit espérer que l’on a de nouveau calmé et pleinement contenté l’armée des petits bourgeois « moyens » et de leurs épouses. Ainsi réconforté, on peut commencer, confiant en Dieu et en l’inébranlable sottise du citoyen électeur, la lutte pour la « réforme » de l’État, comme on dit.
Quand le jour des élections est passé et que les parlementaires ont tenu la dernière de leurs réunions populaires pour cinq ans, de ce dressage de la plèbe ils passent à l’accomplissement de leurs devoirs plus élevés et plus agréables.
La commission du programme se dissout et la lutte pour la forme nouvelle des choses reprend la forme de la lutte pour le bon pain quotidien : c’est-à-dire, pour un député, l’indemnité parlementaire.
Tous les matins, M. le représentant du peuple se rend dans la grande maison et, sinon tout à fait dans l’intérieur, tout au moins dans l’antichambre où se trouvent les listes de présence. Au service du peuple, il y porte son nom, et il reçoit le juste salaire d’une petite indemnité pour ces continuels et harassants efforts.
Après quatre ans, ou bien au cours de semaines critiques, lorsque la dissolution des corporations parlementaires devient de plus en plus menaçante, une irrépressible et impétueuse tendance se manifeste chez ces messieurs. De même que le ver blanc ne peut que se changer en hanneton, de même ces chrysalides parlementaires abandonnent leur grand phalanstère et s’envolent sur leurs ailes neuves vers le bon peuple. Ils parlent de nouveau à leurs électeurs, leur racontent leurs énormes travaux et l’obstination mal intentionnée des autres ; souvent l’inintelligente masse, au lieu d’une reconnaissante approbation, leur lance à la figure des paroles hostiles.
Lorsque cette ingratitude du peuple arrive à un certain degré, un seul moyen peut y remédier : il faut raviver le brillant du parti, le programme a besoin d’être amélioré. La commission renaît et la duperie recommence comme précédemment. Vu la bêtise aussi dure que le granit de notre humanité, il n’y a pas à s’étonner du résultat. Sous la conduite de sa presse, ébloui par le nouveau et séduisant programme, le bétail à voter « bourgeois », aussi bien que prolétarien, revient à l’étable commune et élit à nouveau celui qui l’a déjà trompé.
Ainsi l’homme populaire et candidat des classes laborieuses redevient la chenille parlementaire. Il continue à manger sur la branche de la vie publique, y devient gros et gras, et, quatre ans après, se transforme de nouveau en un brillant papillon.
Il n’y a rien de plus déprimant que d’observer tous ces agissements dans la prosaïque vérité et d’être obligé d’assister à cette tromperie perpétuellement renouvelée. Avec un pareil fond de pourriture intellectuelle, on ne peut vraiment pas trouver, dans le camp bourgeois, la force nécessaire pour mener le combat contre la puissance organisée du marxisme.
D’ailleurs, ces messieurs n’y songent pas sérieusement. Si bornés et si imbéciles que l’on doive reconnaître ces médicastres parlementaires de la race blanche, on ne peut admettre qu’ils songent sérieusement à entrer en lutte, par le moyen d’une démocratie occidentale, contre les théories marxistes. Pour cette théorie en effet, tout le système démocratique n’est, en mettant les choses au mieux, qu’un moyen d’arriver à ses fins : elle l’utilise pour paralyser l’adversaire et se faire le champ libre. Et lorsqu’une partie du marxisme tente présentement, d’ailleurs fort adroitement, de donner l’illusion de son indissoluble attachement aux principes de la démocratie, il convient de ne pas oublier qu’à l’heure critique, ces messieurs ne se souciaient pas plus que d’un fifrelin d’une décision de la majorité selon la conception occidentale de la démocratie.
Aux jours où les parlementaires bourgeois voyaient la garantie de la sécurité du pays dans la monumentale inintelligence du nombre prépondérant, le marxisme, avec une troupe de rôdeurs de bas quartiers, de déserteurs, de bonzes de partis et de littérateurs juifs, s’empara en un tour de main du pouvoir, donnant un soufflet retentissant à cette même démocratie. C’est pourquoi il faut la crédulité d’un des chamanes parlementaires de notre démocratie bourgeoise pour s’imaginer que jamais la brutale résolution des profiteurs ou des suppôts de cette peste mondiale puisse être conjurée par les formules d’exorcisme du parlementarisme occidental.
Le marxisme marchera avec la démocratie aussi longtemps qu’il n’aura pas réussi à se gagner, poursuivant indirectement ses desseins destructeurs, la faveur de l’esprit national qu’il a voué à l’extermination. Mais si, il arrivait à la conviction que, dans le chaudron de sorcières de notre démocratie parlementaire, peut se cuisiner soudainement, quand ce ne serait que dans le corps législatif, une majorité qui s’attaque sérieusement au marxisme, alors le jeu de prestidigitation parlementaire serait bientôt fini. Les porte-drapeaux de l’internationale rouge adresseraient alors, au lieu d’une invocation à la conscience démocratique, un appel enflammé aux masses prolétariennes, et le combat serait d’un seul coup transplanté, de l’atmosphère croupissante des salles de séances des parlements, dans les usines et dans la rue. Ainsi la démocratie serait immédiatement liquidée ; et ce que n’a pu réaliser dans les parlements la souplesse d’esprit de ces apôtres populaires, réussirait avec la rapidité de l’éclair aux pinces et marteaux de forge des masses prolétariennes surexcitées ; exactement comme en automne 1918, elles montreraient d’une façon frappante au monde bourgeois comme il est insensé de penser arrêter la conquête mondiale juive avec les moyens dont dispose la démocratie occidentale.
Comme nous l’avons dit, il faut un esprit crédule pour se lier, en présence d’un tel partenaire, à des règles qui, pour le dernier, ne sont que bluffs, ou ne servent qu’à lui, et qui seront jetées par-dessus bord aussitôt qu’elles ne lui assureront plus d’avantages.
Dans tous les partis bourgeois, la lutte politique se résume en fait à une dispute pour quelques sièges au Parlement, lutte où les principes sont, en cas de besoin, jetés par-dessus bord comme un sac de lest, et leurs programmes s’en ressentent, tout comme leur puissance propre. Il leur manque cette forte attraction magnétique qui ne peut s’exercer sur la masse que par l’emprise de grandes idées, cette force de conviction que donne, seule, la foi absolue en ses principes et la résolution fanatique de les faire triompher. Mais au moment où l’un des partis, muni de toutes les armes d’une conception philosophique, fût-elle mille fois criminelle, marche à l’assaut contre un ordre établi, l’autre en est réduit à la résistance, s’il ne prend la forme d’un nouveau dogme, dogme politique dans le cas présent, et ne remplace les faibles et lâches paroles de défense par le cri de guerre d’une attaque courageuse et brutale. Aussi quand d’aucuns, tout particulièrement les ministres soi-disant nationaux des postes bourgeois, ou le centre bavarois, adressent à notre mouvement l’astucieux reproche de travailler pour une révolution, nous ne pouvons faire qu’une réponse à cette conception politique de quatre sous : certainement, nous tâchons de regagner ce que vous avez, dans votre criminelle bêtise, laissé échapper. Vous avez contribué, par votre maquignonnage parlementaire, à entraîner la nation vers l’abîme ; mais nous allons, par l’établissement d’une nouvelle conception philosophique et l’inébranlable et fanatique défense de ses principes, construire pour notre peuple les degrés par lesquels il pourra un jour s’élever de nouveau vers le temple de la liberté.
Ainsi notre premier soin, au temps de la fondation de notre mouvement, devait être toujours de veiller qu’une troupe formée par les soldats d’une sublime conviction ne devienne une association pour favoriser les intérêts parlementaires.
La première des mesures préventives fut la création d’un programme qui, systématiquement, accusait des tendances de nature, par leur ampleur même, à tenir à distance les esprits débiles et mesquins de nos partis politiques d’aujourd’hui. Combien nous avions raison de juger nécessaires des buts aussi fortement marqués pour notre programme, on le comprend avec évidence au spectacle de la fatale faiblesse qui finit par amener l’écroulement de l’Allemagne.
La connaissance de ces faits devait conduire à une nouvelle conception de l’État, laquelle, à son tour, constitue une partie essentielle de notre nouvelle conception du monde.
• • •
Je me suis déjà, dans le premier volume, expliqué sur le mot völkisch, lorsque j’ai dû poser en fait que ce terme n’a pas une signification assez précise pour qu’on puisse en faire la base d’une communauté d’action et de lutte. Tout ce que l’on peut imaginer de plus essentiellement différent se groupe aujourd’hui sous le pavillon du mot völkisch. Avant donc que de passer aux problèmes et aux buts du Parti ouvrier allemand national-socialiste, je voudrais préciser le sens du mot völkisch, et les rapports qu’il a avec notre mouvement.
Le terme völkisch apparaît aussi peu clairement défini, il peut être interprété d’autant de façons, et servir dans la pratique à des usages presque aussi nombreux que le mot « religieux ». On ne peut guère non plus attacher à ce qualificatif une acception absolument précise, qu’il s’agisse de définition théorique ou d’acception usuelle. Le terme « religieux » ne peut être conçu qu’en rapport avec une forme bien déterminée des réalisations qui sont les siennes. C’est une très belle appréciation, le plus souvent aussi fondée, quand on qualifie la nature d’un homme de « profondément religieuse ». Sans aucun doute, d’aucuns seront-ils satisfaits d’une appréciation aussi universelle ; pour certains même, elle pourra évoquer l’image plus ou moins nette d’un certain état d’âme. Mais la grande masse ne se compose pas seulement des philosophes et des saints. Une pareille idée religieuse tout à fait générale ne fera le plus souvent que rendre à chacun sa liberté de pensée et d’action. Elle ne sera nullement mobile d’actions, comme le devient le sentiment religieux profond, au moment où un dogme précis prend forme dans le monde indéterminé de la métaphysique pure. Certes ce dogme n’est pas un but « en soi », mais un moyen ; mais moyen inévitablement nécessaire pour atteindre le but. Ce but cependant n’est pas purement idéal ; tout au contraire, au fond, il est éminemment pratique. Il faut, en effet, se rendre compte que les idéals les plus hauts correspondent toujours à de profondes nécessités vitales ; tout comme les canons de la beauté la plus parfaite découlent logiquement, en dernière analyse, de l’utilité.
En même temps que la foi aide à élever l’homme au-dessus du niveau d’une vie animale et paisible, elle contribue à raffermir et à assurer son existence. Que l’on enlève à l’humanité actuelle les principes religieux, confirmés par l’éducation, qui sont pratiquement des principes de moralité et de bonnes mœurs ; que l’on supprime cette éducation religieuse sans la remplacer par quelque chose d’équivalent, et on en verra le résultat sous la forme d’un profond ébranlement des bases de sa propre existence. On peut donc poser en axiome que non seulement l’homme vit pour servir l’idéal le plus élevé, mais aussi que cet idéal parfait constitue à son tour pour l’homme une condition de son existence. Ainsi se ferme le cercle.
Naturellement, dans la définition tout à fait générale du mot « religieux » sont incluses des notions ou des convictions fondamentales, par exemple celles de l’immortalité de l’âme, la vie éternelle, l’existence d’un être supérieur, etc. Mais toutes ces pensées, quelque persuasion qu’elles exercent sur l’individu, demeurent soumises à son examen critique et à des alternatives d’acceptations et de refus, jusqu’au jour où la foi apodictique prend force de loi sur le sentiment et sur la raison. La foi est l’instrument qui bat la brèche et fraie le chemin à la reconnaissance des conceptions religieuses fondamentales.
Sans un dogme précis, la religiosité, avec ses mille formes mal définies, non seulement serait sans valeur pour la vie humaine, mais, en outre, contribuerait sans doute au délabrement général.
Il en est de même du qualificatif völkisch que du terme « religieux ». Lui aussi contient diverses notions fondamentales. Mais bien que de la plus haute importance, elles sont sous une forme si mal définie qu’elles ne s’élèveront pas au-dessus de la valeur d’une simple opinion admise, tant qu’elles ne seront pas envisagées comme principes fondamentaux dans le cadre d’un parti politique. Car la réalisation d’un idéal théorique et de ses conséquences logiques résulte aussi peu du simple sentiment ou du seul fait d’une volonté intérieure des hommes, que la conquête de la liberté ne provient de l’aspiration universelle vers cet état. Non, ce n’est que quand la poussée idéale vers l’indépendance reçoit l’organisation de combat et une puissance militaire que l’ardent désir d’un peuple peut se changer en une magnifique réalité.
Une opinion philosophique a beau être mille fois juste et viser un plus grand bien de l’humanité, elle demeurera sans valeur pratique pour la vie d’un peuple, aussi longtemps que ses principes ne sont pas devenus la bannière d’un mouvement agissant. À son tour, ce mouvement restera simple parti, tant que son action n’aura pas abouti à la victoire de ses idées, et que ses dogmes de parti ne seront pas devenus pour un peuple les lois de base de sa communauté.
Mais lorsqu’une conception abstraite de caractère général doit servir de base à une évolution à venir, alors la condition première est de faire toute lumière sur la nature et sa portée. Ce n’est que sur une telle base que l’on peut créer un mouvement puisant la force nécessaire à la lutte dans l’unité de ses convictions. C’est à partir de concepts généraux que l’on doit bâtir un programme politique et c’est sur la base d’un système philosophique que l’on doit appuyer un dogme politique déterminé. Ce dernier ne doit pas viser un but inaccessible, et s’attacher exclusivement aux idées, mais aussi tenir compte des moyens de lutte qui existent et que l’on peut mettre en œuvre pour leur victoire. À une conception spirituelle théoriquement juste, et qu’il appartient à celui qui trace le programme de mettre en avant, doit donc se joindre la science pratique de l’homme politique.
Ainsi un idéal éternel doit malheureusement, pour servir d’étoile conductrice à l’humanité, accepter les faiblesses de cette même humanité pour ne pas faire naufrage dès le départ à cause de l’imperfection humaine. À celui qui a reçu la révélation, il faut adjoindre celui qui connaît l’âme du peuple, qui extraira du domaine de l’éternelle vérité et de l’idéal ce qui est accessible aux humbles mortels et qui lui fera prendre corps.
Cette transmutation d’un système philosophique idéalement vrai en une communauté politique de foi et de combat nettement définis, organisée rigidement, animée d’une seule croyance et d’une même volonté, voilà le problème essentiel ; toutes les chances de victoire d’une idée reposent entièrement sur l’heureuse solution de ce problème. C’est alors que, de cette armée de millions d’hommes, tous plus ou moins clairement pénétrés de ces vérités, certains même allant peut-être jusqu’à la comprendre en partie, un homme doit sortir qu’anime une puissance d’apôtre. Des idées nébuleuses de grand public, il extrait des principes fermes comme le granit, il mène la lutte pour la vérité unique qu’ils contiennent ; jusqu’à ce que, des vagues agitées du libre monde des idées, émerge le roc solide de l’union de ceux qui communient dans une même croyance et une même volonté.
D’un point de vue universel, la nécessité justifie le droit d’agir ainsi ; le succès justifie le droit de l’individu.
• • •
Si nous essayons de sortir du mot völkisch le sens le plus intime, nous arriverons à la constatation suivante :
La conception philosophique courante aujourd’hui consiste généralement, au point de vue politique, à attribuer à l’État lui-même une force créatrice et civilisatrice. Mais il n’y aurait que faire des conditions préalables de race ; l’État résulterait plutôt des nécessités économiques ou, dans le meilleur cas, du jeu des forces politiques. Cette conception fondamentale conduit logiquement à une méconnaissance des forces primitives liées à la race, et à sous-estimer la valeur de l’individu. Celui qui nie la différence entre les races, en ce qui concerne leur aptitude à engendrer des civilisations, est forcé de se tromper aussi quand il juge les individus. Accepter l’égalité des races entraîne à juger pareillement les peuples et les hommes. Le marxisme international n’est lui-même que la transformation, par le Juif Karl Marx, en une doctrine politique précise d’une conception philosophique générale déjà existante. Sans cet empoisonnement préalable, le succès politique extraordinaire de cette doctrine n’eût pas été possible. Karl Marx fut simplement le seul, dans le marécage d’un monde pourri, à reconnaître avec la sûreté de coup d’œil d’un prophète les matières les plus spécifiquement toxiques ; il s’en empara, et, comme un adepte de la magie noire, les employa à dose massive pour anéantir l’existence indépendante des libres nations de ce monde. Tout ceci d’ailleurs au profit de sa race.
Ainsi la doctrine marxiste est, en résumé, l’essence même du système philosophique aujourd’hui généralement admis. Pour ce motif déjà, toute lutte contre lui de ce que l’on appelle le monde bourgeois est impossible, et même ridicule, car ce monde bourgeois est essentiellement imprégné de ces poisons et rend hommage à une conception philosophique qui, d’une façon générale, ne se distingue de la conception marxiste que par des nuances ou des questions de personnes. Le monde bourgeois est marxiste, mais croit possible la domination de groupes déterminés d’hommes (la bourgeoisie), cependant que le marxisme lui-même vise délibérément à remettre ce monde dans la main des Juifs.
Au contraire, la conception « raciste » fait place à la valeur des diverses races primitives de l’humanité. En principe, elle ne voit dans l’État qu’un but qui est le maintien de l’existence des races humaines. Elle ne croit nullement à leur égalité, mais reconnaît au contraire et leur diversité, et leur valeur plus ou moins élevée. Cette connaissance lui confère l’obligation, suivant la volonté éternelle qui gouverne ce monde, de favoriser la victoire du meilleur et du plus fort, d’exiger la subordination des mauvais et des faibles. Elle rend ainsi hommage au principe aristocratique de la nature et croit en la valeur de cette loi jusqu’au dernier degré de l’échelle des êtres. Elle voit non seulement la différence de valeurs des races, mais aussi la diversité de valeurs des individus. De la masse se dévoile pour elle la valeur de la personne, et par cela elle agit comme une puissance organisatrice en présence du marxisme destructeur. Elle croit nécessaire de donner un idéal à l’humanité, car cela lui paraît constituer la condition première pour l’existence de cette humanité. Mais elle ne peut reconnaître le droit d’existence à une éthique quelconque, quand celle-ci présente un danger pour la survie de la race qui défend une éthique plus haute ; car, dans un monde métissé et envahi par la descendance de nègres, toutes les conceptions humaines de beauté et de noblesse, de même que toutes les espérances en un avenir idéal de notre humanité, seraient perdues à jamais.
La culture et la civilisation humaines sont sur ce continent indissolublement liées à l’existence de l’Aryen. Sa disparition ou son amoindrissement feraient descendre sur cette terre les voiles sombres d’une époque de barbarie.
Mais saper l’existence de la civilisation humaine en exterminant ceux qui la détiennent, apparaît comme le plus exécrable des crimes. Celui qui ose porter la main sur la propre image du Seigneur dans sa forme la plus haute, injurie le Créateur et aide à faire perdre le paradis.
La conception raciste répond à la volonté la plus profonde de la nature, quand elle rétablit ce libre jeu des forces qui doit amener le progrès par la sélection. Un jour, ainsi, une humanité meilleure, ayant conquis ce monde, verra s’ouvrir librement à elle tous les domaines de l’activité.
Nous sentons tous que, dans un avenir éloigné, les hommes rencontreront des problèmes que, seul, pourra être appelé à résoudre un maître-peuple de la plus haute race, disposant de tous les moyens et de toutes les ressources du monde entier.
• • •
Bien évidemment, un examen aussi général du contenu abstrait d’une conception philosophique raciste peut mener à mille interprétations. En fait, il n’est pas une de nos jeunes créations politiques qui ne se réclame sur quelque point de cette théorie. Cependant, leur existence simultanée prouve justement la diversité de leurs conceptions. Ainsi, à la philosophie marxiste, dirigée par une organisation centralisée, s’oppose un ramassis de conceptions que l’on peut d’ores et déjà juger peu efficaces en présence du front serré ennemi. On ne remporte pas de victoires avec des armes aussi faibles. C’est seulement quand s’opposera à la conception philosophique internationaliste – dirigée politiquement par le marxisme organisé – le front unique d’une conception philosophique raciste qu’une égale énergie au combat fera se ranger le succès du côté de l’éternelle vérité.
Mais, pour organiser la mise en application d’une conception philosophique, il est tout d’abord indispensable d’en poser une définition précise ; ce que les dogmes représentent pour la foi, les principes fondamentaux du parti le représentent pour un parti politique en formation.
Il faut donc assurer à la conception raciste un instrument de combat, de même que l’organisation de parti marxiste fait le champ libre pour l’internationalisme.
C’est ce but que poursuit le Parti national-socialiste allemand.
Fixer ainsi pour le parti la doctrine raciste est la condition préalable du succès des conceptions racistes. La meilleure preuve en est donnée indirectement par les propres adversaires de ce regroupement du parti. Ceux- là même qui ne se lassent pas d’affirmer que les conceptions racistes ne sont nullement l’apanage d’un seul, mais, au contraire, qu’elles sommeillent ou « vivent » au cœur de Dieu sait combien de millions d’hommes, que ceux-là vérifient donc que la présence effective de ces conceptions n’a jamais pu justement s’opposer en rien au triomphe des conceptions adverses, défendues par un parti politique classique. S’il en était autrement, le peuple allemand aurait déjà nécessairement remporté aujourd’hui une gigantesque victoire, et il ne serait pas sur le bord de l’abîme. Ce qui a assuré le succès des conceptions internationalistes, c’est leur défense par un parti organisé sous forme de sections d’assaut (Sturmabteilung : S. A.). Si les conceptions opposées ont succombé, c’est faute d’un front unique de défense. Ce n’est pas en développant sans limites une théorie générale, mais dans la forme limitée et ramassée d’une organisation politique qu’une conception philosophique peut combattre et triompher.
J’ai donc considéré que ma propre tâche était de dégager de la riche et informe substance d’une conception philosophique générale les idées essentielles, de les mettre sous une forme plus ou moins dogmatique. Ainsi élaguées et clarifiées, elles pourront grouper ceux des hommes qui voudront s’y astreindre. Autrement dit : le Parti national-socialiste des travailleurs allemands tire les caractères essentiels d’une conception raciste de l’univers, il en fait, compte tenu des réalités pratiques de l’époque, du matériel humain et de ses faiblesses, un ensemble doctrinal politique, qui pose dès lors lui-même, en une organisation aussi rigide que possible des grandes masses humaines, les bases du triomphe final de cette conception philosophique.
Chapitre 2 – L’État
Dès 1920 et 1921 les milieux, survivance de ce monde bourgeois dont le règne est maintenant fini, reprochaient constamment à notre jeune parti d’avoir pris position contre la forme actuelle de l’État ; et les coupe-jarrets au service des partis politiques de toutes nuances en tiraient la conclusion qu’il était permis de mener par tous les moyens une lutte d’extermination contre ces jeunes importuns, protagonistes d’une nouvelle conception du monde. À vrai dire on se gardait bien de reconnaître que la bourgeoisie actuelle est incapable de concevoir une notion cohérente sous le mot État, mot dont il n’existe pas, dont il ne peut pas exister de définition cohérente. Et, le plus souvent, ceux qui détiennent les chaires de notre enseignement supérieur officiel parlent en professeurs de droit public, qui doivent surtout trouver des explications et des interprétations justifiant l’existence plus ou moins heureuse des gouvernements qui leur donnent leur pain. Plus un État est constitué de façon illogique, et plus obscures, artificielles et incompréhensibles sont les définitions que l’on donne de sa raison d’être. Que pouvait par exemple dire autrefois un professeur d’Université impériale et royale sur la signification et les buts de l’État, dans un pays dont la constitution politique était le monstre le plus informe du vingtième siècle ? Lourde tâche si l’on considère que, de nos jours, un professeur de droit public est moins tenu de dire la vérité qu’obligé de servir un but précis. Ce but, c’est de défendre à tout prix l’existence du monstrueux mécanisme humain dont il est question et qu’on nomme actuellement un État. Qu’on ne s’étonne donc pas si, en discutant ce problème, on évite le plus possible de considérer les faits pour se retrancher dans un fatras de principes « éthiques », « moraux », « moralisants » et de valeurs, tâches et buts imaginaires.
Dans l’ensemble, on peut distinguer trois systèmes :
A – Il y a ceux qui voient simplement dans l’État un groupement plus ou moins volontaire d’hommes soumis à l’autorité d’un gouvernement.
Ce sont les plus nombreux. Parmi eux se trouvent les adorateurs contemporains du principe de légitimité, aux yeux desquels la volonté des hommes n’a aucun rôle à jouer dans l’affaire. Pour eux, le fait qu’un État existe suffit à le rendre inviolable et sacré. Pour protéger de toute atteinte cette conception de cerveaux déments, on prône l’adoration servile de ce qu’on appelle l’autorité de l’État. Dans la cervelle de ces gens-là, le moyen devient en un tournemain le but définitif. L’État n’est plus fait pour servir les hommes, mais ceux-ci sont là pour adorer une autorité de l’État, dont participe le plus modeste des fonctionnaires, quelles que soient ses fonctions. Pour que cette adoration silencieuse et extatique ne se transforme pas en désordre, l’autorité de l’État, de son côté, n’existe que pour maintenir le calme et le bon ordre. Elle n’est donc plus finalement ni un but ni un moyen. L’État doit veiller au maintien du calme et du bon ordre et, réciproquement, le calme et le bon ordre doivent permettre à l’État d’exister. C’est entre ces deux pôles que la vie de la communauté doit tourner en rond.
En Bavière, cette conception est surtout représentée par les artistes politiques du Centre bavarois, qu’on appelle le Parti populaire bavarois ; en Autriche, c’étaient les légitimistes noir-jaune. Dans le Reich lui- même, ce sont malheureusement les éléments dits conservateurs qui agissent d’après de pareilles conceptions de l’État.
B – D’autres théoriciens, moins nombreux, mettent au moins à l’existence de l’État certaines conditions. Ils veulent qu’il y ait non seulement une même administration, mais aussi une même langue, quand ce ne serait que pour des considérations techniques d’administration en général. L’autorité de l’État n’est plus la raison d’être unique et exclusive de l’État ; celui-ci doit, en outre, contribuer au bien-être des sujets. Des idées de « liberté », mais la plupart du temps mal comprises, se glissent dans la conception de cette école. La forme de gouvernement ne paraît plus inviolable du seul fait de son existence ; on examine aussi l’utilité qu’elle peut avoir. Le respect du passé ne la protège pas contre la critique du présent. En résumé, cette école attend avant tout de l’État qu’il donne à la vie économique une forme favorable à l’individu ; elle le juge du point de vue pratique et d’après des conceptions générales d’économie politique, sur sa rentabilité. On rencontre les principaux représentants de cette opinion dans les milieux de notre bourgeoisie allemande moyenne, particulièrement dans ceux de la démocratie libérale.
C – Le troisième groupe est le plus faible au point de vue numérique.
Il voit dans l’État un moyen de réaliser des tendances impérialistes exposées la plupart du temps de façon obscure ; il veut arriver à la fondation d’un État populaire fortement uni et auquel une langue commune donne un caractère nettement accusé. S’il veut une langue unique, ce n’est pas seulement dans l’espoir de donner ainsi à cet État une base solide qui lui permette d’accroître sa puissance à l’extérieur, mais aussi et surtout dans l’opinion – d’ailleurs radicalement fausse – que l’unification de la langue le mettrait à même de mener à bien une nationalisation orientée dans un certain sens.
Il est lamentable de voir comment, au cours du dernier siècle, et très souvent en toute bonne foi, on a fait un usage frivole du mot : « germaniser ». Je me rappelle encore combien, au temps de ma jeunesse, ce terme suggérait d’idées incroyablement fausses. On entendait alors exprimer jusque dans les milieux pangermanistes l’opinion que les Allemands d’Autriche pourraient très bien, avec le concours du gouvernement, germaniser les Slaves d’Autriche ; on ne se rendait pas compte que la germanisation ne s’applique qu’au sol, jamais aux hommes. Ce qu’on entendait en général par ce mot, c’était l’usage de la langue allemande, imposé de force et publiquement pratiqué. C’est commettre une inconcevable faute de raisonnement que d’imaginer qu’il serait possible de faire un Allemand, disons d’un nègre ou d’un Chinois, en lui enseignant l’allemand et en obtenant qu’il parle désormais notre langue, peut- être même qu’il vote pour un parti politique allemand. Nos bourgeois nationaux ne voyaient pas que ce genre de germanisation était, en réalité, une dégermanisation. Car, si les différences existant entre les peuples, et qui jusqu’à présent sont évidentes et sautent aux yeux, pouvaient être atténuées et finalement effacées, en imposant par le fait du prince l’emploi d’une langue commune, cette mesure amènerait le métissage et, dans notre cas, non pas une germanisation, mais bien l’anéantissement de l’élément germanique. Il arrive, et le cas n’est que trop fréquent dans l’histoire, qu’un peuple conquérant réussisse, par des moyens de contrainte extérieure, à imposer sa langue aux vaincus, mais, au bout de mille ans, cette langue est parlée par un peuple nouveau et les vainqueurs sont ainsi devenus à proprement parler les vaincus.
Comme la nationalité, ou, pour mieux dire, la race ne dépend pas de la langue, mais du sang, on n’aurait le droit de parler de germanisation que si, par tel procédé, on parvenait à changer le sang du vaincu. Mais cela est impossible. Y arriverait-on, ce serait par un mélange des sangs, qui abaisserait le niveau de la race supérieure. Le résultat final d’un tel processus serait la disparition des qualités qui ont autrefois rendu le peuple conquérant capable de vaincre. Ce sont particulièrement les énergies civilisatrices que ferait disparaître le métissage avec une race inférieure, le peuple issu de ce mélange parlerait-il mille fois la langue de l’ancienne race supérieure. Il se produirait encore, pendant un certain temps, une sorte de lutte entre les esprits différents et le peuple, voué à une décadence irrémédiable, pourrait, dans un dernier sursaut, mettre au jour les chefs-d’œuvre d’une surprenante civilisation. Leurs auteurs ne seraient que des représentants isolés de la race supérieure ou encore des métis issus d’un premier croisement, chez lesquels le meilleur sang continue à l’emporter et cherche à se frayer passage, ils ne seraient jamais les produits ultimes du métissage. Ce dernier s’accompagnera toujours d’un recul de la civilisation.
Nous devons nous estimer heureux aujourd’hui qu’une germanisation, telle que Joseph II l’avait conçue, n’ait pas réussi en Autriche. Son succès aurait eu vraisemblablement pour effet de maintenir en vie l’État autrichien, mais aussi d’amener, par la communauté de la langue, un abaissement du niveau ethnique de la nation allemande. Au cours des siècles, un certain instinct grégaire aurait pu prendre corps, mais le troupeau même aurait perdu de sa valeur. Il serait peut-être né un peuple résultant d’une communauté d’État, mais un peuple résultant d’une communauté de culture aurait disparu.
Il a mieux valu, pour la nation allemande, que ce métissage n’ait pas lieu, bien qu’on y ait renoncé non pour des raisons intelligentes et élevées, mais parce que les Habsbourg étaient des souverains bornés. S’il en avait été autrement, c’est à peine si l’on pourrait appeler encore aujourd’hui le peuple allemand un facteur de la civilisation.
Mais ce n’est pas seulement en Autriche, c’est aussi en Allemagne que les milieux dits nationaux furent et sont encore poussés par des raisonnements tout aussi faux. La politique polonaise réclamée par tant d’Allemands et qui tendait à la germanisation de l’Est, reposait malheureusement presque toujours sur un pareil sophisme. Là aussi on croyait réussir à germaniser les éléments polonais, en leur imposant simplement la langue allemande. Là aussi le résultat aurait été funeste : un peuple de race étrangère exprimant en langue allemande ses idées étrangères et portant atteinte à la noblesse et à la dignité de notre nation par sa nature inférieure.
N’est-ce pas déjà une pensée assez effrayante que celle du tort fait à notre race germanique, lorsque l’ignorance des Américains met à son débit les sales Juifs qui débarquent chez eux, parce qu’ils jargonnent leur allemand de youpins. Il ne viendra pourtant à l’esprit de personne que le fait purement accidentel que ces immigrants pouilleux, venus de l’Est, parlent le plus souvent allemand, prouve qu’ils sont d’origine allemande et font vraiment partie de notre peuple.
Ce qui, au cours de l’histoire, a pu être germanisé avec profit, ce fut le sol conquis par nos aïeux l’épée à la main et colonisé par les paysans allemands. Dans la mesure où ils ont, en même temps, introduit un sang étranger dans le corps de notre peuple, ils ont contribué à faire naître le funeste émiettement de notre caractère ethnique, qui se manifeste par cet individualisme hypertrophié propre aux Allemands et dont, malheureusement, on va souvent jusqu’à faire l’éloge.
Pour cette troisième école, l’État est aussi, dans un certain sens, une fin en soi et la conservation de l’État devient la principale tâche de la vie humaine.
En résumé, on peut établir que toutes ces théories ne plongent pas leurs racines dans l’intelligence de ce fait que les forces créatrices de civilisation et de valeurs ont pour base la race, et que l’État doit logiquement considérer comme sa tâche principale la conservation et l’amélioration de cette même race, condition fondamentale de tout progrès humain.
La conséquence extrême de ces conceptions et opinions erronées sur la nature et la raison d’être de l’État put être ensuite tirée par le Juif Marx : en séparant la notion de l’État des obligations envers la race, sans pouvoir formuler une autre définition admise au même degré, la bourgeoisie a frayé la voie à une doctrine qui nie l’État en soi.
C’est pourquoi la lutte que mène la bourgeoisie contre le marxisme international court, sur ce terrain, à un échec certain. La bourgeoisie a, depuis longtemps, fait bon marché des fondations dont son système politique ne pouvait se passer. Son adroit adversaire a découvert les points faibles de l’édifice qu’elle avait élevé et l’attaque avec les armes qu’elle lui a involontairement fournies.
Le premier devoir du nouveau parti qui se place sur le terrain des conceptions racistes, est donc de formuler clairement la conception qu’on doit avoir de la nature et de la raison d’être de l’État.
La notion fondamentale, c’est que l’État n’est pas un but, mais un moyen. Il est bien la condition préalable mise à la formation d’une civilisation humaine de valeur supérieure, mais il n’en est pas la cause directe. Celle-ci réside exclusivement dans l’existence d’une race apte à la civilisation. Même s’il se trouvait sur la terre des centaines d’États modèles, au cas où l’Aryen, qui est le pilier de la civilisation, viendrait à disparaître, il n’y aurait plus de civilisation correspondant, dans l’ordre spirituel, au degré qu’ont atteint les peuples de race supérieure. On peut aller encore plus loin et dire que l’existence d’États humains n’exclurait pas l’éventualité de l’anéantissement définitif de la race humaine, puisque la disparition du représentant de la race civilisatrice amènerait la perte des facultés intellectuelles supérieures de résistance et d’adaptation.
Si, par exemple, un séisme venait à bouleverser l’écorce terrestre et qu’un nouvel Himalaya surgisse des flots de l’océan, la civilisation humaine serait anéantie par cet épouvantable cataclysme. Il n’y aurait plus un seul État, tous les liens qui maintiennent l’ordre seraient rompus, les créations d’une civilisation millénaire seraient ruinées, la surface de la terre ne serait plus qu’un cimetière recouvert d’eau et de vase. Mais il suffirait que quelques hommes, appartenant à une race civilisatrice, aient survécu dans ce chaos d’épouvante pour que, fût-ce au bout de mille ans, la terre, revenue au calme, recommence à porter des témoignages de la force créatrice de l’homme. Seul, l’anéantissement des derniers représentants de la race supérieure ferait définitivement de la terre un désert. Inversement, des exemples tirés du temps présent prouvent que des États, dont les bases avaient été jetées par les représentants de races dénuées des capacités politiques indispensables, n’ont pu, en dépit de toutes les mesures prises par leurs gouvernements, échapper à la ruine. De même que les espèces de grands animaux des temps préhistoriques ont dû céder la place à d’autres et s’éteindre, de même devront céder le pas les races humaines privées d’une certaine force intellectuelle, qui, seule, peut leur faire trouver les armes nécessaires à leur conservation.
Ce n’est pas l’État qui fait naître un certain niveau de culture ; il ne peut que conserver la race, cause première de l’élévation de ce niveau. Dans le cas contraire, l’État peut continuer à exister pendant des siècles sans changement apparent, alors que, par suite du mélange des races qu’il n’a pas empêché, la capacité civilisatrice, et l’histoire même de ce peuple, qui en est le reflet, ont commencé depuis longtemps à subir de profondes altérations. Par exemple, notre État actuel, mécanisme fonctionnant à vide, peut, plus ou moins longtemps, faire encore illusion et sembler vivre, et pourtant l’empoisonnement de la race, dont souffre le corps de notre peuple, amène une déchéance de sa civilisation qui se manifeste déjà d’une façon effrayante.
La condition préalable mise à l’existence durable d’une humanité supérieure n’est donc pas l’État, mais la race qui possède les facultés requises.
Il faut savoir que ces facultés existent toujours, et qu’il leur suffit d’être mises en éveil par des circonstances extérieures pour se manifester. Les nations, ou plutôt les races civilisatrices, possèdent ces facultés bienfaisantes à l’état latent quand bien même les circonstances extérieures défavorables ne leur permettent pas d’agir. Aussi est-ce une incroyable injustice que de présenter les Germains des temps antérieurs au christianisme comme des hommes « sans civilisation », comme des barbares. Ils ne l’ont jamais été. C’était seulement la dureté du climat de leur habitat septentrional qui leur imposait un genre de vie qui s’opposait au développement de leurs forces créatrices. S’ils étaient, sans le monde antique, arrivés dans les régions plus clémentes du Sud et s’ils y avaient trouvé, dans le matériel humain fourni par des races inférieures, les premiers moyens techniques, la capacité à créer une civilisation qui sommeillait en eux, aurait produit une floraison aussi éclatante que celle des Hellènes. Mais qu’on n’attribue pas uniquement au fait qu’ils vivaient dans un climat septentrional cette force primitive qui engendre la civilisation. Un Lapon, transporté dans le Sud, contribuerait aussi peu au développement de la civilisation que pourrait le faire un Esquimau. Non, cette splendide faculté de créer et de modeler a été justement conférée à l’Aryen, qu’elle soit latente en lui ou qu’il en fasse don à la vie qui s’éveille, suivant que des circonstances favorables le lui permettent ou qu’une nature inhospitalière l’en empêche.
On peut en déduire la notion suivante :
L’État est un moyen de parvenir à un but. Son but est de maintenir et de favoriser le développement d’une communauté d’êtres qui, au physique et au moral, sont de la même espèce. Il doit maintenir, en premier lieu,
les caractères essentiels de la race, condition du libre développement de toutes les facultés latentes de celle- ci. De ces facultés, une partie servira toujours à l’entretien de la vie physique et une autre partie à favoriser les progrès intellectuels. Mais, en fait, le premier est toujours la condition nécessaire du second.
Les États qui ne visent pas à ce but sont des organismes défectueux, des créations avortées. Le fait qu’ils existent n’y change rien, pas plus que les succès obtenus par une association de flibustiers ne justifient la piraterie.
Nous autres nationaux-socialistes, qui combattons pour une autre conception du monde, nous ne nous plaçons pas sur le célèbre « terrain des faits », d’ailleurs controuvés. Nous ne serions plus alors les champions d’une grande idée neuve, mais les coolies du mensonge qui règne de nos jours. Nous devons faire une distinction bien tranchée entre l’État qui n’est qu’un contenant et la race qui en est le contenu. Ce contenant n’a de raison d’être que lorsqu’il est capable de conserver et de protéger son contenu ; sinon il n’a aucune valeur.
Par suite, le but suprême de l’État raciste doit être de veiller à la conservation des représentants de la race primitive, dispensateurs de la civilisation, qui font la beauté et la valeur morale d’une humanité supérieure.
Nous, en tant qu’Aryens, ne pouvons nous représenter un État que comme l’organisme vivant que constitue un peuple, organisme qui non seulement assure l’existence de ce peuple, mais encore, développant ses facultés morales et intellectuelles, la fait parvenir au plus haut degré de liberté.
Ce qu’on cherche aujourd’hui à nous imposer comme État est le produit monstrueux de l’erreur humaine la plus profonde, suivie d’un cortège d’indicibles souffrances.
Nous autres nationaux-socialistes savons que le monde actuel considérera cette conception comme révolutionnaire et qu’elle nous flétrira de ce nom. Mais nos opinions et nos actes ne doivent pas résulter de l’approbation ou de la désapprobation de notre époque, mais de l’obligation impérieuse de servir la vérité dont nous avons conscience. Nous pouvons être convaincus que l’intelligence plus ouverte de la postérité non seulement comprendra les raisons de notre entreprise, mais encore en reconnaîtra l’utilité et lui rendra hommage.
* * *
Ce qui précède nous donne, à nous nationaux-socialistes, la mesure de la valeur d’un État. Cette valeur n’est que relative, jugée du point de vue particulier de chaque nation ; elle sera absolue si l’on s’élève au point de vue de l’humanité en soi. Autrement dit :
On ne peut pas apprécier l’utilité d’un État en prenant pour critère le niveau de civilisation auquel il est parvenu, ou l’importance que lui donne sa puissance dans le monde ; on peut le faire exclusivement d’après l’utilité que peut avoir cet organisme pour chaque peuple considéré.
Un État peut être tenu pour idéal, si non seulement il répond aux conditions d’existence du peuple qu’il doit représenter, mais encore si son existence assure pratiquement celle de ce peuple, quelque importance culturelle que puisse du reste avoir dans le monde la forme de cet État. Car la tâche de l’État n’est pas de créer, mais de frayer la route aux forces en puissance. Un État peut donc être qualifié de mauvais si, tout en ayant atteint le degré le plus élevé de civilisation, il voue à la ruine l’homogénéité raciale des représentants de cette civilisation.
Car il ne respecte pas alors pratiquement la condition préalable de l’existence d’une culture, qui n’est pas son fait, mais le produit d’un peuple civilisateur affermi par la vivante synthèse de l’État.
L’État ne représente pas une substance, mais une forme. Le degré de civilisation auquel est parvenu un peuple donné ne permet donc pas de doser l’utilité de l’État dans lequel il vit. On conçoit facilement qu’un peuple, hautement doué pour la civilisation, offre un aspect préférable à celui d’une tribu nègre ; pourtant l’organisme créé par le premier sous la forme d’État peut être, par la façon dont il remplit son but, pire que celui du nègre. Bien que l’État le meilleur et la meilleure constitution politique soient incapables de tirer d’un peuple des facultés qui lui manquent actuellement et qu’il n’a jamais eues, une forme mauvaise d’État amènera fatalement, dans la suite des temps, en permettant ou même en occasionnant la disparition des représentants de la race civilisatrice, la perte des facultés que celle-ci possédait primitivement en puissance.
Par suite, le jugement qu’on portera sur la valeur d’un État sera tout d’abord déterminé par l’utilité qu’il peut avoir pour un peuple donné, et nullement par l’importance propre de son rôle dans l’histoire du monde.
À ce dernier point de vue, qui est tout relatif, on peut se faire rapidement une opinion exacte ; mais il est difficile de porter un jugement sur la valeur absolue d’un État, parce que ce jugement définitif ne dépend pas simplement de l’État lui-même, mais bien plutôt de la valeur et du niveau du peuple envisagé.
Quand on parle de la haute mission de l’État, on ne doit donc jamais oublier que cette haute mission incombe essentiellement au peuple, dont l’État n’a d’autre rôle que de rendre possible le libre développement, grâce à la puissance organique de son existence.
Si nous nous demandons alors comment doit être constitué l’État qui nous est nécessaire, à nous autres Allemands, nous devons d’abord préciser deux points : quelle sorte d’hommes cet État doit réunir, et quelles fins il doit poursuivre.
Notre peuple allemand n’a malheureusement plus pour base une race homogène. Et la fusion des éléments primitifs n’a pas fait de tels progrès qu’on puisse parler d’une race nouvelle sortie de cette fusion. En réalité, les contaminations successives qui, notamment depuis la guerre de Trente Ans, ont altéré le sang de notre peuple, ne l’ont pas décomposé seul, elles ont aussi agi sur notre âme. Les frontières ouvertes de notre patrie, le contact avec des corps politiques non-allemands le long des régions frontières, surtout le fort afflux de sang étranger dans l’intérieur du Reich ne laissait pas, par son renouvellement constant, le temps nécessaire pour arriver à une fusion complète. Il ne sortit pas de cette pot-bouille une race nouvelle ; les éléments ethniques restèrent juxtaposés et le résultat en fut que, dans les moments critiques, où un troupeau se rassemble d’ordinaire, le peuple allemand se dispersa dans toutes les directions. Non seulement la répartition territoriale des éléments constitutifs de la race intéresse des régions différentes, mais ils coexistent à l’intérieur d’une même région. Les hommes du Nord sont près de ceux de l’Est, près de ceux-ci, les Dalmates, près des deux, des hommes de l’Occident ; sans compter les mélanges. Cet état de choses a, par certains côtés, de grands inconvénients : il manque aux Allemands le puissant instinct grégaire, effet de l’identité du sang, qui, particulièrement impérieux aux heures du danger, prévient la ruine des nations, effaçant instantanément chez les peuples qui en sont doués toutes les différences secondaires et leur faisant opposer à l’ennemi commun le front uni d’un troupeau homogène. Ce qu’on désigne chez nous par hyperindividualisme provient de ce que les éléments fondamentaux de notre race, dont chacun a ses caractères particuliers, ont pris l’habitude de vivre à côté les uns des autres, sans arriver à se mêler. En temps de paix, il peut avoir souvent ses avantages, mais, à tout prendre, il nous a coûté la domination du monde. Si le peuple allemand avait possédé ; au cours de son histoire, cette unité grégaire qui a été si utile à d’autres peuples, le Reich allemand serait aujourd’hui le maître du globe. L’histoire du monde aurait pris un autre cours et personne n’est à même de décider si l’humanité n’aurait pas, en suivant cette route, atteint le but auquel tant de pacifistes aveuglés espèrent aujourd’hui parvenir par leurs piailleries et leurs pleurnicheries : Une paix non pas assurée par les rameaux d’olivier qu’agitent, la larme facile, des pleureuses pacifistes, mais garantie par l’épée victorieuse d’un peuple de maîtres qui met le monde entier au service d’une civilisation supérieure.
Le fait que notre peuple manque de la cohésion que donne un sang commun et resté pur, nous a causé des maux indicibles. Il a donné des capitales à une foule de petits potentats allemands, mais il a privé le peuple allemand de ses droits seigneuriaux.
Aujourd’hui encore, le peuple allemand souffre des suites de ce défaut de cohésion intime ; mais ce qui fit notre malheur, dans le passé et dans le présent, peut être, dans l’avenir, une source de bénédictions. Car, si funeste qu’aient été l’absence d’une fusion absolue des éléments qui composaient primitivement notre race, et l’impossibilité où nous nous sommes par suite trouvés de former un corps de peuple homogène, il est heureux, par contre, qu’une partie au moins de ce qu’il y a de meilleur dans notre sang soit restée pure, et ait échappé à la décadence qui a frappé le reste de notre race.
Il est certain qu’un amalgame complet des éléments primitifs de notre race aurait donné naissance à un peuple constituant un organisme achevé ; mais il aurait été, comme toute race hybride, doué d’une capacité de faire progresser la civilisation moindre que celle dont jouissait originairement le plus noble de ses éléments. C’est donc un bienfait que cette absence d’un mélange intégral : nous possédons encore aujourd’hui dans notre peuple allemand de grandes réserves d’hommes de la race germanique du Nord, dont le sang est resté sans mélange et que nous pouvons considérer comme le trésor le plus précieux pour notre avenir. Aux tristes époques où les lois de la race étaient inconnues, quand on voyait en tout homme, pris en soi, un être tout pareil à ses semblables, on n’apercevait pas les différences de valeur existant entre les divers éléments primitifs. Nous savons aujourd’hui qu’un amalgame complet des éléments constitutifs du corps de notre peuple et la cohésion qui en serait résultée nous auraient rendus peut-être extérieurement puissants, mais que le but suprême où doit tendre l’humanité nous serait demeuré inaccessible : la seule espèce d’hommes que le destin a visiblement choisie pour mener l’œuvre à bonne fin aurait été noyée dans la bouillie de races que forme un peuple unifié.
Mais ce qui a été empêché par le destin bienveillant, sans que nous y soyons pour quelque chose, il faut qu’aujourd’hui, forts d’une notion nouvellement acquise, nous l’examinions attentivement et en tirions parti.
Celui qui parle d’une mission donnée au peuple allemand sur cette terre doit savoir qu’elle consiste uniquement à former un État qui considère comme son but suprême de conserver et de défendre les plus nobles éléments de notre peuple, restés inaltérés, et qui sont aussi ceux de l’humanité entière.
Par là, l’État connaît, pour la première fois, un but intérieur élevé. En face du mot d’ordre ridicule qui lui donnait pour rôle de veiller au calme et au bon ordre, afin de permettre aux citoyens de se duper mutuellement tout à leur aise, la tâche qui consiste à conserver et à défendre une espèce humaine supérieure, dont la bonté du Tout-Puissant a gratifié cette terre, apparaît une mission vraiment noble.
Le mécanisme sans âme, qui prétend avoir sa raison d’être en lui-même, doit être transformé en un organisme vivant dont le but exclusif est de servir une idée supérieure.
Le Reich, en tant qu’État, doit comprendre tous les Allemands, et se donner pour tâche non seulement de réunir et de conserver les réserves précieuses que ce peuple possède en éléments primitifs de sa race, mais de les faire arriver lentement et sûrement à une situation prédominante.
* * *
À une période, qui est, si l’on va au fond des choses, celle de l’engourdissement et de la stagnation, succédera une période de lutte. Mais, comme toujours, le dicton : « Qui se repose, se rouille », trouve ici son application, et aussi celui qui professe que, seule, l’attaque donne la victoire. Plus le but de notre combat est élevé et plus la masse est incapable actuellement de le comprendre, plus immenses seront le succès – l’histoire nous l’apprend – et l’importance de ce succès ; il nous suffit de voir nettement le but où nous devons tendre et de mener la lutte avec une constance inébranlable.
Beaucoup des fonctionnaires qui dirigent actuellement notre État peuvent trouver moins hasardeux de travailler au maintien de l’état de choses existant que de lutter pour ce qui sera demain. Il leur paraît plus commode de voir dans l’État un mécanisme, dont la seule raison d’être est de se maintenir en vie, de même que leur vie « appartient à l’État », ainsi qu’ils ont l’habitude de le dire. Comme si ce qui a ses racines dans le peuple pouvait logiquement servir un autre maître que le peuple ; comme si l’homme pouvait travailler pour autre chose que pour l’homme. Il est naturellement, comme je l’ai dit, commode de ne voir dans l’autorité de l’État que le mécanisme purement automatique d’une organisation, plutôt que de la considérer comme l’incarnation souveraine de l’instinct de conservation d’un peuple. En effet, dans le premier cas, l’État, et l’autorité de l’État, sont pour ces esprits faibles des buts en soi ; dans le second cas, ils sont des armes puissantes au service du grand et éternel combat mené pour l’existence, et non pas machine aveugle, mais l’expression de la volonté unanime d’une communauté qui veut vivre.
Aussi, pour le combat livré en faveur de notre nouvelle conception de l’État – conception qui répond entièrement au sens primitif des choses – trouverons- nous bien peu de compagnons de lutte au sein d’une société vieillie physiquement, trop souvent aussi dans son intelligence et son courage. Dans ces couches de la population, nous ne ferons que par exception des recrues, vieillards dont le cœur a gardé sa jeunesse et l’esprit sa fraîcheur ; mais nous ne verrons jamais venir à nous ceux qui considèrent comme la tâche essentielle de leur vie de maintenir un état de chose existant.
Nous avons en face de nous bien moins ceux qui sont volontairement méchants que l’armée innombrable des indifférents par paresse intellectuelle, et surtout des hommes intéressés au maintien de l’État actuel. Mais c’est précisément le fait que cette âpre lutte paraît sans espoir, qui donne à notre tâche sa grandeur et constitue notre meilleure chance de succès. Le cri de guerre qui dès l’abord effraie, ou bientôt décourage les âmes faibles sera le signal du rassemblement des natures réellement combatives. Et il faut qu’on s’en rende compte : quand, au sein d’un peuple, s’unissent, pour poursuivre un seul but, un certain nombre d’hommes doués au plus haut degré d’énergie et de force active, et qu’ils sont ainsi définitivement dégagés de la paresse où s’engourdissent les masses, ces quelques hommes deviennent les maîtres de l’ensemble du peuple. L’histoire du monde est faite par les minorités, chaque fois que les minorités de nombre incarnent la majorité de la volonté et de la décision.
C’est pourquoi ce qui peut paraître aujourd’hui à beaucoup une aggravation de notre tâche, est, en réalité, la condition nécessaire de notre victoire. C’est précisément parce que la tâche est grande et pénible que nous trouverons vraisemblablement les meilleurs champions pour mener notre combat. Cette élite nous garantit le succès.
* * *
La nature corrige d’ordinaire par des dispositions appropriées l’effet des mélanges qui altèrent la pureté des races humaines. Elle se montre peu favorable aux métis. Les premiers produits de ces croisements ont durement à souffrir, parfois jusqu’à la troisième, quatrième et cinquième génération. Ce qui faisait la valeur de l’élément primitif supérieur participant au croisement, leur est refusé ; en outre, le défaut d’unité de sang implique la discordance des volontés et des énergies vitales. Dans tous les moments critiques où l’homme de race pure prend des décisions sages et cohérentes, le sang-mêlé perd la tête ou ne prend que des demi-mesures. Le résultat, c’est que ce dernier se laisse dominer par l’homme de sang pur et que, dans la pratique, il est exposé à une disparition plus rapide. Dans des circonstances où la race résiste victorieusement, le métis succombe ; on pourrait citer de ce fait d’innombrables exemples. C’est là que l’on peut voir la correction apportée par la nature. Mais il lui arrive souvent d’aller encore plus loin ; elle met des limites à la reproduction ; elle rend stériles les croisements multipliés et les fait ainsi disparaître.
Si, par exemple, un individu de race donnée s’unissait au représentant d’une race inférieure, le résultat du croisement serait un abaissement du niveau en soi et, en outre, une descendance plus faible que les individus de race demeurée pure au milieu desquels elle devrait vivre. Au cas où tout nouvel apport du sang de la race supérieure serait empêché, les continuels croisements donneraient naissance à des métis que leur force de résistance, sagement amoindrie par la nature, condamnerait à une prompte disparition ; ou bien il se formerait, au cours de millénaires, un nouvel amalgame dans lequel les éléments primitifs, radicalement mélangés par des croisements multiples, ne seraient plus reconnaissables ; il se constituerait ainsi un nouveau peuple doué d’une certaine capacité de résistance grégaire, mais dont la valeur intellectuelle et artistique serait très inférieure à celle de la race supérieure ayant participé au premier croisement. Mais même dans ce dernier cas, ce produit hybride succomberait dans la lutte pour la vie, contre une race supérieure dont le sang serait resté pur. La solidarité grégaire, développée au cours de milliers d’années, et qui assurerait la cohésion de ce nouveau peuple serait – si grande soit-elle, par suite de l’abaissement du niveau de la race et de l’amoindrissement de la faculté d’adaptation et des capacités créatrices – incapable de permettre une résistance victorieuse aux attaques d’une race pure, unie elle aussi, et supérieure en développement intellectuel et en civilisation.
On peut donc énoncer le principe suivant :
Tout croisement de race amène fatalement, tôt ou tard, la disparition des hybrides qui en résultent, tant qu’ils se trouvent en présence de l’élément supérieur ayant participé au croisement et qui a conservé l’unité que confère la pureté du sang. Le danger pour l’hybride ne cesse qu’avec le métissage du dernier élément individuel de la race supérieure.
Telle est la source de la régénération progressive, bien que lente, effectuée par la nature, qui élimine peu à peu les produits de l’altération des races, pourvu qu’il existe encore une souche de race pure et qu’il ne se produise plus de nouveaux métissages.
Ce phénomène peut se manifester de lui-même chez des êtres doués d’un puissant instinct de race, que des circonstances particulières ou quelque contrainte spéciale ont rejeté hors de la voie normale de multiplication maintenant la pureté de la race. Sitôt que cesse la contrainte, l’élément resté pur tend immédiatement à revenir à l’accouplement entre égaux, ce qui met un terme à tout croisement ultérieur. Les produits du métissage se retirent alors d’eux-mêmes à l’arrière-plan, à moins que leur nombre soit devenu si grand que les éléments de race pure ne puissent songer à leur résister.
L’homme, devenu sourd aux suggestions de l’instinct et méconnaissant les obligations que lui a imposées la nature, ne doit pas compter sur les corrections qu’elle apporte, tant qu’il n’aura pas remplacé par les clartés de l’intelligence les suggestions de l’instinct perdu ; c’est donc à l’intelligence d’accomplir le travail de régénération nécessaire. Mais il est fort à craindre que l’homme, une fois aveuglé, ne continue à abattre les barrières qui séparent les races, jusqu’à ce que soit définitivement perdu ce qu’il y avait de meilleur en lui. Il ne restera alors qu’une sorte de bouillie unitaire dont les fameux réformateurs que nous entendons aujourd’hui font leur idéal ; mais ce mélange informe signifierait la mort de tout idéal en ce monde. Je le reconnais : on pourrait ainsi former un grand troupeau, on pourrait fabriquer par cette pot-bouille un animal grégaire, mais d’un semblable mélange ne sortira jamais un homme qui soit un pilier de la civilisation ou mieux encore un fondateur et un créateur de civilisation. On pourrait estimer alors que l’humanité a définitivement failli à sa mission.
Si l’on ne veut pas que la Terre tombe dans cet état, on doit se rallier à l’idée que la mission des États germaniques est, avant tout, de veiller à ce que cesse absolument tout nouveau métissage.
La génération des pleutres qui se sont signalés à l’attention de nos contemporains, va naturellement pousser des cris à l’énoncé de cette thèse et se plaindre, en gémissant, de ce que je porte la main sur les sacro- saints droits de l’homme. Non, l’homme n’a qu’un droit sacré et ce droit est en même temps le plus saint des devoirs, c’est de veiller à ce que son sang reste pur, pour que la conservation de ce qu’il y a de meilleur dans l’humanité rende possible un développement plus parfait de ces êtres privilégiés.
Un État raciste doit donc, avant tout, faire sortir le mariage de l’abaissement où l’a plongé une continuelle adultération de la race et lui rendre la sainteté d’une institution, destinée à créer des êtres à l’image du Seigneur et non des monstres qui tiennent le milieu entre l’homme et le singe.
Les protestations que, pour des raisons dites d’humanité, on peut élever contre ma thèse, sont diablement peu justifiées à une époque qui, d’une part, offre à tous les dégénérés la possibilité de se multiplier
– et impose ainsi à leurs descendants ainsi qu’aux contemporains des souffrances indicibles – pendant qu’on peut acheter dans toutes les drogueries, et même aux colporteurs, des préparations permettant, même aux parents les plus sains, de ne pas avoir d’enfants. Dans l’État qui, de nos jours, assure le calme et le bon ordre, à ce que croient ses défenseurs, les braves nationaux-bourgeois, ce serait un crime de retirer la faculté de procréer aux syphilitiques, tuberculeux, aux êtres atteints de tares héréditaires, ou contrefaits, aux crétins ; par contre, enlever à des millions d’êtres des plus sains la faculté de procréer n’est pas considéré comme une mauvaise action et ne choque pas les bonnes mœurs de cette société hypocrite, mais flatte même sa myopie et sa paresse intellectuelles. Car autrement on devrait se torturer le cerveau pour trouver le moyen de faire subsister et de conserver les individus qui sont la santé de notre peuple et de qui naîtra la génération future.
Comme tout ce système actuel manque d’idéal et de noblesse ! On ne s’inquiète plus d’élever les meilleurs dans l’intérêt de la postérité ; on laisse les choses suivre leur cours. Il est tout à fait conforme à la ligne de conduite actuelle de nos Églises qu’elles pèchent contre le respect dû à l’homme, image du Seigneur, ressemblance sur laquelle elles insistent tant ; elles parlent toujours de l’Esprit et laissent déchoir au rang de prolétaire dégénéré le réceptacle de l’Esprit. Puis on s’étonne avec un air stupide du peu d’influence qu’a la foi chrétienne dans son propre pays, de l’épouvantable « irréligion » de cette misérable canaille dégradée physiquement et dont le moral est naturellement tout aussi gâté ; et l’on se dédommage en prêchant avec succès la doctrine évangélique aux Hottentots et aux Cafres. Tandis que nos peuples d’Europe, à la plus grande louange et gloire de Dieu, sont rongés d’une lèpre morale et physique, le pieux missionnaire s’en va dans l’Afrique centrale et fonde des missions pour les nègres, jusqu’à ce que notre « civilisation supérieure » ait fait de ces hommes sains, bien que primitifs et arriérés, une engeance de mulâtres fainéants.
Nos deux confessions chrétiennes répondraient bien mieux aux plus nobles aspirations humaines si, au lieu d’importuner les nègres avec des missions dont ils ne souhaitent ni ne peuvent comprendre l’enseignement, elles voulaient bien faire comprendre très sérieusement aux habitants de l’Europe que les ménages de mauvaise santé feraient une œuvre bien plus agréable à Dieu, s’ils avaient pitié d’un pauvre petit orphelin sain et robuste et lui tenaient lieu de père et de mère, au lieu de donner la vie à un enfant maladif qui sera pour lui-même et pour les autres une cause de malheur et d’affliction.
L’État raciste aura à réparer les dommages causés par tout ce qu’on néglige de faire aujourd’hui dans ce domaine. Il devra faire de la race le centre de la vie de la communauté ; veiller à ce qu’elle reste pure ; déclarer que l’enfant est le bien le plus précieux d’un peuple. Il devra prendre soin que, seul, l’individu sain procrée des enfants ; il dira qu’il n’y a qu’un acte honteux : mettre au monde des enfants quand on est maladif et qu’on a des tares, et que l’acte le plus honorable est alors d’y renoncer. Inversement, il professera que refuser à la nation des enfants robustes est un acte répréhensible. L’État doit intervenir comme ayant le dépôt d’un avenir de milliers d’années au prix duquel les désirs et l’égoïsme de l’individu sont tenus pour rien et devant lequel ils doivent s’incliner ; il doit utiliser les ressources de la médecine la plus moderne pour éclairer sa religion ; il doit déclarer que tout individu notoirement malade ou atteint de tares héréditaires, donc transmissibles à ses rejetons, n’a pas le droit de se reproduire et il doit lui en enlever matériellement la faculté. Inversement, il doit veiller à ce que la fécondité de la femme saine ne soit pas limitée par l’infecte politique financière d’un système de gouvernement qui fait, de ce don du ciel qu’est une nombreuse postérité, une malédiction pour les parents. Il doit mettre un terme à cette indifférence paresseuse, et même criminelle, qu’on témoigne aujourd’hui pour des conditions sociales permettant la formation de familles prolifiques, et se sentir le protecteur suprême de ce bien inappréciable pour un peuple. Son attention doit se porter sur l’enfant plus que sur l’adulte.
Celui qui n’est pas sain, physiquement et moralement, et par conséquent n’a pas de valeur au point de vue social, ne doit pas perpétuer ses maux dans le corps de ses enfants. L’État raciste a une tâche énorme à accomplir au point de vue de l’éducation. Mais cette tâche paraîtra plus tard quelque chose de plus grand que des guerres victorieuses de notre époque bourgeoise actuelle. L’État doit faire comprendre à l’individu, par l’éducation, que ce n’est pas une honte, mais un malheur digne de pitié, d’être maladif et faible, mais que c’est un crime par contre, et une honte, de déshonorer ce malheur par son égoïsme en le faisant retomber sur un être innocent : que, par ailleurs, c’est témoigner d’une disposition d’esprit vraiment noble et des sentiments humains les plus admirables, quand l’individu, souffrant d’une maladie dont il n’est pas responsable, renonce à avoir des enfants et reporte son affection et sa tendresse sur un jeune rejeton indigent de sa race, dont l’état de santé fait prévoir qu’il sera un jour un membre robuste d’une communauté vigoureuse. En accomplissant cette tâche éducatrice, l’État prolonge, au point de vue moral, son activité pratique. Il ne s’inquiétera pas de savoir s’il est compris ou non, approuvé ou blâmé, pour agir suivant ces principes.
Si, pendant six cents ans, les individus dégénérés physiquement ou souffrant de maladies mentales étaient mis hors d’état d’engendrer, l’humanité serait délivrée de maux d’une gravité incommensurable ; elle jouirait d’une santé dont on peut aujourd’hui se faire difficilement une idée. En favorisant consciemment et systématiquement la fécondité des éléments les plus robustes de notre peuple, on obtiendra une race dont le rôle sera, du moins tout d’abord, d’éliminer les germes de la décadence physique et, par suite, morale, dont nous souffrons aujourd’hui.
Car, lorsqu’un peuple et un État se seront engagés dans cette voie, on se préoccupera tout naturellement de développer la valeur de ce qui constitue la moelle la plus précieuse de la race et d’augmenter sa fécondité pour qu’enfin toute la nation participe à ce bien suprême : une race obtenue selon les règles de l’eugénisme.
Pour y parvenir, il faut avant tout qu’un État n’abandonne pas au hasard le soin de coloniser les régions nouvellement acquises, mais qu’il soumette cette colonisation à des règles déterminées. Des commissions de race, constituées spécialement, doivent délivrer aux individus un permis de colonisation ; une pureté de race définie, et dont il faudra donner des preuves, sera la condition posée à l’obtention de ce permis. C’est ainsi que pourront être fondées peu à peu des colonies marginales dont les colons seront exclusivement des représentants de la race la plus pure et doués, par conséquent, des facultés les plus éminentes de cette race. Ces colonies seront, pour toute la nation, un précieux trésor national ; leur développement remplira de fierté et de joyeuse assurance tout membre de la communauté, puisqu’elles contiendront le germe d’un heureux développement futur du peuple lui-même et aussi de l’humanité.
Il appartiendra aux conceptions racistes mises en œuvre dans l’État raciste de faire naître cet âge meilleur : les hommes ne s’attacheront plus alors à améliorer par l’élevage les espèces canines, chevalines ou félines ; ils chercheront à améliorer la race humaine ; à cette époque de l’histoire de l’humanité, les uns, ayant reconnu la vérité, sauront faire abnégation en silence, les autres feront le don joyeux d’eux-mêmes.
Que cet état d’esprit soit possible, on ne peut le nier dans un monde où des centaines de milliers d’hommes s’imposent volontairement le célibat, sans y être contraints et obligés autrement que par une loi religieuse.
Pourquoi un semblable renoncement serait-il impossible si, à la place d’un commandement de l’Église, intervenait un avertissement solennel invitant les hommes à mettre enfin un terme au vrai péché originel, aux conséquences si durables, et à donner au Créateur tout-puissant des êtres tels que lui-même les a d’abord créés ?
Certes, le lamentable troupeau des petits bourgeois d’aujourd’hui ne pourra jamais comprendre cela. Ils riront ou lèveront leurs épaules mal faites, et ils répéteront en soupirant l’excuse qu’ils donnent toujours : « Ce serait très beau en principe, mais c’est impossible ! » Avec eux c’est, en effet, impossible ; leur monde n’est pas fait pour cela. Ils n’ont qu’un souci : leur propre vie ; et qu’un Dieu : leur argent ! Seulement, ce n’est pas à eux que nous nous adressons, c’est à la grande armée de ceux qui sont trop pauvres pour que leur propre vie leur paraisse le plus grand bonheur qu’il y ait au monde, à ceux qui ne regardent pas l’or comme le maître qui règle leur existence, mais qui croient à d’autres dieux. Nous nous adressons avant tout à la puissante armée de notre jeunesse allemande. Elle grandit à une époque qui est un grand tournant de l’histoire, et la paresse et l’indifférence de leurs pères la forcent à combattre. Les jeunes Allemands seront un jour les architectes d’un nouvel État raciste ou bien ils seront les derniers témoins d’un complet effondrement, de la mort du monde bourgeois.
Car, lorsqu’une génération souffre de défauts qu’elle reconnaît et auxquels elle se résigne même, se bornant, comme le fait aujourd’hui notre monde bourgeois, de l’excuse facile qu’il n’y a rien à faire pour y remédier, un pareil monde est voué à la ruine. Ce qui caractérise notre société bourgeoise, c’est qu’elle ne peut plus nier ces défauts. Elle est forcée d’avouer qu’il y a beaucoup de choses pourries et mauvaises, mais elle n’est plus capable de se décider à réagir contre le mal ; elle n’a plus la force de mobiliser un peuple de soixante ou soixante-dix millions d’hommes et de lui inspirer l’énergie désespérée avec laquelle il devrait faire les derniers efforts pour parer au danger. Bien au contraire : quand une telle campagne est entreprise dans un autre pays, elle ne lui inspire que des commentaires imbéciles et on cherche à montrer que, théoriquement, la tentative ne saurait réussir, que son succès est proprement inconcevable. Il n’y a pas d’arguments, aussi idiots qu’ils puissent être, qui ne soient mis en avant pour justifier la passivité de ces nains et leur faiblesse intellectuelle et morale. Lorsque, par exemple, tout un continent déclare enfin la guerre à l’intoxication par l’alcool, pour arracher tout un peuple à ce vice dévastateur, le monde bourgeois en Europe n’a d’autre réflexe que d’ouvrir de grands yeux stupides, de secouer la tête d’un air de doute, ou de trouver d’un air supérieur que tout cela est ridicule – opinion qui va particulièrement bien à cette ridicule société. Mais quand toutes ces simagrées n’ont pas d’effet et que, quelque part dans le monde, on s’attaque à la noble et inviolable routine, et même avec succès, nos petits bourgeois s’efforcent, nous l’avons déjà dit, de mettre au moins en doute ce succès et d’en diminuer l’importance, sans craindre même d’invoquer les principes de la morale bourgeoise contre une campagne qui cherche à débarrasser le monde de la pire immoralité.
Non, nous devons tous ne nous faire aucune illusion sur ce point : notre bourgeoisie actuelle ne peut d’ores et déjà servir à rien pour aucune des nobles tâches qui incombent à l’humanité ; sans le moindre fond, elle est aussi par trop vile, moins – à mon avis – par méchanceté que par une incroyable indolence et par tout de ce qui en résulte. C’est pourquoi ces clubs politiques qui vivotent sous la dénomination de « partis bourgeois », ne sont plus, depuis longtemps, que des associations d’intérêts formées par certains groupements professionnels et certaines classes ; et leur but principal est de défendre le mieux possible les intérêts les plus égoïstes. Il est évident qu’une pareille corporation de « bourgeois » politiciens est rien moins que capable de mener un combat, surtout quand l’adversaire se recrute non pas parmi de prudents sacs d’écus, mais dans ces masses prolétariennes, poussées à la révolte par les excitations les plus violentes et décidées à tout.
* * *
Si nous nous rendons compte de ce fait : le premier devoir de l’État, qui est au service du peuple et n’a en vue que le bien de celui-ci, est de conserver les meilleurs éléments de la race, d’en avoir soin et de favoriser leur développement, alors nous conclurons logiquement que sa tâche ne se borne pas à faire naître des rejetons dignes du peuple et de la race, mais qu’il doit encore leur donner une éducation qui en fera plus tard des membres utiles de la communauté et capables de contribuer à son accroissement.
Comme, dans l’ensemble, le rendement intellectuel des individus est directement fonction des qualités de race du matériel humain donné, l’éducation de chacun doit avoir pour tout premier but l’entretien et le développement de la santé physique. Car, dans la majorité des cas, un esprit sain et énergique ne se trouve que dans un corps sain et vigoureux. Le fait que des hommes de génie sont parfois d’une constitution peu robuste, ou même maladive, n’infirme pas ce principe. Il s’agit alors d’exceptions qui, comme partout, confirment la règle. Mais quand un peuple se compose en majorité d’hommes physiquement dégénérés, il est extrêmement rare qu’un esprit vraiment grand surgisse de ce marécage. Son influence ne connaîtra, en tous cas, jamais un grand succès. Ou bien cette plèbe de dégénérés sera incapable de le comprendre, ou bien sa force de volonté sera trop affaiblie pour qu’elle puisse suivre cet aigle dans son essor.
L’État raciste, conscient de cette vérité, ne croira pas que sa tâche éducatrice se borne à faire entrer dans les cerveaux la science à coups de pompe ; il s’attachera à obtenir, par un élevage approprié, des corps foncièrement sains. La culture des facultés intellectuelles ne viendra qu’en seconde ligne. Mais ici même le but principal sera la formation du caractère, notamment le développement de la force de volonté et de la capacité de décision ; on habituera en même temps les jeunes gens à prendre avec joie la responsabilité de leurs actes. L’instruction proprement dite ne viendra qu’en dernier lieu.
L’État raciste doit partir du principe qu’un homme dont la culture scientifique est rudimentaire, mais de corps sain, de caractère honnête et ferme, aimant à prendre une décision, et doué de force de volonté, est un membre plus utile à la communauté nationale qu’un infirme, quels que soient ses dons intellectuels. Un peuple de savants dégénérés physiquement, de volonté faible, et professant un lâche pacifisme, ne pourra jamais conquérir le ciel ; il ne sera même pas capable d’assurer son existence sur cette terre. Il est rare que, dans le dur combat que nous impose le destin, ce soit le moins savant qui succombe ; le vaincu est toujours celui qui tire de son savoir les décisions les moins viriles et qui les met en pratique de la façon la plus pitoyable. Enfin une certaine harmonie doit exister entre le physique et le moral. Un corps gangrené n’est pas le moins du monde rendu plus beau par le rayonnement de l’esprit, et même il serait injuste de donner la formation intellectuelle la plus complète à des hommes mal venus ou estropiés, dont le manque d’énergie et de caractère ferait des êtres indécis et lâches. Ce qui rend immortel l’idéal de beauté conçu par les Grecs, c’est la merveilleuse alliance de la plus splendide beauté physique avec l’éclat de l’esprit et la noblesse de l’âme.
Si le mot de Moltke est vrai : « La chance ne suit que le mérite », certainement aussi pour les rapports du corps et de l’esprit : un esprit sain n’habite en général à demeure qu’un corps sain.
Rendre les corps robustes n’est donc pas, dans un État raciste, l’affaire des individus ; ce n’est pas non plus une question qui regarde en premier lieu les parents, et en deuxième ou troisième lieu seulement l’ensemble des citoyens : c’est une nécessité de la conservation du peuple que représente et protège l’État. De même qu’en ce qui touche l’instruction, l’État empiète déjà sur le droit de libre détermination de l’individu, et lui oppose le droit de la collectivité, soumettant l’enfant à l’instruction obligatoire, sans tenir compte da la volonté des parents – l’État raciste doit, dans une plus grande mesure encore, faire triompher son autorité contre l’ignorance ou l’incompréhension des individus dans les questions qui intéressent la sauvegarde de la nation. Il lui faut organiser son action éducatrice de telle sorte que le corps des jeunes gens soit traité dès la plus tendre enfance en vue du but poursuivi et reçoive la trempe dont il aura besoin plus tard. Il doit particulièrement veiller à ne pas former une génération élevée en serre chaude.
C’est d’abord près des jeunes mères que doit s’exercer cette œuvre d’éducation et d’hygiène. Quelques dizaines d’années d’efforts ont bien obtenu ce résultat de rendre les accouchements complètement aseptiques et les cas de fièvre puerpérale extrêmement rares ; il doit être et sera possible, en faisant à fond l’éducation des gardes et des mères elles-mêmes, de parvenir à donner aux enfants, dès leurs premières années, des soins tels que leur croissance ultérieure se fasse dans les meilleures conditions.
Dans un État raciste, l’école consacrera infiniment plus de temps aux exercices physiques. Il ne convient pas de surcharger les jeunes cerveaux d’un bagage inutile ; l’expérience nous apprend qu’ils n’en conservent que des fragments et, en outre, qu’il leur en reste non pas l’essentiel, mais des détails secondaires et inutilisables ; un jeune enfant est, en effet, incapable de faire un tri raisonné des matières qu’on lui a comme entonnées. Consacrer, comme on le fait actuellement, deux courtes heures du programme hebdomadaire des écoles secondaires à la gymnastique et, par-dessus le marché, rendre la présence des élèves facultative, c’est commettre une lourde erreur, même au point de vue de la formation purement intellectuelle. Il ne devrait pas se passer de jour où le jeune homme ne se livre, au moins une heure matin et soir, à des exercices physiques, dans tous les genres de sport et de gymnastique. Il ne faut pas notamment négliger un sport, la boxe, qui, aux yeux de très nombreux soi-disant « racistes », est brutal et vulgaire. On ne saurait croire combien d’opinions fausses sont répandues à cet égard dans les milieux « cultivés ». Que le jeune homme apprenne l’escrime, puis passe son temps à se battre en duel, voilà qui passe pour tout naturel et respectable, mais la boxe, c’est forcément brutal ! Pourquoi ? Il n’y a pas de sport qui, autant que celui-là, développe l’esprit combatif, exige des décisions rapides comme l’éclair et donne au corps la souplesse et la trempe de l’acier. Il n’est pas plus brutal, pour deux jeunes gens, de vider à coups de poing une querelle née d’une divergence d’opinions que de le faire avec une lame bien aiguisée. Il n’est pas plus vil, pour un homme attaqué, de repousser son agresseur avec ses poings que de prendre la fuite en appelant la police à son secours. Mais, avant tout, le garçon jeune et sain de corps doit apprendre à supporter les coups. Ce principe paraîtra naturellement, à nos champions de l’esprit, digne d’un sauvage. Mais l’État raciste n’a pas précisément pour rôle de faire l’éducation d’une colonie d’esthètes pacifistes et d’hommes physiquement dégénérés. L’image idéale qu’il se fait de l’humanité n’a pas pour types l’honorable petit bourgeois et la vieille fille vertueuse, mais bien des hommes doués d’une énergie virile et hautaine, et des femmes capables de mettre au monde de vrais hommes.
Ainsi le sport n’est pas destiné seulement à rendre l’individu fort, adroit et hardi, mais il doit aussi l’endurcir et lui apprendre à supporter épreuves et revers.
Si toute la classe supérieure de nos intellectuels n’avait pas été exclusivement instruite de ce qui est convenable et distingué, si, en revanche, elle avait appris la boxe, une révolution allemande, faite par des souteneurs, des déserteurs et autres pareilles crapules, n’aurait pas été possible ; car cette révolution a dû son succès non pas à la hardiesse et au courage de ses auteurs, mais à la lâche et lamentable indécision de ceux qui gouvernaient l’État et qui en étaient les chefs responsables. C’est que tous ceux qui nous dirigeaient intellectuellement n’avaient reçu qu’une formation « intellectuelle » et se trouvèrent désarmés au moment où la partie adverse employa, au lieu d’armes intellectuelles, de solides barres de fer. Tout cela fut possible seulement parce que nos écoles supérieures avaient pour principe de former non pas des hommes, mais des fonctionnaires, des ingénieurs, des techniciens, des chimistes, des juristes, des littérateurs et, pour que cette intellectualité ne mourût pas, des professeurs.
Au point de vue intellectuel, nos dirigeants ont obtenu des résultats éblouissants, mais quand il a fallu faire preuve de volonté ils se sont révélés au-dessous de tout.
Il est sûr que l’éducation est incapable de faire un homme courageux d’un homme foncièrement lâche, mais il est également sûr qu’un homme, même doué par la nature de quelque courage, ne pourra développer ses facultés, si les défauts de son éducation l’ont mis en état d’infériorité en ce qui concerne sa force et son adresse corporelles. C’est à l’armée qu’on peut voir à quel point la conscience de ses ressources physiques peut développer chez un homme le courage et même l’esprit combatif. On n’y trouve pas que des héros : le type moyen y est largement représenté. Pourtant l’excellent entraînement du soldat allemand pendant le temps de paix inocula à tout ce gigantesque organisme une confiance en soi dont nos adversaires n’avaient pas soupçonné la force. Les preuves immortelles de bravoure et d’allant que les armées allemandes donnèrent pendant toute la fin de l’été et tout l’automne de 1914, au cours de leur marche en avant, quand elles balayaient tout devant elles, furent le résultat de cette éducation infatigablement poursuivie. Pendant les interminables années de paix, elle avait habitué des corps souvent peu robustes aux performances les plus incroyables et avait donné aux soldats cette confiance en soi que les épouvantes des plus terribles batailles ne pouvaient détruire.
Notre peuple allemand, aujourd’hui brisé et gisant, et livré sans défense aux coups de pied du reste du monde, a justement besoin de cette force, née de l’autosuggestion, que donne la confiance en soi. Mais cette confiance en soi doit être donnée aux enfants de notre peuple par l’éducation dès leurs premières années. Tout le système d’éducation et de culture doit viser à leur donner la conviction qu’ils sont absolument supérieurs aux autres peuples. La force et l’adresse corporelles doivent leur rendre la foi en l’invincibilité du peuple auquel ils appartiennent. Ce qui a conduit autrefois l’armée allemande à la victoire, c’était la somme de confiance que chaque soldat avait en lui- même et que tous avaient en ceux qui les commandaient. Ce qui remettra debout le peuple allemand, ce sera la conviction de pouvoir reconquérir sa liberté. Mais cette conviction ne sera que le résultat d’une conviction identique chez des millions d’individus.
Qu’on ne se fasse pas, ici non plus, d’illusions : Énorme a été l’effondrement de notre peuple ; énormes aussi devront être nos efforts pour mettre terme un jour à sa détresse. Celui qui croit que l’actuel travail d’éducation bourgeois pratiqué sur notre peuple en vue du calme et du bon ordre, lui donnera la force de faire cesser un jour l’état de choses actuel, cause de notre ruine, et de lancer au visage de nos adversaires nos chaînes d’esclaves, celui-là se trompe amèrement. Ce n’est que par un excès d’énergie nationale, de soif de liberté et d’ardeur passionnée que nous compenserons tout ce qui nous manquait.
* * *
L’habillement des jeunes gens doit aussi être adapté au but poursuivi. Il est vraiment lamentable de voir notre jeunesse sacrifier à une mode stupide qui donne un sens péjoratif au vieux proverbe : « L’habit fait le moine ».
Justement chez les jeunes gens, l’habillement doit être mis au service de l’éducation. Le jeune homme qui, en été, se promène en pantalons longs, dans un vêtement fermé jusqu’au cou, est de ce fait peu enclin à se livrer à un exercice physique. Car, disons-le ouvertement, il faut aussi faire appel, non seulement à l’ambition, mais aussi à la vanité ; non pas à la vanité d’avoir de beaux vêtements que tout le monde ne peut pas s’acheter, mais à l’orgueil d’un beau corps bien fait, ce à quoi chacun peut travailler.
Cette considération jouera aussi plus tard son rôle. La jeune fille doit connaître son cavalier. Si la beauté corporelle n’était pas de nos jours si complètement reléguée au second plan par la niaiserie de la mode, des centaines de milliers de jeunes filles ne se laisseraient pas séduire par de repoussants bâtards juifs aux jambes torses. Il est aussi de l’intérêt de la nation que se trouvent les plus beaux corps pour faire don à la race d’une nouvelle beauté.
C’est aujourd’hui une nécessité des plus urgentes, parce que l’instruction militaire fait défaut et qu’ainsi a été supprimée la seule institution qui, en temps de paix, réparait en partie les négligences de notre mode d’éducation. Ses avantages ne se bornaient pas à la formation de l’individu même, mais exerçaient aussi une heureuse influence sur les rapports des deux sexes. La jeune fille préférait le soldat à celui qui n’entrait pas dans l’armée.
L’État raciste n’a pas seulement à veiller au développement des forces corporelles pendant les années d’école, il doit aussi s’en occuper pendant la période post scolaire, tant que les jeunes gens n’ont pas achevé leur croissance, afin que celle-ci se fasse dans d’heureuses conditions. Il est absurde de croire que le droit de surveillance sur ses jeunes citoyens cesse pour l’État au moment où ils quittent l’école, pour ne rentrer en vigueur qu’au moment où ils font leur service militaire. Ce droit est, en réalité, un devoir permanent. L’État actuel, qui se soucie peu d’avoir des citoyens en bonne santé, a négligé ce devoir d’une façon criminelle. Il laisse aujourd’hui la jeunesse se dépraver dans les rues et les lieux de débauche, au lieu de la tenir en main et de prendre soin de sa formation physique jusqu’au moment où il aura obtenu des adultes sains et robustes.
La question de savoir sous quelle forme précise l’État organisera l’éducation postscolaire est, pour le moment, sans importance ; l’essentiel est qu’il le fasse ; il en cherchera les voies et moyens. L’État raciste doit tenir le développement physique des jeunes gens, dans la période post scolaire, pour une de ses attributions, au même titre que leur développement intellectuel, et il doit l’assurer par des institutions d’État. L’éducation physique pourra être, dans ses grandes lignes, une préparation au service militaire. L’armée n’aura plus alors besoin, comme autrefois, d’apprendre au jeune homme les rudiments du règlement de manœuvre ; elle ne recevra plus des recrues dans le sens actuel du terme ; elle n’aura plus qu’à transformer en soldat un jeune homme ayant déjà reçu une préparation physique parfaite.
Dans l’État raciste, l’armée ne sera donc plus obligée d’apprendre à l’individu à marcher et à se tenir au port d’armes ; elle sera une école supérieure d’éducation patriotique. La jeune recrue recevra au régiment l’instruction militaire nécessaire, mais on continuera en même temps à la préparer au rôle qu’elle aura à remplir plus tard dans la vie. Le principal objectif de l’éducation militaire doit rester pourtant ce qu’il était déjà dans l’ancienne armée et ce qui faisait la plus grande valeur de cette dernière : cette école doit faire du jeune garçon un homme ; elle ne doit pas lui apprendre seulement à obéir, mais le rendre capable de commander un jour ; il apprendra à se taire, non seulement quand il reçoit un blâme justifié, mais aussi à supporter l’injustice en silence.
Il doit, en outre, confiant en sa propre force, conquis, comme chacun, par l’esprit de corps, se convaincre que son peuple est invincible.
Le soldat ayant accompli son temps de service recevra deux documents : un diplôme de citoyen, c’est- à-dire une pièce légale lui permettant d’exercer un emploi public, et un certificat de bonne santé, attestant qu’il est physiquement apte au mariage.
Comme il le fait pour les garçons, l’État raciste dirigera l’éducation des filles, et d’après les mêmes principes. Là aussi l’importance principale doit être attachée à la formation physique ; après seulement viendra l’éducation du caractère, enfin, en dernier lieu, le développement des dons intellectuels. Il ne faut jamais perdre de vue que le but de l’éducation féminine doit être de préparer à son rôle la mère future.
* * *
C’est en deuxième lieu seulement que l’État raciste devra favoriser, sous toutes ses formes, la formation du caractère.
Il est incontestable que les traits essentiels du caractère de chacun sont arrêtés d’avance : un égoïste l’est et le restera toujours, de même qu’un idéaliste sera toujours foncièrement idéaliste. Mais, entre ces types extrêmes de caractères frappés sans bavures, se trouvent des millions d’exemplaires dont l’empreinte est floue et difficile à déchiffrer. Le criminel né restera un criminel ; mais beaucoup d’hommes qui ne révèlent qu’une certaine propension à des actes criminels, peuvent, par une éducation appropriée, devenir des membres utiles de la communauté ; inversement des caractères indécis et chancelants peuvent devenir de mauvais éléments, si leur éducation a été défectueuse.
Combien de fois s’est-on plaint pendant la guerre du peu de discrétion de notre peuple ! Quelles difficultés n’a-t-on pas eues, par suite de ce défaut, pour soustraire à la connaissance de l’ennemi des secrets même importants ! Mais posons-nous la question : En quoi l’éducation donnée au peuple allemand, avant la guerre, pouvait-elle le rendre discret ? Est-ce que, dès l’école, le petit rapporteur n’était pas souvent préféré à ses camarades moins bavards ? Est-ce que la dénonciation n’était pas, et n’est pas encore, considérée comme de la « franchise », et la discrétion comme un honteux entêtement ? S’est-on donné la peine de présenter aux enfants la discrétion comme une vertu précieuse et virile ? Non, car aux yeux de nos pédagogues modernes tout cela n’est que bagatelles. Mais ces bagatelles coûtent à l’État d’innombrables millions en frais de justice, puisque 90 pour 100 des procès pour diffamation ou motifs analogues résultent de ce manque de discrétion. Des propos tenus sans qu’on en prenne la responsabilité sont répétés aussi légèrement ; les intérêts économiques de notre peuple sont continuellement lésés, parce qu’on révèle étourdiment d’importants procédés de fabrication, etc. ; même les préparatifs secrets pour la défense du pays sont rendus vains, parce que notre peuple n’a pas appris à se taire, et répète tout ce qu’il a entendu dire. En temps de guerre, cette manie du bavardage peut faire perdre des batailles et porter presque tout le poids de l’issue malheureuse de la lutte. On doit être persuadé, en cette matière, que l’on ne peut remédier, dans l’âge mûr, à l’absence d’une formation précoce. Un maître ne doit pas, par exemple, chercher par principe à connaître les mauvais tours de ses élèves, en encourageant les pires habitudes de dénonciation. La jeunesse forme un État à part, elle oppose à l’adulte une sorte de front solidaire, et cela est tout naturel. L’union que l’enfant de dix ans contracte avec les camarades de son âge est plus naturelle et plus forte que celle qui pourrait exister entre lui et l’adulte. L’enfant qui dénonce un camarade commet une trahison et manifeste ainsi une disposition d’esprit qui, qualifiée brutalement et transportée sur un terrain plus vaste, correspond à celle de l’homme coupable de haute trahison. Un tel enfant ne peut être considéré comme un brave et honnête garçon, mais comme un caractère peu estimable. Il peut être commode pour le maître de se servir de semblables défauts pour affermir son autorité, mais, ce faisant, il dépose dans de jeunes cœurs le germe d’une disposition d’esprit qui peut avoir plus tard des conséquences funestes. Il est arrivé plus d’une fois qu’un petit rapporteur devint une grande canaille.
Cela doit servir d’exemple à bien des gens.
Aujourd’hui le développement voulu de la noblesse de caractère joue à l’école un rôle quasi-nul. Il faudra qu’un jour on y attache une tout autre importance. Loyauté, abnégation, discrétion sont des vertus absolument nécessaires pour un grand peuple ; les développer et les porter à leur point de perfection par l’éducation donnée à l’école, a plus d’importance que bien des matières qui, de nos jours, remplissent nos plans d’études. Faire perdre aux enfants l’habitude des plaintes larmoyantes et des hurlements de douleur fait aussi partie de ce programme d’éducation. Quand les pédagogues oublient qu’ils doivent inculquer à l’enfant, et dès son plus jeune âge, l’habitude de supporter en silence souffrances et injustices, il ne faut pas s’étonner que plus tard, aux heures critiques – quand, par exemple, un homme est au front – la poste soit uniquement occupée à transmettre des lamentations et des piailleries réciproques. Si les écoles primaires avaient entonné dans le cerveau de notre jeunesse un peu moins de savoir, mais, en revanche, plus de maîtrise de soi-même, nous en aurions été largement récompensés de 1915 à 1918.
Ainsi l’État raciste doit, pour remplir sa tâche d’éducateur, attacher le plus grand prix à former les caractères en même temps que les corps. Beaucoup des défauts actuels de notre peuple peuvent être, sinon supprimés, du moins très atténués, par une telle méthode d’éducation.
* * *
Il est de la plus haute importance de développer la force de volonté et la capacité de décision, ainsi que la propension à assumer avec plaisir une responsabilité.
L’on admettait autrefois dans l’armée le principe qu’il vaut toujours mieux donner un ordre quelconque que de n’en pas donner du tout : il faut faire comprendre aux jeunes gens qu’une réponse quelconque vaut toujours mieux que pas de réponse du tout. La peur de donner une réponse fausse est plus infamante que l’erreur dans la réponse. On doit se fonder sur cet axiome pour habituer les jeunes gens à avoir le courage de leurs actions.
On s’est souvent plaint de ce qu’aux mois de novembre et décembre 1918 toutes les autorités aient perdu courage, que, du souverain au dernier divisionnaire, personne n’ait plus trouvé la force de prendre une décision de sa propre initiative. Ce terrible exemple doit être un solennel avertissement pour le nouveau système d’éducation, car cette catastrophe a seulement fait ressortir dans des proportions énormes ce qui existait partout à plus petite échelle. C’est le manque de volonté, et non le manque d’armes, qui nous rend aujourd’hui incapables d’une résistance sérieuse. Ce défaut d’énergie est ancré dans tout notre peuple, il le rend incapable de prendre toute décision comportant des risques ; comme si ce qui fait la grandeur d’un acte n’est pas précisément la part de risque qu’il renferme. Sans s’en douter, un général allemand a trouvé une formule classique pour exprimer cette lamentable absence de volonté : « Je n’agis, disait-il, que lorsque j’ai calculé avoir cinquante et une chances sur cent de réussir. » Ce « cinquante et un pour cent » explique le cas tragique de l’effondrement allemand ; celui qui demande au destin de lui garantir le succès, renonce par là même à faire acte d’héroïsme. Car ce dernier consiste, alors qu’on est convaincu qu’une situation représente un péril mortel, à faire la tentative qui peut conduire au succès. Un cancéreux en danger de mort n’a pas besoin de cinquante et une chances sur cent pour risquer l’opération. Même si celle-ci ne promet qu’un demi pour cent de chances de guérison, un homme courageux en courra le risque, sinon il n’a pas le droit de gémir sur sa mort prochaine.
Tout compte fait, cette lâche incapacité de vouloir et de prendre une décision, qui est la peste de notre époque, est surtout la conséquence de l’éducation radicalement fausse donnée à la jeunesse ; son influence néfaste persiste jusque chez l’adulte et trouve son point culminant dans le défaut de courage civil observé chez les hommes d’État au pouvoir.
On peut en dire autant de la peur des responsabilités qui sévit actuellement. Ce vice, dont l’éducation de la jeunesse est encore responsable, se manifeste dans toute la vie publique et atteint son immortelle apogée dans le régime parlementaire.
À l’école, on attache plus de prix à un aveu
« repentant » et à un « acte de contrition » qu’à un aveu libre et franc. Ce dernier, aux yeux de maint éducateur, est le signe manifeste d’une incurable dépravation et, si incroyable que cela paraisse, on prédit l’échafaud à plus d’un enfant, témoignant de dispositions qui seraient d’une inappréciable valeur, si elles étaient l’apanage de tout un peuple.
De même que l’État raciste devra un jour apporter toute son attention à l’éducation de la volonté et de l’esprit de décision, de même il lui faudra graver dans le cœur des jeunes gens, dès leur plus tendre enfance, le goût des responsabilités librement consenties, et le courage de leurs actions. Ce n’est que s’il conçoit l’importance et la nécessité de cette tâche que l’État raciste arrivera, après des siècles de cette éducation, à créer enfin un peuple affranchi des faiblesses qui ont contribué d’une manière aussi néfaste à notre décadence actuelle.
* * *
L’État raciste n’aura que quelques légères modifications à apporter à l’instruction donnée par l’école, instruction qui résume tout ce que l’État fait aujourd’hui pour l’éducation du peuple. Ces modifications seront de trois sortes.
Tout d’abord le cerveau des jeunes gens ne doit pas être surchargé de connaissances qui leur sont inutiles dans la proportion de quatre-vingt-quinze pour cent et qu’en conséquence ils oublieront bientôt. Les programmes des écoles primaires et secondaires, particulièrement, sont de nos jours un absurde fatras ; dans la plupart des cas, la pléthore des matières enseignées est telle que le cerveau des élèves n’en peut garder que des fragments et que, seul encore, un fragment de cette masse de connaissances peut trouver son emploi ; d’autre part, elles restent insuffisantes pour celui qui embrasse une profession déterminée et est obligé de gagner son pain. Adressez-vous, par exemple, à un fonctionnaire du type courant, qui a subi avec succès l’examen de sortie d’un lycée ou d’une école primaire supérieure et qui a maintenant trente-cinq à quarante ans ; voyez ce qu’il a gardé des connaissances que l’école lui a péniblement fourrées dans la tête. Qu’il reste donc peu de chose de tout ce qu’on lui a autrefois entonné ! On vous répondra, il est vrai : « Mais c’est que la masse des connaissances alors acquises n’avait pas seulement pour but de mettre l’élève en possession d’une érudition étendue et variée ; on voulait aussi exercer en lui la capacité d’assimilation, l’aptitude à penser et surtout l’esprit d’observation. » Réponse juste en partie ; mais on court alors le danger de submerger sous un afflux d’impressions un jeune cerveau qui ne parviendra que très rarement à s’en rendre maître, à les trier et à les classer selon leur plus ou moins grande importance ; et il arrivera, la plupart du temps, que l’essentiel sera sacrifié à l’accidentel et complètement oublié. Le but principal de cette instruction massive ne sera donc pas atteint, car il ne peut être de rendre le cerveau capable d’apprendre en le bourrant de notions ; ce but doit être, au contraire, de fournir à chacun le trésor de connaissances qui lui sera utile plus tard et dont il fera profiter la communauté. Mais cette tentative est vaine, lorsque la surabondance des notions qu’on a fait entrer de force dans un jeune cerveau les lui fait complètement oublier ou lui fait oublier ce qu’elles avaient d’essentiel. On ne comprend pas, par exemple, pour quelle raison des millions d’hommes doivent, pendant des années, apprendre deux ou trois langues étrangères. Un nombre infime d’entre eux pourra seul en tirer parti et, pour cette raison, la plupart les oublieront complètement ; ainsi, sur cent mille élèves, qui apprennent le français, deux mille à peine se serviront plus tard sérieusement de cette langue, tandis que les quatre-vingt-dix-huit mille autres n’auront jamais, de toute leur vie, l’occasion d’utiliser dans la pratique ce qu’ils auront appris dans leur jeunesse. Ils auront ainsi consacré des milliers d’heures à une étude sans valeur pour eux. L’argument en vertu duquel l’étude des langues concourt à la culture générale ne tient pas ; il n’aurait de force que si les hommes continuaient à disposer pendant toute leur vie de ce qu’ils ont appris à l’école. Ainsi, pour les deux mille auxquels la connaissance de cette langue peut être utile, il y en aura quatre-vingt-dix huit mille qui se donneront du mal pour rien et sacrifieront un temps précieux.
Il s’agit, en outre, dans le cas présent, d’une langue dont on ne peut même pas dire qu’elle enseigne à penser d’une façon rigoureusement logique, comme il en est du latin. Il serait donc plus opportun de ne faire connaître au jeune élève que les grandes lignes d’une pareille langue, ou, plus exactement, de lui présenter un schéma de son mécanisme intérieur ; on signalerait ses caractères les plus saillants, on initierait l’élève aux éléments de sa grammaire, on exposerait, à l’aide d’exemples typiques, les règles de sa prononciation, de sa construction, etc. Cette méthode suffirait pour la masse des élèves et – fournissant une vue d’ensemble plus claire et plus facile à retenir – elle serait plus utile que la méthode usitée aujourd’hui : celle-ci prétend faire entrer de force toute la langue dans la mémoire, alors que l’élève n’arrive jamais à s’en rendre maître et l’oublie ensuite. En même temps, on ne courrait pas le risque que cette écrasante abondance de notions ne laisse dans la mémoire que des fragments incohérents, retenus au hasard ; en effet, le jeune homme n’aurait à apprendre que ce qui est le plus digne d’attention et on aurait fait pour lui le tri entre l’essentiel et le secondaire.
Un enseignement fondé sur ces principes généraux suffirait à la majorité des élèves pour le reste de leur vie. Ceux qui auraient plus tard à pratiquer réellement cette langue disposeraient d’une base suffisante qu’ils auraient le loisir d’élargir en vue d’une étude approfondie.
Les programmes feraient une économie de temps et pourraient, plus facilement, faire leur part aux exercices physiques et au développement du caractère dont il a été parlé plus haut.
Une réforme particulièrement importante est celle des méthodes actuelles d’enseignement de l’histoire. Peu de peuples, plus que les Allemands, ont besoin des leçons que donne l’histoire ; mais il y en a peu qui en aient tiré moins de profit. Si la politique est la matière de l’histoire future, l’enseignement qu’on nous donne de l’histoire est jugé, et condamné, par la façon dont nous menons notre politique. Et il ne s’agit pas ici de se lamenter sur les pitoyables résultats de notre politique, si l’on n’est pas résolu à mieux éduquer notre peuple dans cette matière. Le bilan de l’enseignement de l’histoire, tel qu’il est donné actuellement, est ridicule dans quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent. On n’en conserve que quelques millésimes, quelques dates de naissance et quelques noms ; les grandes lignes font complètement défaut. Les idées fondamentales, qui sont pourtant l’essentiel, ne sont pas exposées ; on laisse à l’intelligence plus ou moins développée des élèves le soin d’extraire de l’océan des dates et de la simple suite des événements, l’intelligence des causes profondes. On peut se révolter contre cette amère constatation autant qu’on le voudra ; qu’on lise seulement avec quelque attention les discours que, pendant une seule session, messieurs nos parlementaires ont prononcés sur la politique, notamment sur la politique extérieure ; qu’on réfléchisse en même temps qu’il s’agit ici – on le dit du moins – de l’élite de la nation allemande et, en tous cas, qu’une grande partie de ces gens ont usé leurs culottes sur les bancs des écoles secondaires, voire des facultés : on se rendra compte de l’absolue insuffisance des connaissances de ces hommes en histoire. S’ils ne l’avaient pas étudiée du tout, et s’ils possédaient seulement un instinct juste, cela n’en vaudrait que mieux pour la nation.
C’est surtout dans l’enseignement de l’histoire qu’il faut alléger les programmes. La principale utilité de cette étude est de faire discerner les lois qui régissent le cours des événements. Si l’enseignement se limite à cette tâche, on est fondé à espérer que chaque élève tirera plus tard profit de ce qu’il a appris, et la somme de ces gains s’inscrira à l’actif de la communauté. Car on n’apprend pas l’histoire pour savoir ce que fut le passé ; on l’apprend pour qu’elle vous enseigne la conduite que l’on devra tenir dans l’avenir pour assurer l’existence de son propre peuple. Tel est le but ; et l’histoire n’est qu’un des moyens de l’atteindre. Mais, aujourd’hui, le moyen est ici encore devenu un but et le but s’éloigne complètement. Qu’on ne vienne pas dire qu’une étude approfondie de l’histoire exige qu’on s’occupe de fixer le plus possible de dates, puisque c’est par elles seules qu’on peut tracer les grandes lignes. Ceci est l’affaire des historiens de profession. L’individu courant n’est pas un professeur. L’histoire n’a d’autre raison d’être que de lui donner l’intelligence des faits historiques, qui lui permettra de se faire une opinion sur les questions politiques qui intéressent sa nation. Celui qui veut devenir professeur d’histoire pourra, plus tard, se consacrer de la façon la plus approfondie à cette étude. Il aura naturellement à s’occuper de tous les détails, même les plus insignifiants. L’enseignement de l’histoire, tel qu’il est donné actuellement, ne lui suffirait du reste pas, car s’il est trop vaste pour la moyenne des élèves, il est trop limité pour les spécialistes.
Au reste, la tâche de l’État raciste est de veiller à ce que soit écrite enfin une histoire universelle dans laquelle la question de race sera mise au premier rang.
* * *
Résumons-nous : l’État raciste devra donner à l’enseignement des connaissances générales une forme abrégée, ne contenant que l’essentiel. Cet enseignement doit fournir à l’élève la possibilité d’aller plus loin, d’acquérir une culture et des connaissances plus approfondies. Il suffit que l’individu acquière des notions générales, des grandes lignes, qui serviront de base à son activité intellectuelle ; il ne recevra un enseignement approfondi, spécialisé et détaillé que pour les connaissances qui lui seront plus tard nécessaires dans sa sphère. La culture générale sera obligatoire dans toutes les disciplines ; la culture particulière sera laissée au choix de chacun.
L’allégement des programmes et la diminution des heures de classe que procurera cette réforme seront portés au crédit des exercices destinés à fortifier le corps, à former le caractère, à développer la volonté et l’esprit de décision.
Le peu d’utilité, au point de vue de la profession à venir, de l’enseignement donné actuellement dans nos écoles, notamment dans les écoles secondaires, est clairement prouvé par le fait que des hommes, sortant de trois écoles d’un genre absolument différent, peuvent aujourd’hui parvenir à la même situation.
Ce qui est réellement décisif, c’est la culture générale et non pas les connaissances spéciales dont on a bourré un cerveau. D’ailleurs si des connaissances spéciales sont nécessaires, les programmes de nos écoles secondaires sont – nous l’avons déjà dit – incapables de les donner.
Il faudra que l’État raciste mette fin quelque jour à ces demi-mesures.
* * *
La seconde modification que l’État raciste devra apporter aux plans d’étude est la suivante :
C’est un trait caractéristique de notre époque matérialiste que notre enseignement se tourne toujours plus exclusivement vers les disciplines utilitaires : mathématiques, physique, chimie, etc. Certes, ces connaissances sont utiles à une époque où règnent la technique et la chimie, et où la vie quotidienne en fournit les preuves les plus évidentes. Il y aurait pourtant danger à ce que la culture générale d’une nation repose toujours exclusivement sur elles. Au contraire, cette culture doit toujours tenir compte d’un idéal. Elle doit avoir pour base les « humanités » et fournir seulement les points de départ nécessaires plus tard pour une culture professionnelle plus développée. Sinon l’on fait bon marché de forces qui auront toujours plus d’importance pour l’existence de la nation que toutes connaissances techniques et autres. En particulier, l’enseignement de l’histoire ne doit pas délaisser l’étude de l’antiquité. L’histoire romaine, si on en possède exactement les grandes lignes, sera toujours le meilleur guide pour le temps présent et pour tous les temps. Nous devons conserver aussi dans toute sa beauté l’idéal grec de civilisation. Les différences entre chaque peuple ne doivent pas nous empêcher de voir la communauté de race qui les unit, et dont l’importance est beaucoup plus grande. La lutte qui fait rage actuellement a de grands objectifs : une civilisation lutte pour son existence et cette civilisation a duré des milliers d’années, elle embrasse l’hellénisme et le germanisme.
Il faut faire une distinction très nette entre la culture générale et les connaissances professionnelles. Celles-ci menacent précisément de nos jours de plus en plus de tomber au service du seul Mammon, et la culture générale doit être conservée pour leur faire contre- poids, par son caractère plus idéaliste. Il faut ici encore s’imprégner profondément de ce principe qu’industrie et technique, commerce et métiers ne sont florissants qu’aussi longtemps qu’une communauté nationale, soutenue par un idéal, leur assure les conditions préalables et nécessaires de développement. Ces conditions ne dépendent pas d’un égoïsme attaché à la matière, mais d’un esprit de sacrifice qui trouve satisfaction dans le renoncement.
* * *
La formation donnée aujourd’hui à un jeune homme consiste en général d’abord à mettre à coups de pompe dans son esprit les connaissances dont il aura besoin plus tard pour réussir dans sa carrière. On dit : « Il faut que ce garçon soit un jour un membre utile de la société humaine. » On entend par là sa capacité à gagner plus tard son pain quotidien d’une manière honnête.
L’éducation civique superficielle qui va de pair avec ce genre d’instruction, a des pieds d’argile. Comme l’État n’est en lui-même qu’une simple forme, il est très difficile d’éduquer des hommes qui soient utiles à cette forme, et surtout de leur imposer des devoirs envers elle. Une forme peut trop facilement se briser. La notion « d’État » n’a pas actuellement, nous l’avons vu, un sens clair. Il ne reste donc rien que l’éducation « patriotique » courante. Dans l’ancienne Allemagne, elle consistait surtout à diviniser d’une façon inintelligente et très plate les moindres petits souverains, dont la foule nous empêchait d’apprécier à sa juste valeur l’importance de notre peuple. Le résultat de cette adoration était que la masse du peuple ne possédait qu’une idée très insuffisante de l’histoire allemande. Ici encore les grandes lignes faisaient défaut.
Il est évident que ce n’est pas ainsi qu’on pouvait faire naître un véritable enthousiasme national. Notre système d’éducation ignorait l’art de mettre en relief des noms choisis dans l’histoire de notre peuple, et d’en faire le bien commun de tous les Allemands. Pour toute la nation, ces connaissances communes et ce même enthousiasme auraient été un lien indestructible entre ses fils. On n’a pas su présenter aux yeux de la génération présente les vrais grands hommes comme des héros ; on n’a pas su concentrer sur eux l’attention de tous et faire naître ainsi un esprit national parfaitement homogène. On se montrait incapable, dans les différentes branches de l’enseignement, de faire connaître aux élèves ce qui est à la gloire de notre nation, de s’élever au-dessus du niveau d’un froid exposé des faits et d’enflammer la fierté nationale en citant ces exemples éclatants ; on aurait alors qualifié cette façon de faire de chauvinisme et elle eut été très impopulaire. Le patriotisme dynastique et petit bourgeois paraissait plus acceptable et plus facile à supporter que l’ardente passion, fruit du plus haut orgueil national. Le premier était toujours prêt à obéir, l’autre pouvait un jour vouloir dominer. Le patriotisme monarchique trouvait son aboutissement dans les associations de vétérans ; il aurait été difficile d’aiguiller sur cette voie la passion nationale : c’est un pur-sang qui ne supporte pas n’importe quelle selle ; il n’était pas étonnant qu’on préférât éviter ce danger. Personne ne croyait possible qu’un jour éclatât une guerre où les bombardements à feu roulant et les vagues de gaz mettraient à une épreuve décisive la solidité foncière du patriotisme. Mais, lorsqu’elle se déchaîna, nous fûmes cruellement punis du manque de cette ardente passion patriotique. Les hommes n’avaient guère envie de mourir pour leurs souverains impériaux ou royaux ; et, par ailleurs, la plupart ignoraient ce que c’était que la « nation ».
Depuis que la révolution a fait son entrée en Allemagne et que, par suite, le patriotisme monarchique s’est éteint de lui-même, le but de l’enseignement de l’histoire n’est plus que l’acquisition de simples connaissances. Cet État n’a que faire d’un enthousiasme patriotique et, ce qu’il voudrait obtenir, il ne l’aura jamais : car, si le patriotisme dynastique ne pouvait donner au soldat, à une époque où domine le principe des nationalités, la force de tenir jusqu’au bout, l’enthousiasme républicain en est encore moins capable. Il est hors de doute que le mot d’ordre : « Pour la république », ne ferait pas rester pendant quatre ans et demi le peuple allemand sur le champ de bataille ; et ceux-là mêmes qui ont inventé ce merveilleux mirage y sont restés le moins longtemps.
En fait, on n’a laissé cette république tranquille que parce qu’elle a toujours été prête à acquitter volontairement tous les tributs qui lui seraient imposés et à signer toutes les renonciations de territoires qu’on exigerait d’elle. Elle a la sympathie du reste du monde, de même que tout être faible est préféré, par ceux qui se servent de lui, à un homme de caractère difficile. Il est vrai que la sympathie témoignée par nos ennemis à cette forme de gouvernement est sa condamnation absolue. On aime la république allemande et on lui permet de vivre, parce qu’on ne pourrait trouver un meilleur allié pour tenir notre peuple en esclavage.
C’est à cette seule raison que cette splendide création doit d’exister encore. Aussi peut-elle renoncer à tout système d’éducation vraiment nationale et se contenter des hourras des héros de la Bannière du Reich qui d’ailleurs, s’il s’agissait de verser leur sang pour ce drapeau, se sauveraient comme des lièvres.
L’État raciste devra lutter pour son existence. Il ne pourra pas la sauver par la vertu du plan Dawes. Il aura précisément besoin, pour vivre et assurer sa sécurité, de ce qu’il croit pouvoir abandonner aujourd’hui. Plus la forme qu’il prendra, plus l’esprit dont il sera animé auront de valeur et prouveront leur incomparable supériorité, plus fortes seront la jalousie et l’opposition de ses adversaires. Il ne trouvera pas alors ses meilleurs moyens de défense dans ses armes, mais dans ses citoyens ; ce ne seront pas les fossés des forteresses qui le protégeront le mieux, mais le mur vivant que formeront des hommes et des femmes pleins du plus ardent patriotisme et d’un enthousiasme national fanatique.
Le troisième point à considérer en ce qui concerne l’instruction publique, est le suivant :
L’enseignement doit aussi fournir à l’État raciste le moyen de développer la fierté nationale. C’est de ce point de vue que doit partir l’enseignement de l’histoire universelle, et de l’histoire générale de la civilisation.
Un inventeur ne devra pas paraître grand uniquement comme inventeur ; il devra paraître encore plus grand comme représentant de son peuple. L’admiration qu’on porte à toute grande action doit tourner en orgueil pour l’heureux enfant de la race qui l’a accomplie. Il faut choisir dans la foule des grands noms de l’histoire allemande ceux qui sont les plus grands, les mettre particulièrement en lumière et appeler sur eux l’attention de la jeunesse avec assez d’insistance pour qu’ils deviennent les piliers d’un inébranlable sentiment national.
L’enseignement doit être organisé systématiquement d’après ce point de vue, et de même l’éducation, de sorte que le jeune homme ne soit pas en quittant son école, un demi-pacifiste, un demi-démocrate ou quelque chose de ce genre, mais bien un Allemand intégral.
Afin que ce sentiment national soit, dès le début, sincère, et pas un faux-semblant, il faut enfoncer dans les jeunes cerveaux encore malléables ce principe d’airain : Qui aime son peuple, ne prouve son amour que par les sacrifices qu’il est prêt à s’imposer pour lui. Un sentiment national qui n’ait en vue que l’intérêt, cela n’existe pas. Un nationalisme qui embrasse seulement des classes sociales, cela n’existe pas davantage. Pousser des hourras ne prouve rien et ne donne pas le droit de se dire patriote ; il faut derrière le noble souci passionné de défendre l’existence et la pureté de la race tout entière. On n’a le droit d’être fier de son peuple que lorsqu’on n’a plus à avoir honte d’aucune de ses classes. Mais quand une moitié de ce peuple est misérable, minée par les soucis ou même dépravée, il offre un si fâcheux spectacle que personne ne doit être fier d’en faire partie. C’est seulement quand un peuple est, dans tous ses membres, sain de corps et d’esprit, que la joie de lui appartenir peut s’élever à bon droit chez tous les citoyens à ce degré supérieur qui a nom de fierté nationale. Mais cet orgueil suprême ne peut être éprouvé que par celui qui a conscience de la grandeur de son peuple.
Il faut implanter dans les jeunes cœurs l’union intime du nationalisme et du sentiment de la justice sociale. Alors naîtra un jour un peuple de citoyens, uni et amalgamé par un commun amour et une commune fierté, inébranlable et invincible à jamais.
La crainte qu’inspire le chauvinisme à notre époque est la marque de son impuissance. Toute énergie débordante lui fait défaut, lui est même importune : le destin ne l’appellera plus à accomplir de grandes choses. Car les plus grands bouleversements qui se sont produits sur cette terre auraient été inconcevables si leurs ressorts avaient été, au lieu de passions fanatiques et même hystériques, les vertus bourgeoises qui prisent le calme et le bon ordre.
Il est sûr que notre monde s’achemine vers une révolution radicale. Toute la question est de savoir si elle se fera pour le salut de l’humanité aryenne ou pour le profit de l’éternel Juif.
L’État raciste devra, par une éducation appropriée de la jeunesse, veiller à la conservation de la race, qui devra être mûre pour supporter cette suprême et décisive épreuve.
Mais c’est au peuple qui s’engagera le premier sur cette voie que reviendra la victoire.
* * *
L’État raciste aura atteint son but suprême d’instructeur et d’éducateur quand il aura gravé dans le cœur de la jeunesse à lui confiée, l’esprit et le sentiment de la race. Il ne faut pas qu’un seul garçon ou une seule fille vienne à quitter l’école sans avoir été amené à la parfaite connaissance de ce que sont la pureté du sang et sa nécessité. On aura ainsi satisfait à la condition préalable : conservation de la race, fondement de notre peuple et assuré par là le développement ultérieur de la civilisation.
Car toute éducation physique et intellectuelle devrait, en dernière analyse, demeurer vaine, si elle ne profitait pas à une entité tout à fait capable de se conserver avec ses caractères originaux, et qui y soit par ailleurs bien résolue.
Sinon il se produirait ce dont nous autres Allemands nous plaignons déjà en général, bien que toute la portée de cette tragique calamité n’ait peut-être pas été jusqu’à présent bien comprise : nous resterons encore dans l’avenir le fumier de la civilisation – non pas dans le sens étroit que donne à cette expression la façon de voir de notre bourgeoisie, qui dans la perte d’un frère de race ne voit que celle d’un concitoyen – mais dans le sens qu’on lui donne avec douleur quand on a su voir qu’en dépit de toute notre science et de toutes nos facultés, notre sang est condamné à s’avilir. En nous unissant continuellement à d’autres races, nous les élevons bien à un degré supérieur de civilisation, mais nous sommes à jamais déchus du faîte que nous avions atteint.
D’ailleurs, l’éducation, en ce qui concerne la race, trouvera son achèvement définitif dans le service militaire. Ce temps de service doit être considéré comme le dernier stade de l’éducation normale donnée à l’Allemand moyen.
* * *
Si important que soit dans l’État raciste le système d’éducation physique et intellectuelle, la formation d’une élite n’en joue pas moins dans cet État un rôle capital. Aujourd’hui, on en prend à son aise sur ce point. En général, ce sont les enfants de parents occupant un rang ou des situations élevés que l’on tient pour dignes de faire des études supérieures. La question des dispositions personnelles ne vient qu’après. Un petit paysan peut être beaucoup mieux doué que l’enfant né dans une famille jouissant, depuis plusieurs générations, d’une haute situation sociale, même si les connaissances générales du premier sont inférieures à celles du bourgeois. La supériorité de celui-ci, à ce point de vue, n’a rien à faire avec ses dispositions naturelles, elle provient de la somme plus considérable d’impressions qu’il reçoit d’une façon ininterrompue en raison d’une instruction plus développée et de la culture des personnes qui l’entourent. Si le petit paysan bien doué avait, dès ses premières années, grandi lui aussi dans un milieu semblable, ses facultés intellectuelles seraient tout autres. Il n’y a peut-être aujourd’hui qu’un seul domaine où l’origine décide vraiment moins que les dons innés : celui de l’art. Là, il ne s’agit pas seulement « d’apprendre » ; tout doit se trouver de naissance à l’état latent, et ne fait que se développer plus ou moins plus tard dans la mesure où les dispositions naturelles sont intelligemment cultivées : l’argent et la situation des parents ne jouent presque aucun rôle. Ce fait prouve manifestement que le génie est indépendant de la situation sociale et même de la fortune. Il n’est pas rare que les plus grands artistes sortent des plus pauvres familles. Et plus d’un petit villageois est devenu un maître illustre.
Que de pareils exemples n’aient pas eu d’influence bienfaisante sur l’ensemble de la vie intellectuelle, c’est là une constatation qui ne parle pas en faveur de la puissance de raisonnement de notre époque. On prétend que ce qui est indéniable pour l’art n’est plus vrai pour les sciences appliquées. On peut, certes, donner à un homme, par l’éducation, une certaine dextérité mécanique, de même qu’un habile dresseur peut faire exécuter les tours les plus incroyables par un caniche docile. Mais ce dressage n’amène pas l’animal à exécuter ses exercices en usant de son intelligence ; il en est de même chez l’homme. On peut, sans avoir égard aux dispositions particulières d’un homme, le rendre capable d’exécuter certains tours de force scientifiques, mais la façon dont il procède alors est, tout comme chez l’animal, purement machinale et indépendante de l’activité intellectuelle. On peut, au moyen d’un dressage intellectuel déterminé, faire entrer de force dans le cerveau d’un homme moyen des connaissances supérieures à la moyenne ; mais ce n’est qu’une science morte et, tout compte fait, stérile. Il en résulte un homme, qui peut être un dictionnaire vivant, et qui pourtant, dans les situations délicates et dans les moments décisifs, se conduit d’une façon lamentable ; il faut qu’on le dresse toujours d’avance à répondre à ce que chaque circonstance, même la plus insignifiante, exigera de lui, mais il est incapable de contribuer par ses propres forces aux progrès de l’humanité. Une telle science mécanique, enseignée par dressage, rend tout au plus capable de remplir les fonctions d’État telles qu’elles sont exercées de nos jours.
Il va de soi qu’on peut trouver parmi tous les individus qui composent un peuple des talents aptes à s’exercer dans tous les domaines imaginables de la vie quotidienne. Tout naturellement aussi la valeur du savoir sera d’autant plus grande que le talent de l’individu donnera plus de vie à ce qui n’est en soi que matière morte. Les vraies créations sont filles du mariage de la capacité et du savoir.
À quel point l’humanité fait en ce moment fausse route en cette matière, c’est ce que prouve l’exemple suivant. De temps en temps, les journaux illustrés mettent sous les yeux de nos bons bourgeois allemands le portrait d’un nègre qui, en tel ou tel endroit, est devenu avocat, professeur, ou pasteur, ou même ténor tenant les premiers rôles ou quelque chose de ce genre. Pendant que nos bourgeois imbéciles admirent les effets miraculeux de ce dressage et sont pénétrés de respect pour les résultats qu’obtient la pédagogie moderne, le Juif rusé y découvre un nouvel argument à l’appui de la théorie qu’il veut enfoncer dans l’esprit des peuples et qui proclame l’égalité des hommes. Cette bourgeoisie en décadence n’a pas le plus léger soupçon du péché qu’on commet ainsi contre la raison ; car c’est une folie criminelle que de dresser un être, qui est par son origine un demi-singe, jusqu’à ce qu’on le prenne pour un avocat, alors que des millions de représentants de la race la plus civilisée doivent végéter dans des situations indignes d’eux. On pèche contre la volonté du Créateur quand on laisse les hommes les mieux doués étouffer par centaines de milliers dans le marais du prolétariat actuel, tandis qu’on dresse des Hottentots et des Cafres à exercer des professions libérales. Car il ne s’agit là que d’un dressage, comme pour un caniche, et non d’une « culture » scientifique. Si l’on consacrait les mêmes efforts et les mêmes soins aux races douées d’intelligence, n’importe lequel de leurs représentants serait mille fois plus capable d’obtenir des résultats pareils.
Si intolérable qu’aurait été cet état de choses, s’il s’était agi là d’autre chose que de cas exceptionnels, la situation actuelle ne l’est pas moins, puisque ni le talent, ni les dons naturels ne désignent d’une façon décisive ceux qui doivent recevoir une culture supérieure. Certes, il est insupportable de penser que, chaque année, des centaines de milliers d’hommes, complètement dénués de dispositions, sont jugés dignes de recevoir une culture supérieure, tandis que des centaines de milliers d’autres, très bien doués, sont privés de leur côté de toute culture analogue. Ce que la nation perd ainsi est incalculable. Si, pendant les dernières dizaines d’années, le nombre des inventions de grande portée a considérablement augmenté, surtout dans l’Amérique du Nord, c’est en grande partie parce que les hommes de la plus humble extraction, pourvu qu’ils soient bien doués, y trouvent plus facilement, que ce n’est le cas en Europe l’occasion de recevoir une culture supérieure.
C’est que le don d’invention ne provient pas d’un savoir qui n’est qu’une compilation ; il faut que les dispositions naturelles donnent la vie à ce savoir. Mais chez nous on n’y a, jusqu’à présent attaché aucune valeur ; la bonne note est seule à décider.
Là encore, le système d’éducation adopté par l’État raciste devra intervenir. L’État raciste n’est pas chargé de maintenir une classe sociale en possession de l’influence prédominante qu’elle a exercée jusqu’alors ; sa tâche est d’aller chercher, parmi tous les membres de la communauté, les meilleures têtes, et de leur conférer les emplois et les dignités. Son rôle n’est pas seulement de donner, à l’école primaire, une certaine éducation à tous les enfants ; il a aussi le devoir d’aiguiller le talent sur la voie qui lui convient. Il doit surtout considérer cela comme sa tâche la plus haute, d’ouvrir les portes des établissements d’État d’instruction supérieure à tous les sujets bien doués, quelle que soit leur origine. C’est là du reste une nécessité impérieuse, car ainsi seulement sortiront d’une classe de représentants de la science morte les chefs de génie de la nation.
Il y a aussi une autre raison pour que l’État prenne des mesures dans ce sens : les milieux intellectuels sont chez nous si fermés et pétrifiés que toute liaison vivante avec les classes inférieures leur fait défaut. Cet exclusivisme est néfaste à deux points de vue : d’abord ces milieux restent étrangers aux idées et aux sentiments qui animent la masse populaire. Ils ont depuis trop longtemps perdu le contact avec elle pour pouvoir encore comprendre la psychologie du peuple. Ils lui sont devenus complètement étrangers. En second lieu ; ces classes supérieures n’ont pas la force de volonté requise. Car celle-ci est toujours, dans ces milieux auxquels la culture de l’intelligence a donné le caractère d’une caste fermée, plus faible que dans la masse du peuple restée inculte. La culture scientifique ne nous a, Dieu le sait, jamais manqué à nous autres Allemands ; nous n’en sommes que plus démunis de force de volonté et de capacité à prendre une décision. Par exemple, plus nos hommes d’État ont brillé par leurs dons intellectuels, plus leur action pratique a été insignifiante. La préparation politique aussi bien que l’équipement technique au temps de la guerre mondiale ont été insuffisants, non pas que le cerveau de ceux qui nous gouvernaient fût trop peu cultivé, mais, bien au contraire, parce que nos chefs étaient des hommes hypercultivés, bourrés jusqu’à la bonde de savoir et d’intelligence, mais dénués de sain instinct et privés de toute énergie et de toute audace. Ce fut une fatalité pour notre peuple d’être condamné à livrer un combat dont son existence était l’enjeu, au moment où le chancelier du Reich était un philosophe et une mazette. Si, au lieu d’un Bethmann-Hollweg, nous avions eu pour chef un homme du peuple plus énergique, le sang héroïque de l’humble grenadier n’aurait pas coulé en vain. De même l’instruction supérieure, exclusivement et exagérément intellectuelle, qu’avaient reçue nos chefs fut le meilleur allié des canailles qui ont fait la révolution de novembre. En gardant en réserve de la façon la plus honteuse le trésor national qui lui avait été confié, au lieu de le mettre tout entier en jeu, cette classe intellectuelle a réalisé les conditions nécessaires au triomphe des autres.
Sur ce point, l’Église catholique peut servir d’exemple et de modèle. Le célibat de ses prêtres la force, puisqu’elle ne peut pas recruter son clergé dans ses propres rangs, à puiser continuellement dans la masse du peuple. Beaucoup méconnaissent l’importance du célibat à cet égard. C’est à lui qu’il faut attribuer l’incroyable vigueur dont est douée cette institution si ancienne. Car, recrutant sans interruption l’immense armée de ses dignitaires ecclésiastiques dans les dernières couches du peuple, l’Église ne maintient pas seulement sa liaison d’instinct avec l’atmosphère des sentiments populaires ; elle s’assure aussi la somme de vigueur et d’énergie qui se trouvera éternellement à ce degré dans la masse populaire. De là seule l’étonnante jeunesse de ce gigantesque organisme, sa souplesse intellectuelle et sa volonté d’acier.
Le système d’enseignement adopté par l’État raciste devra veiller à ce que les classes cultivées soient continuellement renouvelées par un apport de sang frais provenant des classes inférieures. L’État a le devoir d’opérer une sélection faite avec le plus grand soin et la dernière minutie dans l’ensemble de la population, pour en tirer le matériel humain visiblement doué par la nature et le mettre au service de la communauté tout entière. La raison d’être de l’État et des offices d’État n’est pas de fournir des revenus à certaines classes, mais de remplir les tâches qui leur incombent. Mais cela ne leur est possible que si l’État forme systématiquement des personnalités capables et énergiques pour remplir ces charges. Ce principe ne vaut pas seulement pour tous les emplois publics ; il s’applique aussi à la direction morale qui doit être, dans tous les domaines, donnée à la nation. La grandeur d’un peuple est fonction de la réussite de ce plan : former les cerveaux les plus capables dans tous les domaines de l’activé humaine et les mettre au service de la communauté. Quand deux peuples, dont les dons naturels sont de valeur égale, se trouvent en concurrence, celui-là emportera la victoire chez lequel les hommes les mieux doués exercent la direction générale et morale, et celui-là devra succomber dont le gouvernement n’est que le râtelier commun pour certaines classes, sans qu’il soit tenu compte des capacités innées de chacun de leurs membres.
Il est vrai qu’une pareille réforme semble tout d’abord impossible dans notre société actuelle. On nous objectera immédiatement qu’on ne saurait exiger du fils chéri d’un haut fonctionnaire qu’il devienne, disons qu’ouvrier manuel, parce que quelque autre, dont les parents sont eux-mêmes des ouvriers, aura plus de dispositions que le premier. Cette objection peut être fondée en raison de l’opinion qu’on a actuellement sur la valeur du travail manuel. C’est pourquoi l’État raciste doit partir d’un tout autre principe pour apprécier l’idée de travail. Il lui faut, quand même il devrait consacrer des siècles à son œuvre d’éducation, mettre fin à l’injustice qui consiste à mépriser le travail corporel. Il devra avoir pour principe de juger l’individu non pas d’après son genre de travail, mais suivant la qualité de ce qu’il produit. Ce principe pourra paraître monstrueux à une époque où le plus stupide écrivain à la ligne est plus prisé que le plus intelligent des ouvriers mécaniciens qualifiés, simplement parce que le premier travaille avec une plume. Cette fausse appréciation ne vient pas, nous l’avons dit, de la nature des choses ; c’est un produit artificiel de l’éducation, qui n’existait pas autrefois. L’état contre nature dans lequel nous nous trouvons actuellement fait partie de ces phénomènes morbides généraux qui caractérisent la décadence matérialiste de notre temps.
Par essence, la valeur de tout travail est double : purement matérielle et idéale. La valeur matérielle dépend de l’importance, et de l’importance pratique, que peut avoir un travail pour la vie sociale. Plus grand est le nombre des citoyens auxquels le produit d’un travail quelconque sera, directement ou indirectement, utile, plus on devra attacher de prix à sa valeur matérielle. Cette appréciation trouve son expression tangible dans le salaire matériel que l’individu reçoit pour son travail. À cette valeur purement matérielle s’oppose la valeur idéale. Celle-ci ne dépend pas de l’importance de produit du travail, estimée au point de vue matériel, mais de sa nécessité intrinsèque. Il est sûr que l’utilité matérielle d’une invention peut être supérieure à celle que présente la besogne quotidienne d’un manœuvre ; il n’est pas moins sûr que les humbles services rendus par le manœuvre à la communauté lui sont aussi indispensables que ceux beaucoup plus frappants que lui rend une invention. Au point de vue matériel, elle peut faire une différence entre la valeur que représente pour la communauté le travail d’un individu et exprimer cette différence par le taux du salaire ; mais elle doit, au point de vue idéal, mettre sur le même plan les travaux que chacun des travailleurs, quel que soit son métier, exécute de son mieux. C’est d’après ce principe qu’on doit apprécier la valeur d’un homme, et non d’après le salaire qu’il reçoit.
Dans un État où règne la raison, on doit avoir soin d’assigner à l’individu le genre d’activité qui convient à ses capacités, ou, en d’autres termes, de donner aux divers dons l’éducation correspondant aux tâches qui les attendent ; comme la capacité n’est pas un produit de l’éducation, mais existe chez l’individu à l’état inné, qu’elle est donc un don de la nature et ne constitue pas un mérite pour celui qui la possède, le jugement que porte en général la bourgeoisie sur la valeur du travail ne peut donc s’appuyer sur la nature de la tâche qui a été jusqu’à un certain point imposée à l’individu. Car cette tâche dépend de sa naissance et de l’éducation qu’il a reçue en conséquence et qui lui a été dispensée par la communauté.
L’appréciation de la valeur d’un homme doit être fondée sur la façon dont il s’acquitte de la tâche que lui a confiée la communauté. Car l’activité que déploie l’individu n’est pas le but de son existence, mais le moyen de l’assurer. Il doit, en outre, continuer à développer et à ennoblir sa valeur comme homme, mais il ne peut le faire que dans le cadre de sa communauté de culture, qui doit forcément toujours s’appuyer sur la base d’un État. Il doit contribuer à maintenir cette base. La nature détermine la forme de cette contribution ; le devoir de l’individu est de restituer à la communauté nationale, par son zèle et son honnêteté, ce qu’il a reçu d’elle. Celui qui agit ainsi mérite la plus grande estime et la plus haute considération. Le salaire matériel accordé à un individu peut correspondre à l’utilité que le produit de son travail présente pour la communauté ; mais le salaire idéal doit être l’estime à laquelle peut prétendre tout homme qui consacre au service de son peuple les capacités que lui a données la nature et que la communauté a complètement développées. Il n’y a plus de honte alors à être un bon ouvrier, mais il est honteux d’être un fonctionnaire incapable qui vole le temps de Dieu et le pain quotidien du bon peuple. Alors on trouvera aussi tout naturel qu’on n’assigne pas une tâche à un homme qui est, en principe, incapable de la remplir.
D’ailleurs, une activité semblable à celle dont il vient d’être question fournit le seul critérium pour décider si un individu a le droit de prendre part, au même titre que les autres citoyens, à la vie de la communauté.
L’époque actuelle se démolit elle-même : elle introduit dans l’État le suffrage universel, émet forces niaiseries sur l’égalité des droits, mais sans rien trouver sur quoi les fonder. Elle voit dans le salaire matériel l’expression de la valeur d’un homme et détruit ainsi les bases de la plus noble égalité qui puisse exister. Car l’égalité n’a pas, et ne peut pas avoir pour base le produit du travail de l’individu, estimé d’après sa valeur intrinsèque ; elle n’est possible qu’en tenant compte de la façon dont chaque citoyen remplit ses devoirs particuliers. C’est seulement ainsi qu’on peut éliminer la part du hasard représentée par les dons naturels, quand on veut juger la valeur d’un homme, et que l’individu est lui-même l’artisan de son importance sociale.
À l’époque actuelle, où des groupes d’hommes ne savent réciproquement apprécier leur valeur que d’après les taux de salaire qui les répartissent en classes différentes, on ne comprend pas, comme il a déjà été dit, de pareils principes. Mais il n’y a pas de raison pour que cette inintelligence nous fasse renoncer à défendre nos idées. Tout au contraire : celui qui veut guérir une époque intérieurement malade et pourrie doit avoir d’abord le courage de mettre en lumière les causes du mal. Le premier soin du mouvement national socialiste doit être, en passant par-dessus la tête de tous les petits bourgeois et en puisant dans la masse du peuple, de rassembler et de coordonner toutes les énergies capables de lutter pour une nouvelle conception du monde.
* * *
On ne manquera pas certes d’objecter qu’il est en général difficile de dissocier valeur matérielle et valeur idéale et que si l’on prise peu les travaux matériels, cela provient de leurs moindres salaires. On prétendra que cette diminution des salaires amène à son tour une diminution de la part prise par chacun aux bienfaits de la civilisation. On dira encore que cet état de choses fait tort à la culture morale de l’homme, culture qui n’a rien à faire avec son activité elle-même ; que c’est là la raison de la crainte qu’inspirent les travaux matériels, parce que, plus mal rétribués, le degré de culture du travailleur manuel s’en trouve fatalement abaissé, ce qui justifie l’estime moindre qu’on lui accorde en général.
Il y a beaucoup de vrai dans ces objections. C’est précisément ce qui fait qu’on devra, à l’avenir, éviter des différences trop sensibles entre les taux des salaires. Qu’on ne vienne pas dire qu’on diminuera par là le rendement du travail. Ce serait, à la charge d’une époque, un des plus tristes signes de décadence si des salaires plus élevés étaient la seule considération qui puisse déterminer les hommes à développer leurs facultés intellectuelles. Si cette conception l’avait jusqu’à nos jours emporté dans ce monde, l’humanité n’aurait jamais bénéficié des biens inestimables qu’elle doit à la science et à la civilisation. Car les plus grandes inventions, les plus grandes découvertes, les travaux qui ont le plus profondément révolutionné la science, les monuments les plus splendides de la civilisation humaine ne sont pas des cadeaux qu’aurait faits au monde la poursuite de gains matériels. Tout au contraire, s’ils ont vu le jour, ce fut souvent parce que leurs auteurs avaient renoncé au bonheur matériel que procure la richesse.
Il se peut qu’aujourd’hui l’or soit le dominateur exclusif de la vie ; pourtant il viendra un jour où l’homme rendra hommage à des dieux plus nobles. Bien des choses peuvent devoir aujourd’hui leur existence à la soif de l’argent et de la fortune, mais il en est peu parmi elles dont l’absence rendrait l’humanité plus pauvre.
C’est aussi une des tâches de notre mouvement d’annoncer dès maintenant la venue de temps où l’individu recevra ce dont il a besoin pour vivre ; et nous devons, en même temps, maintenir le principe que l’homme ne vit pas uniquement pour des jouissances purement matérielles. Ce principe trouvera un jour son expression dans un sage échelonnement des salaires qui, dans tous les cas, permettra aux plus humbles des travailleurs honnêtes de mener la vie honorée et décente qu’exige sa qualité de membre de la communauté populaire et sa qualité d’homme.
Qu’on ne dise pas que ce serait là un état de choses idéal que ce monde ne pourrait supporter dans la pratique et auquel il est incapable de parvenir.
Nous ne sommes pas assez simples pour croire qu’on pourra jamais arriver à faire naître une époque où tout serait parfait. Mais cela ne nous dispense pas de l’obligation de combattre les défauts dont nous avons constaté l’existence, de surmonter nos faiblesses et de tendre vers l’idéal. La dure réalité n’apportera que trop de bornes à nos conquêtes. Mais c’est précisément pourquoi l’homme doit tenter de progresser vers le but final et les échecs ne doivent pas le faire renoncer à son entreprise, pas plus qu’on ne fait supprimer les tribunaux, parce qu’il leur arrive de commettre des erreurs, ou condamner la médecine, parce qu’il y aura toujours des maladies.
Il faut se garder de sous-estimer la puissance d’un idéal. À ceux qui manqueraient aujourd’hui de courage à cet égard, je voudrais rappeler, s’ils ont été autrefois soldats, un temps dont l’héroïsme a montré de la façon la plus convaincante quelle force possèdent des raisons d’agir inspirées par un idéal. Car, si des hommes se faisaient tuer, ce n’était pas par souci du pain quotidien, mais pour l’amour de la patrie, pour la foi en sa grandeur, pour le sentiment que l’honneur de la nation était en jeu. Et ce fut seulement quand le peuple allemand abandonna cet idéal, pour se laisser séduire par les promesses de bonheur matériel que lui faisait la révolution, quand il jeta ses armes pour prendre son havresac, qu’au lieu d’entrer dans le paradis terrestre, il fut plongé dans le purgatoire du mépris universel et aussi de la misère universelle.C’est pourquoi il faut absolument opposer aux calculateurs de la république réaliste actuelle la foi en l’avènement d’un Reich idéaliste.
Chapitre 3 – Sujets de l’État et citoyens
En général, la formation politique à laquelle on donne aujourd’hui abusivement le nom d’État, ne connaît que deux sortes d’hommes : les citoyens et les étrangers. Les citoyens sont ceux qui, en vertu de leur naissance ou d’un acte de naturalisation, possèdent les droits civils, les étrangers, tous ceux qui jouissent des mêmes droits au sein d’un autre État. Entre ces deux catégories fixes se trouvent, à l’état sporadique, ceux qu’on appelle heimatlos. Ce sont des gens qui n’ont pas l’honneur d’appartenir à l’un des États existant actuellement et qui, par conséquent, ne possèdent nulle part de droits civils.
Pour posséder ceux-ci, il faut tout d’abord, comme il a été dit plus haut, être né à l’intérieur des frontières d’un État. La race ou la consanguinité ethnique ne joue aucun rôle dans l’affaire. Un nègre, qui vivait autrefois dans un protectorat allemand et qui réside maintenant en Allemagne, met ainsi au monde un enfant qui est « citoyen allemand ». Dans les mêmes conditions, l’enfant de tout Juif, Polonais, Africain ou Asiatique peut être, sans autre forme de procès, déclaré citoyen allemand.
Outre la naturalisation conférée par le lieu de naissance, il existe une naturalisation qui peut être obtenue par la suite. Elle est soumise à différentes conditions préalables ; par exemple, le candidat ne doit être, autant que possible, ni un cambrioleur ni un souteneur ; il ne doit pas être suspect au point de vue politique – c’est-à-dire qu’il doit être un crétin inoffensif à cet égard – il ne doit pas, enfin, tomber à la charge de l’État dont il devient citoyen. Ceci s’entend naturellement, à notre époque réaliste, des charges pécuniaires qu’il pourrait imposer à sa nouvelle patrie. Si même le candidat paraît devoir être un contribuable d’excellent rapport, c’est là une recommandation très utile et qui lui permet aujourd’hui d’obtenir plus rapidement la naturalisation.
Dans tout cela, la question de race n’a rien à voir.
La marche à suivre pour acquérir le droit de cité dans un État n’est pas très différente de celle qu’on doit observer pour être admis, par exemple, dans un club d’automobilistes. Le candidat présente sa requête, qui est examinée et sur laquelle on donne avis favorable ; puis il reçoit un jour un billet l’avisant qu’il est devenu citoyen. Cet avis lui est, par-dessus le marché, donné sous une forme vraiment humoristique : on dit, en effet, à ce candidat, qui peut avoir été jusque-là un Cafre : « En vertu de quoi vous êtes dorénavant un Allemand ! »
Ce coup de baguette magique est donné par le chef de l’État. Une transformation qu’un dieu serait incapable d’accomplir est opérée en un tournemain par ce Paracelse fonctionnaire. D’un coup de plumeau un misérable Slave, venu de Mongolie, est changé en « Allemand » authentique.
Non seulement on ne s’inquiète pas de savoir à quelle race appartient un tel nouveau citoyen ; on ne s’occupe même pas d’examiner son état de santé physique. Cet individu aura beau être rongé par la syphilis, il n’en sera pas moins le bienvenu comme citoyen dans un État moderne, à condition, ainsi que nous l’avons déjà dit, qu’il ne constitue pas une charge au point de vue financier ou un danger par ses opinions politiques.
C’est ainsi que les formations politiques, qui portent le nom d’États, s’assimilent des toxines dont elles ont ensuite peine à venir à bout. Ce qui distingue encore le citoyen d’un étranger, c’est que le premier peut accéder librement à toutes les fonctions publiques, qu’il doit éventuellement satisfaire au service militaire et peut, en revanche, prendre part, activement et passivement, aux élections. Ce sont là, en tout et pour tout, ses privilèges. Car, en ce qui concerne les droits individuels et la liberté personnelle, l’étranger jouit de la même protection, et même souvent d’une protection plus efficace ; c’est, en tous cas, ce qui arrive dans la république allemande actuelle.
Je sais bien que l’on n’aime pas à entendre dire tout cela. Pourtant il est difficile de trouver quelque chose de plus illogique et même de plus complètement fou que notre droit civil contemporain. Il y a, à notre époque, un pays où l’on peut observer au moins de timides tentatives inspirées par une meilleure conception du rôle de l’État. Ce n’est pas, naturellement, notre république allemande modèle ; ce sont les États-Unis d’Amérique qui s’efforcent d’obéir, du moins en partie, aux conseils de la raison. En refusant l’accès de leur territoire aux immigrants dont la santé est mauvaise, en excluant du droit à la naturalisation les représentants de certaines races, ils se rapprochent un peu de la conception raciste du rôle de l’État.
L’État raciste distribue ses habitants en trois classes : citoyens, sujets de l’État (ou bien ressortissants) et étrangers.
En principe, la naissance ne confère que la qualité de ressortissant. Cette qualité ne donne pas le droit, à elle seule, d’accéder à une fonction publique, ni de prendre part à l’activité politique, par exemple aux élections. Pour tout ressortissant, il est essentiel d’établir exactement sa race et sa nationalité. Il lui est, en tout temps, loisible de renoncer à sa qualité de ressortissant et de devenir citoyen dans le pays dont les habitants sont de la même nationalité que lui. La seule distinction entre un étranger et un ressortissant vient de ce que le premier est le sujet d’un autre État.
Le jeune ressortissant de nationalité allemande est obligé de parcourir le cycle d’éducation et d’instruction scolaires imposé à tout Allemand. Il se soumet ainsi à l’éducation qui fera de lui un membre de la communauté conscient de sa race et pénétré de l’esprit national. Il devra ensuite satisfaire à toutes les autres prescriptions de l’État en ce qui concerne les exercices physiques et il sera finalement incorporé dans l’armée. L’éducation donnée par l’armée est une éducation générale ; elle doit être donnée à tous les Allemands et exercer chacun d’eux à occuper convenablement dans l’armée le poste pour lequel ses aptitudes physiques et intellectuelles pourront le désigner. Le titre de citoyen, avec les droits qu’il confère, sera accordé de la façon la plus solennelle au jeune homme de bonne santé et de bonne réputation, quand il aura accompli son service militaire. Le diplôme qui lui sera remis sera le document le plus important pour toute son existence. Il lui permettra d’exercer tous les droits du citoyen et de jouir de tous les privilèges attachés à ce titre. Car l’État doit faire une profonde différence entre les citoyens, soutiens et défenseurs de son existence et de sa grandeur, et ceux qui se sont fixés à l’intérieur des frontières d’un État pour y jouer seulement le rôle « d’utilités ».
La remise du diplôme de citoyen sera accompagnée de la prestation solennelle d’un serment par lequel le nouveau citoyen jurera fidélité à la communauté et à l’État. Ce diplôme constitue un lien unissant tous les membres de la communauté ; il comble le fossé séparant les différentes classes sociales. Un balayeur des rues doit se sentir plus honoré d’être citoyen de ce Reich que s’il était roi d’un État étranger.
Les droits du citoyen l’emportent sur ceux de l’étranger. Il est le maître et seigneur du Reich. Mais un rang plus élevé impose aussi des devoirs. L’homme sans honneur ou sans caractère, le criminel de droit commun, le traître à son pays, etc., peuvent en tout temps être dépouillés de cette dignité. Ils retombent alors au rang de ressortissants.
La jeune Allemande est « ressortissant » et ne devient citoyenne qu’en se mariant. Pourtant le droit de cité peut aussi lui être accordé si elle est Allemande et gagne sa vie par son travail.
Chapitre 4 – La personnalité et la conception raciste de l’État
Si l’État raciste national-socialiste a pour but principal l’éducation et le maintien de ceux qui sont les soutiens de l’État, il ne doit pas se borner à favoriser les éléments de race comme tels, à les élever, à les former enfin pour la vie pratique : il est aussi indispensable qu’il mette son organisation en harmonie avec cette tâche.
Mais ce serait une absurdité de vouloir estimer la valeur des hommes d’après leur race et par suite de déclarer la guerre au point de vue marxiste : « Un homme en vaut un autre », sans être décidé à pousser jusqu’aux dernières conséquences. Reconnaître l’importance de la race, reconnaître le principe racial dans son universalité, amène logiquement à tenir compte de la valeur propre de l’individu. De même que je suis obligé d’apprécier diversement les hommes d’après la race à laquelle ils appartiennent, de même faut-il procéder à l’intérieur de la communauté à l’égard de l’individu.
Un peuple n’est pas identique à un autre peuple et, à l’intérieur d’une communauté, une tête ne peut pas non plus être identique à une autre tête ; les éléments constitutifs appartiennent au même sang, mais ils offrent dans le détail mille différences subtiles.
Admettre ce postulat incite d’abord, sans chercher de finesses, à favoriser dans la communauté les éléments reconnus supérieurs, et à s’occuper d’accroître particulièrement leur nombre.
C’est le problème le plus facile, car il peut être posé et résolu presque mécaniquement. Il est plus difficile de reconnaître dans la multitude les têtes qui ont réellement la plus grande valeur intellectuelle, et de leur faire la part qui revient de droit aux esprits supérieurs, et surtout celle qui sera la plus profitable à la nation. Ce choix de valeurs et de capacité ne relève plus de moyens mécaniques ; il ne peut être mené à bien sans un effort continuel de chaque jour.
Une doctrine qui, écartant l’idée démocratique de la masse, tend à donner cette terre au meilleur peuple, c’est-à-dire aux individus supérieurs, doit logiquement se conformer au même principe aristocratique à l’intérieur de ce peuple et conserver aux meilleures têtes le commandement et l’influence. Au lieu d’édifier sur l’idée de majorité, cette doctrine se fonde ainsi sur la personnalité.
Celui qui croit aujourd’hui qu’un État raciste national-socialiste ne doit guère présenter, avec les autres États, que la différence purement matérielle d’une meilleure organisation économique, soit par un plus juste équilibre entre richesse et pauvreté, ou bien par un droit de regard plus étendu des classes inférieures dans le processus économique, ou bien par des salaires plus équitables ou mieux répartis, celui-là est le dernier des retardataires et il n’a pas la moindre idée de notre doctrine. Tout ce que nous venons de mentionner ne présente aucun caractère de permanence ou de grandeur. Un peuple qui en demeurerait à des réformes d’un caractère aussi superficiel, n’aurait pas la moindre chance de triompher dans la mêlée universelle des peuples. Un mouvement qui ne verrait pas dans sa mission autre chose que ces réformes égalitaires, d’ailleurs équitables, ne possèderait plus puissance ni efficacité quand il s’agirait de réformer profondément un milieu. Toute son action demeurerait, en définitive, limitée à des objets superficiels ; il ne donnerait pas au peuple cette armature morale qui l’assure de triompher – je dirais presque malgré lui – des faiblesses dont nous souffrons aujourd’hui.
Pour le mieux comprendre, peut-être est-il utile de jeter encore un coup d’œil sur les origines et les causes réelles du développement de la culture humaine.
Le premier pas qui l’éloigna visiblement de l’animal fut celui que l’homme fit vers l’invention. Celle-ci consista, à l’origine, dans la découverte de ruses et détours, dont l’emploi devait rendre plus aisée, ou même simplement possible, la lutte pour la vie.
Ces inventions premières très primitives peuvent ne pas mettre nettement en évidence la part de l’individu, car, pour les générations suivantes, et à plus forte raison pour l’homme d’aujourd’hui, elles n’apparaissent que comme des manifestations de l’intelligence collective, de même certaines ruses et finesses, que l’homme peut observer chez l’animal, ne se présentent plus à ses yeux que comme un fait acquis ; incapable d’en établir les causes premières, il se contente de les qualifier de procédés « instinctifs ».
Dans notre cas, ce dernier mot ne veut rien dire. Quiconque croit à une évolution améliorant les êtres vivants, doit convenir que toutes les formes et manifestations de leur activité n’ont pas toujours existé sous leur forme actuelle ; il a bien fallu qu’un sujet donné fît le premier le geste, qui fut ensuite répété de plus en plus souvent par des individus de plus en plus nombreux, jusqu’à passer dans le subconscient de chacun des représentants de l’espèce et se manifester alors comme instinct.
On comprendra et on admettra ce mécanisme plus facilement chez l’homme. Les premières ruses dans la lutte contre les autres animaux ont été sans nul doute, à l’origine, le fait de sujets particulièrement doués. La personnalité fut ici encore, sans conteste, à la base des décisions et des réalisations qui, plus tard, furent adoptées comme évidentes par l’humanité entière. Tout comme quelque principe militaire évident, qui aujourd’hui constitue pour nous le fondement même de toute stratégie, a forcément dû, à l’origine, sa conception à une tête bien déterminée, et ce n’est qu’après des années, voire des millénaires, qu’il a fini par être admis par tous comme parfaitement évident.
L’homme ajoute une deuxième invention à la première : il apprend à mettre à son service d’autres objets et même d’autres êtres vivants et alors l’activité créatrice propre de l’homme commence à se manifester, telle que nous la voyons aujourd’hui ; l’emploi de la pierre taillée, la domestication des animaux, la découverte du feu, etc. ; chacune de ces inventions, jusques et y compris toutes celles qui nous émerveillent de nos jours, révèle nettement, à la base, le travail créateur de l’individu ; ceci nous apparaît d’autant mieux qu’elles sont plus récentes, plus importantes ou d’un caractère plus surprenant. Nous savons donc, en tout état de cause, que ce que nous voyons autour de nous d’inventions matérielles est entièrement le produit de la force créatrice et des aptitudes de l’individu isolé. Et toutes ces créations contribuent, en définitive, à élever de plus en plus l’homme au-dessus de l’animal jusqu’à l’en distinguer radicalement. Ainsi elles sont la base même des progrès constants de l’espèce humaine. Et cette même ruse primitive qui permit jadis au chasseur de la forêt préhistorique de défendre son existence, aide encore les hommes dans leur existence d’aujourd’hui, sous la forme des plus merveilleuses conquêtes scientifiques, et elle leur permet de forger des armures pour les luttes de l’avenir. Toute réflexion, toute invention humaine facilite, en définitive, les luttes de l’homme sur cette planète, même si l’on ne peut voir, sur l’instant, l’utilité pratique d’une invention, d’une découverte ou d’un profond aperçu scientifique. Et tout cela contribue à élever l’homme au-dessus des êtres vivants qui l’entourent, et renforce et consolide sa situation au point d’en faire sous tous les rapports la créature reine sur cette terre.
On voit que toutes les inventions sont le résultat de la puissance créatrice d’individus isolés. Ces derniers sont ainsi à quelque degré, qu’ils l’aient voulu ou non, des bienfaiteurs de l’humanité. Leur action met dans la main de millions et même de milliards d’êtres humains des moyens qui leur rendront plus aisée la lutte pour la vie.
À l’origine de la civilisation matérielle de nos jours, nous trouvons donc toujours la personnalité d’inventeurs qui se complètent et se prolongent mutuellement. Il en est exactement de même lors de la mise en œuvre et de l’application pratique des inventions ou des découvertes. Car l’ensemble des méthodes de production relève encore du travail d’invention et par suite de l’individu.
Enfin le travail intellectuel purement théorique, qui échappe à toute mesure, mais qui constitue la condition première de toute invention technique ultérieure, apparaît aussi comme le produit exclusif de la personnalité.
Ce n’est pas la masse qui crée ni la majorité qui organise ou réfléchit, mais toujours et partout l’individu isolé.
Une communauté d’hommes apparaît comme bien organisée alors seulement qu’elle facilite au maximum le travail de ces forces créatrices et qu’elle les utilise au mieux des intérêts de la communauté. Ce qui a le plus de prix pour l’invention, qu’elle se rapporte au monde matériel ou au monde de la pensée, c’est d’abord la personne de l’inventeur. Le premier et suprême devoir dans l’organisation d’une communauté est de l’utiliser au profit de tous.
En vérité, l’organisation elle-même ne doit pas perdre de vue un seul instant l’application de ce principe. Ainsi seulement elle sera libérée de la malédiction du mécanisme et deviendra un organisme vivant. Elle doit elle-même personnifier la tendance à placer les têtes au-dessus de la masse et réciproquement à mettre celle-ci sous leurs ordres.
Par suite, non seulement une organisation n’a pas le droit d’empêcher les têtes de « sortir » de la masse, mais, au contraire, la nature même de son action doit le permettre et le faciliter au plus haut point. En cela elle doit partir du principe que la providence de l’humanité n’a jamais été dans la masse, mais dans ses cerveaux créateurs, qui sont vraiment les bienfaiteurs de la race humaine. C’est l’intérêt de tous de leur assurer une influence déterminante et de faciliter leur action. Car ce n’est certes ni la domination des imbéciles ou des incapables, ni, en aucun cas, le culte de la masse qui servira cet intérêt de tous ; il faudra nécessairement que des individus supérieurement doués prennent la chose en mains.
La recherche des têtes se fait surtout, nous l’avons dit, par la dure sélection de la lutte pour la vie. Beaucoup sont brisés et périssent, montrant ainsi qu’ils ne sont pas désignés, et bien peu apparaissent finalement comme élus. Dans le domaine de la pensée, de la création artistique, voire de l’économie, ce processus de sélection se manifeste encore aujourd’hui, bien que grevé de lourdes charges dans ce dernier domaine. Le gouvernement de l’État et la puissance qu’incarne l’organisation militaire, sont également dominés par cette idée de la personnalité : on la retrouve partout sous la forme de l’autorité absolue sur les subordonnés, de la responsabilité complète à l’égard des chefs. Seule, la vie politique échappe aujourd’hui complètement à cette obligation naturelle. Toute la civilisation humaine résulte de l’activité créatrice de l’individu ; et pourtant le principe majoritaire l’emporte dans tout le gouvernement, surtout dans ses plus hautes sphères, et de là il empoisonne peu à peu toute la vie du pays, la décompose véritablement. Il faut aussi, au fond, imputer l’action destructrice du judaïsme à ses constants efforts pour miner, chez les peuples qui l’ont accueilli, l’influence de la personnalité et lui substituer celle de la masse. Le principe constructif des peuples aryens fait place au principe destructeur des Juifs. Ceux-ci deviennent les « ferments de décomposition » des peuples et des races, et, au sens le plus large, ils désagrègent la civilisation humaine. Quant au marxisme, il représente en somme comme l’effort du Juif dans le domaine de la civilisation pure pour exclure de toutes les formes de l’activité humaine la prépondérance de la personnalité et pour la remplacer par celle du nombre. À cette doctrine correspond, au point de vue politique, la forme parlementaire dont nous voyons les effets néfastes depuis l’infime cellule de la commune jusqu’au sommet de la nation ; dans le domaine économique, il provoque l’agitation syndicaliste qui, d’ailleurs, ne sert nullement les intérêts véritables des ouvriers, mais rien que les vues destructrices de la juiverie internationale. Exactement dans la mesure où l’économie est soustraite au principe de la personnalité et où elle se trouve livrée aux influences et à l’action de la masse, elle doit perdre sa précieuse puissance créatrice et marquer une inévitable régression. Toutes les organisations consultatives professionnelles qui, au lieu de prendre vraiment les intérêts des employés, s’efforcent d’acquérir une influence sur la production elle-même, servent le même but destructeur. Elles font du tort à la production générale, et par là même à l’individu.
Car ce n’est pas avec des phrases et des théories que l’on peut satisfaire les besoins des ressortissants d’un peuple ; c’est grâce à la portion des biens collectifs qui échoit chaque jour à chacun, et lui prouve que la communauté sert les intérêts de l’individu grâce au travail de tous.
La question n’est pas de savoir si le marxisme, en se basant sur sa théorie des masses, serait capable de prendre et de continuer la charge de l’économie actuelle. La discussion sur la justesse ou la fausseté de ce principe ne serait point tranchée par la preuve de son aptitude à gérer dans l’avenir l’état de chose existant ; elle ne pourrait l’être que par la preuve de sa capacité à créer une civilisation semblable. Le marxisme aurait beau reprendre mille fois l’économie actuelle et continuer d’en diriger le fonctionnement, quel que soit le succès de cette activité, ce succès n’aurait pas la moindre portée vis-à-vis du fait positif que le marxisme ne pourrait jamais, par l’application de ses propres principes, créer ce dont il aurait ainsi hérité.
Et, de fait, le marxisme en a fourni lui-même la preuve. Non seulement il n’a jamais créé la moindre civilisation, le moindre système économique, mais il n’a même pas été capable d’utiliser, avec ses principes, les organismes qui lui furent confiés ; après un très court laps de temps, il a dû céder, et faire des concessions au principe de la personnalité, preuve que son organisation elle-même ne peut échapper à cette loi.
Ce qui doit distinguer foncièrement nos conceptions racistes et celles des marxistes, c’est que les premières reconnaissent non seulement la valeur de la race, mais aussi l’importance de la personnalité et qu’elles en font la base de toute construction positive. Ce sont les facteurs essentiels de leur philosophie.
Si, par hasard, le mouvement national-socialiste n’avait pas compris l’importance fondamentale de cette notion essentielle, s’il se bornait à rapetasser tant bien que mal notre état actuel et admettait le règne des majorités, il ne serait, en réalité, qu’un parti concurrent du marxisme ; il n’aurait dès lors plus le droit de se considérer comme une doctrine philosophique.
Si le programme social du mouvement se bornait à éliminer la personnalité et à mettre à sa place la majorité, alors le national-socialisme apparaîtrait à son tour rongé par le poison du marxisme comme le sont actuellement les partis bourgeois.
L’État raciste doit veiller au bien-être de ses citoyens, en reconnaissant en toutes circonstances l’importance de la personnalité : il augmentera ainsi la capacité de production de tous et par là même le bien- être de chacun.
Ainsi l’État raciste doit libérer entièrement tous les milieux dirigeants et plus particulièrement les milieux politiques du principe parlementaire de la majorité, c’est-à-dire de la décision de la masse ; il doit leur substituer sans réserve le droit de la personnalité.
Il en résulte que :
La meilleure constitution et la meilleure forme de l’État est celle qui assurera naturellement aux meilleurs éléments de la communauté l’importance du guide et l’influence du maître.
Dans la vie économique les plus capables ne peuvent être désignés d’en haut, mais doivent se mettre en évidence par eux-mêmes : l’instruction se recueille à tous les échelons, de la plus humble boutique à la plus énorme entreprise, et l’existence seule continue à faire passer des examens ; de même il est évident que les chefs politiques ne peuvent se « trouver » en un jour. Les génies d’une trempe extraordinaire ne sont pas soumis aux mêmes règles que l’humanité courante.
Toute l’organisation de l’État doit découler du principe de la personnalité, depuis la plus petite cellule que constitue la commune jusqu’au gouvernement suprême de l’ensemble du pays.
Il n’y a pas de décisions de la majorité, mais seulement des chefs responsables et le mot « conseil » doit reprendre sa signification primitive. Chaque homme peut bien avoir à son côté des conseillers, mais la décision est le fait d’un seul.
Il faut transposer le principe qui fit autrefois de l’armée prussienne le plus admirable instrument du peuple allemand et l’établir à la base même de notre système politique : la pleine autorité de chaque chef sur ses subordonnés et sa responsabilité entière envers ses supérieurs.
Même à ce moment nous ne pourrons pas nous passer de ces corporations que l’on appelle parlements. Seulement, toutes leurs délibérations deviendront réellement des conseils et un seul homme pourra et devra être investi de la responsabilité, ensemble avec l’autorité et le droit de commandement.
Les parlements sont par eux-mêmes nécessaires, car, avant tout, ils constituent un milieu où pourra se faire petit à petit l’éducation des chefs à qui l’on pourra un jour confier des responsabilités.
Et nous pouvons tracer alors le tableau suivant :
L’État raciste, depuis la commune jusqu’au gouvernement du Reich, ne possédera aucun corps représentatif qui décide quoi que ce soit par voie de majorité, mais seulement des corps consultatifs qui se trouveront sans cesse aux côtés du chef et qui recevront leur tâche de lui ; parfois même ils pourront, au besoin, dans certains domaines, prendre des responsabilités entières comme ce fut toujours le cas pour tous les chefs ou présidents des corporations.
L’État raciste ne peut tolérer que l’on demande avis ou décision sur des problèmes particuliers – par exemple sur des questions économiques – à des gens qui, par leur formation et leur activité, sont complètement incompétents. En conséquence, il divisera ses corps représentatifs en chambres politiques et chambres corporatives.
Pour rendre leur coopération féconde, on placera toujours au-dessus d’elles un corps choisi : le sénat.
Ni dans les chambres ni dans le sénat, il n’y aura jamais un vote quelconque. Ce sont des organismes de travail et non des machines à voter. Chacun de leurs membres possède une voix consultative, mais aucun droit de décision. Celle-ci appartient exclusivement au président qui en garde la responsabilité.
Ce principe : associer sans restriction la responsabilité absolue avec l’autorité absolue déterminera peu à peu une élite de chefs (telle qu’on ne saurait se l’imaginer aujourd’hui) à notre époque d’irresponsabilité parlementaire.
Ainsi la constitution de l’État sera mise en harmonie avec le principe auquel il doit déjà sa grandeur dans le domaine économique et celui de la civilisation.
* * *
« En ce qui concerne la possibilité de réaliser ces conceptions, qu’on n’oublie pas que le principe parlementaire de décision par majorité n’a nullement régi le monde de toute éternité, mais, tout au contraire, qu’on n’en trouve trace dans l’histoire qu’en des périodes très courtes ; et ces périodes correspondent toujours à la ruine des peuples et des États ! »
Il ne faudrait pourtant pas croire que des mesures purement théoriques prises, d’en haut, puissent amener un tel changement qui, logiquement, ne doit pas se limiter à la constitution de l’État, mais intéresser la législation, pénétrer toute la vie publique de chacun. Une pareille révolution ne peut se produire et ne se produira que sous l’influence d’un parti nourri de ces idées et portant en lui le germe de l’État futur.
Aussi le parti national-socialiste doit-il, aujourd’hui, se pénétrer de ces pensées ; il doit orienter son organisation intérieure vers l’action pratique, pour pouvoir non seulement donner un jour à l’État des directives, mais pour pouvoir lui fournir le corps constitué de son propre État.
Chapitre 5 – Conception philosophique et organisation
L’État raciste, dont j’ai voulu donner un tableau d’ensemble, ne se trouve pas réalisé du seul fait que l’on connaît les conditions indispensables à son existence. Il ne suffit pas de savoir comment sera un État raciste ; il faut d’abord le créer. On ne peut pas s’attendre à ce que les partis actuels, qui avant tout tirent profit de l’État tel qu’il est, arrivent d’eux-mêmes à un changement radical et transforment spontanément leur attitude. D’autant que leurs dirigeants sont toujours des Juifs et encore des Juifs. L’évolution que nous sommes en train de subir, si elle n’était enrayée, nous mettrait un jour devant la prophétie panjuive : « Le Juif dévorera effectivement les peuples de la terre et deviendra leur seigneur. »
Ainsi, vis-à-vis de millions de « bourgeois » ou de « prolétaires » allemands, qui, pour la plupart, courent à leur perte par paresse et sottise, doublées de lâcheté, le Juif, pleinement conscient du but qu’il poursuit, ne rencontre aucune résistance sur sa route. Un parti dirigé par lui ne peut lutter pour rien d’autre que pour les intérêts juifs, et ces intérêts n’ont rien de commun avec les aspirations essentielles des peuples aryens.
Veut-on donc transposer l’État raciste du domaine idéal dans la réalité, il faut tout d’abord chercher, en dehors de toutes les puissances actuelles de la vie publique, une force neuve qui ait la volonté et les moyens de mener le combat pour un tel idéal. Car il s’agit bien ici d’un combat : notre première tâche n’est pas de créer une forme d’État raciste, mais de détruire l’État juif actuel. Comme l’histoire le montre bien souvent, la principale difficulté n’est pas d’instituer un nouvel état de choses, mais bien de lui faire la place libre. Préjugés et intérêts s’entremêlent en une phalange serrée et tentent d’empêcher, par tous les moyens, la victoire d’une idée qui leur est désagréable ou leur paraît menaçante.
Aussi le soldat de notre nouvel idéal doit-il, malgré tout son enthousiasme positif, mener d’abord une lutte négative pour se défaire de l’état actuel.
Une jeune et noble doctrine, aux principes neufs et d’une importance essentielle, devra, si désagréable que cela puisse être à chacun, manier d’abord sans ménagement l’arme de la critique.
Nous entendons aujourd’hui les soi-disant Racistes répéter à tout propos – et ceci prouve bien le peu de profondeur de leurs vues en matière historique – qu’ils refusent de se vouer à une critique négative, pour consacrer toute leur activité à un travail constructif ; balbutiement puéril et stupide, authentiquement « raciste » en un mot ; preuve enfin que l’histoire de leur propre époque n’a pas laissé la moindre trace dans ces têtes-là. Le marxisme aussi avait un but, et lui aussi connaît un travail constructif (s’il ne s’agit ici que d’instaurer le despotisme de la juiverie internationale et de la finance cosmopolite !), mais il n’en a pas moins commencé par la critique durant soixante-dix ans ; critique destructive et dissolvante, et critique encore et toujours, jusqu’à ce que cet acide corrosif ait rongé le vieil État et l’ait fait tout mûr pour l’écroulement. Alors seulement a commencé la prétendue « construction ». C’était évident, juste et logique. Un état de choses existant ne peut s’effacer simplement devant les prophètes et les avocats d’un état futur. On ne peut admettre que les partisans du premier, ou même ceux qui lui portent simplement quelque intérêt, seront tout à fait convertis par la seule constatation d’une nécessité et gagnés ainsi à l’idée d’un régime nouveau. Trop souvent, au contraire, les deux régimes continueront à exister simultanément et la prétendue doctrine philosophique s’enfermera à jamais dans le cadre étroit d’un parti. Car une doctrine n’est pas tolérante ; elle ne peut être « un parti parmi les autres » ; elle exige impérieusement la reconnaissance exclusive et totale de ses conceptions, qui doivent transformer toute la vie publique. Elle ne peut tolérer près d’elle aucun vestige de l’ancien régime.
C’est la même chose pour les religions.
Le christianisme non plus n’a pas pu se contenter d’élever ses propres autels, il lui fallait procéder à la destruction des autels païens. Seule, cette intolérance fanatique devait créer la foi apodictique ; elle en était une condition première absolue.
On peut objecter, à juste titre, que ces deux précédents historiques sont spécifiquement juifs – et même que ce genre d’intolérance et de fanatisme sont foncièrement juifs. Ceci peut être mille fois vrai et on peut aussi le déplorer profondément ; on peut constater, avec une inquiétude qui n’est que trop justifiée, que l’apparition de cette doctrine dans l’histoire de l’humanité y introduisait quelque chose que l’on ne connaissait pas encore ; mais cela ne sert de rien et il s’agit maintenant d’un état de fait. Les hommes qui veulent sortir notre peuple allemand de sa situation actuelle, n’ont pas à se casser la tête pour imaginer combien ce serait beau si telle ou telle chose n’existait pas ; ils doivent rechercher et déterminer comment on peut supprimer ce qui en fait est donné. Mais une doctrine pleine de la plus infernale intolérance ne sera brisée que par la doctrine qui lui opposera le même esprit, qui luttera avec la même âpre volonté et qui, par surcroît, portera en elle-même une pensée nouvelle pure et absolument conforme à la vérité.
Chacun peut aujourd’hui constater à regret que, dans le monde antique, beaucoup plus libre que le nôtre, le christianisme a introduit avec lui la première terreur spirituelle ; mais il ne peut rien au fait que, depuis cette époque, le monde vit sous le signe et sous la domination de cette contrainte. Et on ne brise la contrainte que par la contrainte, la terreur par la terreur. C’est alors seulement que l’on peut instituer un nouveau régime. Les partis politiques sont enclins à des compromissions ; les doctrines philosophiques, jamais. Les partis politiques composent même avec leurs adversaires, les doctrines philosophiques se proclament infaillibles. Les partis politiques, eux aussi, ont presque toujours, à l’origine, l’intention d’arriver à une domination despotique et exclusive ; ils marquent presque toujours une certaine inclination vers telle ou telle doctrine philosophique. Mais déjà l’étroitesse de leur programme leur enlève l’héroïsme qu’exige la défense d’une véritable doctrine philosophique. Leur conciliant vouloir groupe autour d’eux les esprits petits et faibles, avec qui l’on ne saurait mener une croisade. Et ils en demeurent ainsi le plus souvent confinés de bonne heure dans leur pitoyable petitesse. Abandonnant la lutte pour un système, ils s’efforcent alors de gagner le plus promptement possible, grâce à une soi-disant « collaboration positive », une petite place au râtelier des institutions existantes et d’y rester le plus longtemps possible. Ils bornent là leurs efforts. Et si jamais ils sont écartés de la mangeoire par un concurrent d’allures un peu brutales, alors ils n’ont plus qu’une seule idée : par force ou par ruse, se remettre au premier rang des « moi aussi j’ai faim », pour pouvoir de nouveau, même au prix de leurs plus sacrées convictions, participer à cette manne précieuse. Chacals de la politique !
Une doctrine philosophique ne saurait être prête à composer avec une autre ; elle ne saurait non plus accepter de collaborer à un état de fait qu’elle condamne ; au contraire, elle sent l’obligation de combattre ce régime et tout le monde moral adverse, en un mot de préparer leur ruine.
Ce combat purement destructif – dont tout le danger est aussitôt senti par les autres et qui se heurte à un front uni de résistance – tout comme le combat positif mené pour consacrer le succès de la nouvelle conception idéale du monde, exige des combattants résolus. Ainsi donc une doctrine ne fera triompher ses idées que si elle groupe sous sa bannière les éléments les plus courageux et actifs de son époque et de son peuple, en une organisation puissante de combat. Il faut en outre que, tenant compte de ces éléments, elle choisisse, dans l’ensemble de sa philosophie, un certain nombre d’idées, et qu’elle leur donne la forme précise et lapidaire, pouvant servir d’article de foi à un nouveau groupement d’hommes. Tandis que le programme d’un simple parti politique n’est qu’une recette pour l’issue favorable des prochaines élections, le programme d’une doctrine philosophique a la valeur d’une déclaration de guerre contre l’ordre établi, contre un état de choses existant, contre une conception pratique de l’existence.
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que chacun de ceux qui combattent pour la doctrine soit complètement mis au courant ni qu’il connaisse exactement chacune des pensées du chef du mouvement. L’essentiel est qu’il soit clairement instruit de quelques principes fondamentaux, peu nombreux, mais très importants. Dès lors, il sera à tout jamais pénétré de ces principes, convaincu aussi de la nécessité de la victoire de son parti et de sa doctrine. Le soldat non plus n’est pas immiscé dans les plans des grands chefs. De même qu’il vaut mieux le former à une discipline rigide, à la conviction que sa cause est juste et doit triompher et qu’il doit s’y vouer tout entier, de même doit-il en être de chaque partisan d’un mouvement de grande envergure, appelé au plus grand avenir, soutenu par la volonté la plus ferme.
Que pourrait-on faire d’une armée dont tous les soldats seraient des généraux, en eussent-ils les dons et les capacités ? De même, de quelle utilité serait, pour la défense d’une doctrine, un parti qui ne serait qu’un réceptacle de gens « éminents ». Non, il faut aussi le simple soldat, sans quoi on ne peut obtenir une discipline intérieure.
De par sa nature même, une organisation ne peut subsister qu’avec un haut commandement intelligent, servi par une masse que guide plutôt le sentiment. Une compagnie de deux cents hommes intelligents autant que capables deviendrait, à la longue, plus difficile à mener que si elle contenait cent quatre-vingt-dix hommes moins bien doués et dix autres ayant une formation supérieure.
La Social-Démocratie a tiré de ce fait le plus grand profit. Elle a étendu sa domination sur les innombrables représentants des couches populaires, à peine libérés de l’armée et qui y avaient été dressés à la discipline ; elle leur a imposé une discipline du parti aussi rigide que la première. Là aussi, l’organisation comporte des officiers et des soldats. En quittant le service militaire, l’ouvrier allemand devenait le soldat, l’intellectuel juif devenait l’officier ; les employés des syndicats formaient à peu près l’équivalent des sous-officiers. Ce qui faisait toujours hocher la tête à votre bourgeoisie – c’est-à-dire le fait que seules les masses dites ignorantes adhèrent au marxisme – était, en réalité, la condition première du succès marxiste. Tandis que les partis bourgeois, dans leur uniforme intellectualité, constituaient une masse indisciplinée et incapable d’agir, le marxisme constituait, avec un matériel humain moins intelligent, une armée de militants qui obéissaient aussi aveuglément au dirigeant juif qu’ils avaient obéi autrefois à leur officier allemand. La bourgeoisie allemande, qui ne s’est jamais préoccupée sérieusement des problèmes de psychologie, se jugeant bien au-dessus de ces choses-là, ne trouva pas nécessaire, cette fois non plus, de réfléchir assez longtemps pour reconnaître le sens profond et le danger intime de cette situation de fait. On croyait, au contraire, qu’un mouvement politique qui se recrute uniquement dans les milieux « intellectuels », possède par là même plus de valeur et qu’il a des prétentions mieux fondées, et de meilleures chances que la masse inculte, de parvenir au pouvoir. On n’avait jamais compris que la force d’un parti politique ne réside nullement dans l’intelligence et l’indépendance d’esprit de chacun de ses membres, mais bien plutôt dans l’obéissance et l’esprit de discipline avec lesquels ceux- ci suivent le commandement spirituel. Ce qui est décisif, ce sont les chefs eux-mêmes. Quand deux troupes s’affrontent, la victoire n’appartient pas à celle dont chaque soldat a reçu l’instruction stratégique la plus poussée, mais à celle qui possède le meilleur commandement et la troupe la mieux disciplinée, la plus aveuglément obéissante et la mieux entraînée.
Ceci est une notion fondamentale que nous ne devons jamais perdre de vue, lorsque nous examinerons la possibilité de transposer dans la réalité un système philosophique.
Si donc, pour mener nos conceptions à la victoire, nous devons les transformer en un parti de combat, il faut logiquement que le programme de ce dernier tienne compte du matériel humain dont on dispose. Autant les objectifs et les idées conductrices doivent être inébranlables, autant le programme de propagande doit être ajusté avec intelligence et avec une juste psychologie aux âmes de ceux sans l’aide desquels la plus belle des idées ne demeurera éternellement qu’une idée.
Si l’idée raciste, aujourd’hui obscure velléité, veut obtenir un brillant succès, il faut qu’elle tire de tout son système idéal un certain nombre de principes directeurs, dont la forme et le fond puissent s’imposer à une grande masse d’hommes et à celle-là même qui est la seule garantie de succès pour le combat doctrinal de cette idée, j’ai nommé la classe ouvrière allemande.
C’est pourquoi le programme du nouveau parti fut condensé en quelques principes fondamentaux, vingt- cinq points en tout. Ils sont destinés à donner en premier lieu à l’homme du peuple une image grossière des aspirations du mouvement. Ils constituent, dans une certaine mesure, une profession de foi politique qui gagne des gens à la cause, et, qui, en outre, concrétant une obligation commune, unit et amalgame ensemble les nouveaux adhérents.
En tout cela, nous ne devons jamais perdre de vue que le programme du parti, d’une absolue justesse dans ses objectifs, a dû tenir compte, dans sa rédaction, de certaines considérations psychologiquement importantes ; et l’on peut très bien se persuader, avec le temps, qu’un certain nombre des principes directeurs pourraient être énoncés différemment, rédigés sous une forme plus heureuse. Mais toute tentative de ce genre serait d’un effet désastreux. L’on abandonne ainsi à la discussion une chose qui doit demeurer tout à fait inébranlable ; or, dès qu’un point isolé se trouve séparé du dogme, la discussion n’aboutit pas simplement à un énoncé nouveau meilleur et surtout à un énoncé renforçant l’homogénéité du dogme, mais elle mène bien plutôt à d’interminables débats et à une universelle confusion. En pareil cas, il faut toujours considérer avec soin ce qui est préférable : une rédaction nouvelle, qui occasionne une dissociation à l’intérieur du mouvement, ou une forme qui, pour le moment, n’est peut-être pas la meilleure de toutes, mais qui constitue un organisme autonome, solide et d’une parfaite unité intérieure. Et tout examen démontrera que cette dernière solution est la seule à retenir. Car les modifications ne portant jamais que sur la forme extérieure à donner, il apparaîtra toujours de pareilles modifications possibles ou désirables. Mais le gros danger est que le caractère superficiel des hommes leur fasse voir la tâche essentielle du mouvement dans cette question de pure forme de la rédaction d’un programme. Dans ces conditions, la volonté et la force de combattre pour une idée s’effacent et l’activité qui devait se tourner vers le dehors s’use dans des querelles intérieures de programme. Pour une doctrine dont la justesse des grandes lignes n’est pas en cause, il est moins nuisible de conserver un énoncé – ne correspondrait-il pas tout à fait à la réalité – que de vouloir l’améliorer et de livrer ainsi à la discussion générale le dogme du parti, jusque-là aussi ferme que du granit. Ceci est particulièrement impossible tant que le parti combat encore pour assurer son triomphe. Car, comment vouloir emplir des hommes d’une aveugle confiance dans la justesse d’une doctrine, quand on propage le doute et l’incertitude par de continuelles modifications de sa structure extérieure.
On ne doit donc jamais chercher l’essentiel dans la forme extérieure, mais seulement dans le sens profond. Celui-ci est immuable ; et dans son intérêt même, on ne peut que souhaiter que le mouvement conserve la puissance nécessaire pour le faire triompher, en écartant toutes les causes d’hésitation ou de division.
Ici encore, il nous faut prendre des leçons de l’Église catholique. Bien que son édifice doctrinal, sur plus d’un point – et souvent d’ailleurs d’une manière surtout apparente – heurte la science exacte et l’observation, elle se refuse pourtant à sacrifier la plus petite syllabe des termes de sa doctrine. Elle a reconnu très justement que sa force de résistance ne réside pas dans un accord plus ou moins parfait avec les résultats scientifiques du moment, résultats d’ailleurs jamais définitifs, mais dans son attachement inébranlable à des dogmes établis une fois pour toutes, et qui seuls confèrent à l’ensemble le caractère d’une foi. Aussi se maintient-elle aujourd’hui plus fermement que jamais. On peut même prophétiser que dans la mesure où les phénomènes insaisissables défient et continueront à défier la poursuite des lois scientifiques sans cesse modifiées, elle sera de plus en plus le pôle de tranquillité vers lequel ira aveuglément l’attachement d’innombrables humains.
Quiconque souhaite donc réellement et sérieusement la victoire des idées racistes, doit se pénétrer de l’idée que ce triomphe exige d’abord nécessairement l’intervention d’un parti de combat ; ensuite, qu’un tel parti ne saurait subsister sans recevoir la base inébranlable, condition de toute sûreté et de toute solidité, que constitue son programme. Le parti n’a pas le droit de faire des concessions à l’esprit de l’époque pour la rédaction de ce programme ; au contraire, une fois celle-ci arrêtée au mieux, il doit s’y tenir sinon à jamais, et en tous cas tant que la victoire n’a pas couronné ses efforts. Avant ce terme, toute tentative d’ouvrir des discussions sur l’opportunité de tel ou tel point du programme brisera l’unité du parti, et affaiblira l’esprit de lutte de tous ceux de ses partisans qui y auront été mêlés. Ceci ne veut point dire d’ailleurs qu’une telle « amélioration » une fois effectuée échapperait demain à un nouvel examen critique, et qu’elle ne devrait pas après-demain céder la place à une forme meilleure. Quiconque renverse ici les barrières édifiées ouvre une voie dont on voit bien le commencement, mais dont l’aboutissement se perd dans l’infini.
Le jeune parti national-socialiste ne devait pas perdre de vue la portée pratique de ces enseignements. Le parti ouvrier allemand national-socialiste a reçu avec son programme de vingt-cinq points une base qui doit demeurer immuable. Il n’appartient pas à ses membres actuels et futurs de les critiquer et de les changer ; ce sont eux qui leur tracent leur devoir. Sans quoi la prochaine génération aura le même droit de dissiper à nouveau ses forces dans un travail de pure forme à l’intérieur du parti, au lieu de lui amener la force nouvelle de nouveaux adhérents. Pour la majorité des partisans, l’essentiel du mouvement ne sera donc pas tant dans la lettre de nos principes directeurs que dans l’esprit dont nous pouvons les animer.
C’est à ces considérations que notre jeune mouvement dut autrefois son nom, et plus tard son programme ; c’est sur elles que se base encore notre mode de propagande. Pour aider les idées racistes à triompher, il a fallu créer un parti populaire, parti ne comprenant pas seulement un état-major d’intellectuels, mais aussi des travailleurs manuels.
Toute tentative de donner corps aux théories racistes sans une pareille organisation de combat demeurerait vaine aujourd’hui comme par le passé, et comme dans un avenir quelconque. C’est pourquoi le mouvement a non seulement le droit, mais le devoir de se considérer comme le champion et le représentant des idées racistes. Autant les idées qui sont à la base du mouvement national-socialiste sont racistes, autant, de leur côté, les idées racistes appartiennent au national- socialisme. Et si ce dernier veut l’emporter, il lui faut se rallier sans réserves et d’une manière exclusive à ce point de vue. Ici encore, il a non seulement le droit, mais le devoir de bien faire ressortir que toute tentative de représenter les idées racistes hors du national- socialisme doit avorter, et d’ailleurs, dans la plupart des cas, manque de sincérité.
Quand quelqu’un reproche aujourd’hui à notre mouvement d’avoir « pris à bail » l’idée raciste, il n’y a qu’une réponse à lui faire :
Pas seulement pris à bail, mais rendu utilisable.
Car ce que l’on entendait auparavant par ce vocable n’était pas le moins du monde capable d’avoir quelque influence sur le destin de notre peuple. Il manquait à ces idées une forme claire et cohérente. Le plus souvent, il ne s’agissait que de notions isolées sans rapport entre elles, plus ou moins exactes – qui n’étaient pas sans se contredire parfois – en tous cas, sans la moindre liaison intime. Et celle-ci eût-elle existé, elle eût été trop faible pour fonder et construire dessus un parti.
Seul, le parti national-socialiste a mené à bien cette tâche.
* * *
Si aujourd’hui toutes les associations, tous les groupes, grands et petits – et, à mon avis, même de
« grands partis » – revendiquent le mot « raciste », c’est la conséquence de l’action du parti national-socialiste. Sans son travail, il ne serait même pas venu à l’idée d’une de ces organisations de prononcer seulement le mot « raciste » ; ce vocable n’aurait rien représenté pour eux, et leurs dirigeants surtout n’auraient jamais eu le moindre rapport d’aucune sorte avec lui. Seule, l’action du N. S. D. A. P. a donné à ce mot une signification substantielle, et l’a mis dans la bouche de tout le monde. Avant tout le parti a montré, par le succès de sa propre propagande, la force de l’idée raciste, et l’appât du gain a poussé les autres à en vouloir autant, tout au moins en paroles.
De même que, jusqu’alors, ils avaient tout mis au service de leurs mesquines spéculations électorales, de même ces partis ne voient aujourd’hui dans le mot « raciste » qu’une formule vaine et creuse, avec laquelle ils tentent de neutraliser la force d’attraction qu’exerce sur leurs propres membres le parti national-socialiste. Car, seul, le souci de leur propre existence et leur inquiétude devant les succès grandissants de la doctrine de notre parti – dont ils pressentent aussi bien l’importance universelle que la dangereuse intransigeance – leur mettent ce mot à la bouche : ils l’ignoraient il y a huit ans ; ils s’en gaussaient il y a sept ans ; il y a six ans, ils le combattaient ; l’année suivante, ce fut de la haine, et il y a trois ans, la persécution ; enfin, il y a deux ans, ils se l’annexaient, pour s’en servir comme de cri de guerre dans la lutte, de pair avec le reste de leur vocabulaire.
Et il convient aujourd’hui encore de faire remarquer que tous ces partis n’ont pas la moindre idée de ce qui fait besoin à notre peuple allemand. Il suffit de voir avec quelle légèreté leurs gueules prononcent ce mot de « raciste ».
Non moins dangereux, tous ces semble-racistes qui ne cessent de tourner, échafaudant des plans fantastiques, qui ne s’appuient le plus souvent que sur une idée fixe, juste peut-être en elle-même, mais qui ne saurait, considérée toute seule, avoir la moindre valeur pour la formation d’une communauté de combat, et, en tous cas, pour en édifier une. Tous ces gens qui brassent un programme composé moitié de leurs propres pensées, moitié du fruit de leurs lectures, sont souvent plus dangereux que les ennemis déclarés de l’idée raciste. Ce sont, dans les conditions les plus favorables, des théoriciens stériles, mais souvent aussi de néfastes hâbleurs qui, avec leur barbe de fleuve, et en jouant les Teutons, s’imaginent masquer le vide de leur activité et de leur savoir.
Aussi est-il bon d’opposer à toutes ces tentatives impuissantes le souvenir de l’époque où le jeune mouvement national-socialiste entrait dans l’arène.
Chapitre 6 – Lutte des premiers temps – L’importance de la parole
La première grande réunion du 24 février 1920 dans la salle des fêtes du Hofbräuhaus (Maison de la Brasserie de la Cour, nom d’une grande brasserie de Munich) vibrait encore en nous, quand il fallut se mettre à préparer la seconde. Tandis que jusqu’alors il nous avait paru douteux que l’on pût organiser tous les mois ou tous les quinze jours une petite réunion dans une ville comme Munich, il fallait maintenant que tous les huit jours, c’est-à-dire une fois par semaine, une grande réunion populaire eût lieu. Je n’ai pas besoin de souligner qu’un seul et même souci nous tourmentait : les gens viendraient-ils et nous écouteraient-ils ? À vrai dire, j’avais quant à moi cette conviction inébranlable : une fois que les gens seraient là, ils resteraient et ils écouteraient nos discours.
En ces temps-là la salle des fêtes du Hofbräuhaus de Munich prit une importance presque sacramentelle pour nous, les nationaux-socialistes. Chaque semaine, une réunion, presque toujours dans cette même salle, et chaque fois la salle mieux remplie et les auditeurs plus fervents ! On parla de presque tout ce qui avait quelque importance pour la propagande ou ce qui était nécessaire au point de vue idéologique, en commençant par la question des « responsabilités de guerre », ce dont personne ne se souciait à cette époque, et des traités de paix. Que de choses le jeune mouvement a prédites alors, sans relâche, aux grandes masses, et comme presque tout s’est réalisé jusqu’à présent ! Aujourd’hui, il est plus facile de parler ou d’écrire sur ces choses. Mais alors on considérait qu’une grande réunion publique, à l’adresse non pas des bourgeois cossus, mais des prolétaires égarés, sur « Le Traité de Versailles », était une attaque contre la république et le symptôme d’une mentalité réactionnaire, voire monarchiste. Dès la première phrase contenant une critique du traité de Versailles, on vous jetait à la tête la réplique stéréotypée : « Et Brest-Litowsk ? Brest- Litowsk ! » Les masses hurlaient cela à perte de souffle ou jusqu’à l’enrouement, ou bien jusqu’à ce que le conférencier renonçât finalement à sa tentative de les persuader. On aurait voulu se casser la tête contre le mur par désespoir devant un pareil peuple ! Il ne voulait ni entendre, ni comprendre, que Versailles était une honte et un opprobre, ni même que ce Diktat signifiait une spoliation inouïe de notre peuple. Le travail destructeur des marxistes et le poison de la propagande ennemie avaient privé ces gens de toute raison. Et on n’avait même pas le droit de s’en plaindre. La bourgeoisie, qu’a-t-elle fait pour arrêter cette dissolution terrible, pour s’y opposer, pour ouvrir la voie à la vérité en éclairant mieux et plus nettement la situation ? Rien, trois fois rien ! Je ne les ai vus alors nulle part, ces grands apôtres racistes d’aujourd’hui. Peut-être ont-ils parlé dans de petits cercles, dans des salons de thé, ou dans des milieux professant les mêmes opinions ; mais ils ne se trouvèrent pas là où ils auraient dû être, au milieu des loups ; là, ils n’osaient paraître, sauf dans les occasions où ils pouvaient hurler avec eux.
Il m’était clair alors que pour les premiers militants dont se composait au début notre mouvement, il fallait vider à fond la question des responsabilités de guerre, et de la vider dans le sens de la vérité historique. La condition préalable du succès de notre mouvement était qu’il apportât aux grandes masses la connaissance du traité de paix. À cette époque, où tous voyaient encore dans cette paix une victoire de la démocratie, on devait faire front contre cette idée, et nous graver pour toujours dans la cervelle des hommes comme les ennemis de ce traité, afin que, par la suite, quand l’amère réalité aurait déchiré ces oripeaux mensongers et mis à nu leur essence de haine, le souvenir de notre attitude dans cette question nous amène la confiance des masses.
Dès cette époque, j’ai toujours insisté pour que, dans les grandes questions de principe, sur lesquelles toute l’opinion publique prenait une attitude erronée, nous nous élevions contre elle sans craindre l’impopularité ni la haine. Le parti ouvrier national-socialiste ne devait pas servir de gendarme à l’opinion publique, il devait la dominer. Il ne doit pas être le valet, mais le maître des masses !
Il existe naturellement, surtout pour tout mouvement encore faible, une grande tentation dans les moments où un adversaire bien plus puissant a réussi, par son art séducteur, à suggérer au peuple une résolution insensée ou une fausse position : c’est la tentation de marcher et de crier avec les autres, surtout quand quelques arguments – encore qu’illusoires – amènent à conclure dans le même sens que le propre point de vue du jeune mouvement. La lâcheté humaine recherchera en ce cas de tels arguments avec d’autant plus de ferveur qu’elle trouve presque toujours quelque chose qui lui donne l’ombre d’un droit, à son « propre point de vue », à prendre part à un pareil crime. J’ai fait plusieurs expériences pareilles où le maximum d’énergie fut nécessaire pour empêcher le navire de notre mouvement de se lancer dans le courant général artificiellement provoqué, ou plutôt de se laisser entraîner par ce courant. La dernière fois que cela arriva, ce fut quand notre presse infernale, à laquelle l’existence du peuple allemand importe autant que Hécube (Épouse de Priam dans l’Iliade), réussit à donner au problème du Tyrol du Sud une importance qui pouvait devenir fatale au peuple allemand. Sans se demander pour qui ils travaillaient de cette manière, nombre d’hommes, de partis, de ligues de la tendance qu’on appelle « nationale », se joignirent à la clameur générale, par lâcheté devant l’opinion publique façonnée par les Juifs, et contribuèrent stupidement à appuyer la lutte contre un système que nous, Allemands, nous devrions considérer, dans notre position actuelle, comme la seule éclaircie dans ce monde en décadence. Tandis que le Juif sans patrie et international nous serre à la gorge, lentement mais sûrement, nos soi-disant patriotes hurlent contre l’homme et le système qui ont osé, fût-ce sur un seul point du globe, se libérer de l’étreinte judéo- maçonnique, et opposer une résistance nationaliste à ce poison de l’idéologie internationale et universelle. Mais ce fut trop séduisant pour les caractères faibles d’amener simplement les voiles devant la tempête et de capituler devant les cris de l’opinion publique. Car il s’agit ici d’une capitulation. Les hommes, dans leur fausseté et leur vilenie intérieures, peuvent ne pas l’admettre, même dans leur for intérieur, mais il reste vrai que, seules, leur lâcheté et leur peur d’une excitation populaire, provoquée par les Juifs, les poussèrent à marcher avec les autres. Tous les autres motifs ne sont que subterfuges pitoyables de petits pécheurs conscients de leurs fautes.
Il fallut alors renverser la vapeur avec une poigne de fer pour que le mouvement ne perdît pas sa direction. Toute tentative dans ce sens au moment où l’opinion publique, attisée, s’élançait comme une flamme, ne pouvait être populaire ; elle pouvait même être un danger mortel pour l’audacieux qui l’entreprenait. Mais, dans l’histoire, les hommes sont nombreux qui ont été lapidés dans de pareils moments pour des actions qui leur valurent ensuite la reconnaissance émue de la postérité.
C’est là-dessus que doit compter un mouvement, et non sur l’approbation éphémère du présent. Il peut arriver à ces moments-là que l’un ou l’autre ait peur en son for intérieur ; mais qu’il n’oublie jamais qu’après une telle heure, viendra aussi la libération et qu’un mouvement qui veut régénérer un monde doit servir l’avenir et non le présent.
On peut établir ici que les succès les plus grands et les plus durables dans l’histoire sont généralement ceux qui restent à leur début les moins compris, parce qu’ils se trouvent en opposition violente avec l’opinion publique courante, avec ses vues et ses désirs.
Nous avons pu nous en rendre compte dès notre première réunion publique. Nous n’avons vraiment, jamais, « flatté les passions des masses », nous nous sommes partout opposés à la folie populaire. Presque toujours, pendant ces années-là, je m’adressais à des hommes qui croyaient le contraire de ce que j’allais leur dire et qui voulaient le contraire de ce que je croyais nécessaire. La tâche était donc celle-ci : en deux heures, détruire les convictions de deux à trois mille hommes, saper, coup après coup, les fondements de leurs opinions, et les conduire enfin sur le terrain de notre conviction et de notre conception des choses.
Dans un bref espace de temps, j’appris quelque chose d’essentiel : qu’il fallait tout d’abord arracher des mains de l’ennemi l’arme de sa riposte. On remarqua bientôt que nos adversaires, surtout leurs orateurs qui portaient la contradiction dans nos réunions, discouraient toujours suivant le même « répertoire », en élevant contre nos assertions des objections qui revenaient toujours, de sorte que la régularité de ce phénomène nous fit conclure qu’il s’agissait d’une éducation uniforme et orientée vers le même but. En effet, tel était le cas. Nous pûmes mesurer, à cette occasion, à quel point la propagande de nos adversaires était remarquablement disciplinée, et c’est encore aujourd’hui un sujet d’orgueil pour moi d’avoir trouvé le moyen non seulement de neutraliser cette « propagande » mais de battre ses auteurs avec leurs propres armes. Deux ans plus tard, j’étais passé maître dans cet art.
Il était essentiel de prévoir avant chaque discours la nature probable et la forme des objections qui lui seraient opposées dans la discussion et de les éplucher complètement à l’avance dans ce même discours. Il faut exposer, dès le début, les objections possibles, et prouver qu’elles sont peu fondées ; l’auditeur, qui est venu bourré d’objections qu’on lui avait inculquées, mais qui reste de bonne foi, se laisse gagner plus facilement en entendant réfuter les arguments qu’on a imprimés dans sa mémoire. Ce qu’on lui avait appris s’élimine de soi-même, et son attention est de plus en plus attirée par la conférence.
Ce fut pour cette cause qu’après ma première conférence sur « le traité de Versailles », que j’avais tenue en qualité « d’instructeur », déjà devant la troupe, je changeai son contenu, et je parlai dorénavant des
« traités de paix de Brest-Litowsk et de Versailles ». Car, dans l’espace de temps le plus bref, je pus constater, au cours de la discussion, que les gens ne savaient en réalité rien du traité de Brest-Litowsk, mais qu’une adroite propagande de parti était parvenue à le représenter comme un des actes de violence les plus condamnables de l’histoire. Cette insistance à présenter aux grandes masses toujours ce même mensonge explique pourquoi des millions d’Allemands voyaient, dans le traité de Versailles, une juste expiation du crime que nous avions commis à Brest-Litowsk ; ils considéraient en conséquence que toute lutte contre le traité de Versailles était injuste, et elle provoquait en eux une indignation tout à fait sincère. Ce fut aussi une des causes qui permirent au mot de « réparation », terme aussi monstrueux qu’insolent, de prendre droit de cité en Allemagne. Cette formule hypocrite et mensongère parut à des millions de nos compatriotes égarés l’arrêt d’une justice supérieure. C’est là une chose épouvantable, mais tel fut le cas. La meilleure preuve en est le succès de la propagande contre le traité de Versailles, que je faisais précéder par des éclaircissements sur le traité de Brest-Litowsk. Je mettais les deux traités vis-à-vis l’un de l’autre, je les comparais point par point, je démontrais que l’un de ces traités paraissait d’une humanité sans bornes en comparaison de la cruauté inhumaine de l’autre, et le résultat fut frappant. Je parlai sur ce thème dans des réunions de deux mille hommes où, parfois, les regards de trois mille six cents yeux hostiles se concentraient sur moi. Et trois heures plus tard, j’avais devant moi une masse palpitante, pleine de l’indignation la plus sacrée et animée d’une fureur sans bornes. Encore une fois, un grand mensonge avait été arraché du cœur et du cerveau d’une masse comptant des milliers d’hommes, et une vérité était plantée à sa place.
Je considérai alors que ces deux conférences : « Les vraies causes de la guerre mondiale » et « Les traités de paix de Brest-Litowsk et de Versailles », étaient les plus essentielles, et je les répétai encore et toujours des douzaines de fois sous une forme sans cesse renouvelée, jusqu’à ce qu’une conception claire et uniforme s’établît, au moins sur ce point, entre les hommes parmi lesquels notre mouvement recruta ses premiers membres.
Ces réunions eurent aussi cet avantage pour moi- même : je m’adaptais lentement au rôle d’orateur pour grandes réunions populaires, j’acquis l’élan pathétique et j’appris les gestes que réclame une grande salle contenant des milliers d’hommes.
Je n’ai pas constaté, à cette époque, de la part des partis qui se flattent aujourd’hui d’avoir provoqué le revirement de l’opinion publique, aucun effort pour ouvrir au peuple les yeux dans cette direction, abstraction faite des petits cénacles déjà mentionnés.
Quand un politicien soi-disant national faisait une conférence dans ce sens, c’était toujours dans un milieu qui partageait déjà ses convictions, et que ces arguments pouvaient, tout au plus, confirmer dans ses opinions. Mais ce n’était pas ce qui importait ; l’essentiel, c’était uniquement de gagner, par l’instruction et la propagande, ceux qui appartenaient jusqu’à présent par leur éducation et leurs convictions au camp ennemi.
Pour ouvrir les yeux au peuple, nous nous sommes aussi servis de proclamations. Étant encore dans la troupe, j’avais composé une proclamation mettant en regard les traités de Brest-Litowsk et de Versailles ; elle eut un tirage considérable et connut une grande diffusion. Plus tard, je la fis réimprimer par le parti, et son action fut de nouveau très efficace. Les premières réunions furent caractérisées par le fait que toutes les tables étaient jonchées de proclamations, de journaux, de brochures, etc. Mais nous mettions l’essentiel de notre effort dans la parole.
En effet, cette dernière seule est capable de provoquer les révolutions véritablement grandes, et cela pour des causes psychologiques générales.
J’ai déjà exposé, dans le premier volume, que tous les grands événements qui retournent le monde entier, ont été provoqués par la parole et non par des écrits.
Une discussion assez longue s’engagea à ce sujet dans une partie de la presse, et, naturellement, cette idée rencontra la plus forte opposition, surtout de la part de nos renards bourgeois. Mais la raison même de cette attitude confond les sceptiques. Les intellectuels bourgeois protestent contre cette opinion uniquement parce que la force, et le don d’influence sur les masses par la parole, leur font manifestement défaut, car ils se sont toujours adonnés à l’activité par la plume, en renonçant à l’action véritablement propagandiste de la parole. Une telle habitude entraîne inévitablement les qualités qui caractérisent aujourd’hui notre bourgeoisie, c’est-à-dire la perte de l’instinct psychologique nécessaire pour agir sur les masses et les influencer.
Tandis que l’orateur ne cesse de recevoir du sein de la masse même, au cours de sa conférence, les rectifications nécessaires, en mesurant par l’expression des auditeurs jusqu’à quel point ils peuvent suivre et comprendre son exposé, et si l’impression et l’action de ses paroles conduisent au but désiré, l’écrivain ne connaît point du tout ses lecteurs. En conséquence, il ne pourra pas s’orienter sur un auditoire vivant, sur une foule qui est précisément là, devant ses yeux ; il devra donner à son exposition un caractère plus général. Par là, il perd, jusqu’à un certain degré, en finesse psychologique et, par conséquent, en souplesse. Un orateur brillant pourra donc, en général, toujours mieux écrire qu’un écrivain brillant ne pourra parler, sauf le cas où il s’exerce longtemps dans cet art. Il faut y ajouter que l’homme en masse est généralement paresseux, qu’il reste enfoncé dans l’ornière de ses anciennes habitudes, et qu’il n’aime pas à prendre en mains les écrits qui ne correspondent pas à ce qu’il croit et qui ne lui apportent pas ce qu’il en attend. Un écrit d’une tendance quelconque a le plus de chances à être lu par ceux qui appartiennent déjà à cette même tendance. Une proclamation ou une affiche, seules, ont un peu plus de chances, parce qu’elles sont plus courtes, d’attirer l’attention momentanée d’un adversaire. L’image sous toutes ses formes, jusqu’au film, a encore plus de pouvoir sous ce rapport. Là, l’homme doit encore moins faire intervenir sa raison ; il lui suffit de regarder, et de lire, tout au plus, les textes les plus courts ; et bien nombreux sont ceux qui seront plutôt prêts à s’assimiler une démonstration par l’image qu’à lire un écrit plus ou moins long. L’image apporte à l’homme dans un temps beaucoup plus court, je voudrais presque dire d’un seul coup, la démonstration qu’il ne pourrait retirer d’un écrit que par une lecture fatigante.
Mais ce qui est l’essentiel, c’est qu’on ne sait jamais, à propos d’un écrit, dans quelles mains il va tomber ; et pourtant il doit garder toujours la même forme. Son action, en général, sera plus ou moins considérable dans la mesure où sa rédaction correspond au niveau intellectuel et aux particularités du milieu de ceux qui seront ses lecteurs. Un livre destiné aux grandes masses doit, dès l’abord, essayer d’agir par son style et son niveau, d’une autre façon qu’un ouvrage destiné à des couches intellectuelles supérieures.
Ce n’est que par une telle adaptation que l’écrit peut se rapprocher de la parole. L’orateur peut, autant qu’il veut, traiter le même sujet que le livre ; s’il est un grand orateur populaire, un orateur de génie, il ne traitera jamais le même plan et le même sujet deux fois de la même façon. Il se laissera toujours porter par la grande masse, de sorte qu’instinctivement il trouvera toujours les paroles nécessaires pour arriver droit au cœur de ses auditeurs actuels. S’il commet l’erreur la plus légère, il en trouvera la correction vivante devant lui. Comme je l’ai déjà dit, il peut lire sur les visages de ses auditeurs : primo, s’ils comprennent ce qu’il dit ; secundo, s’ils peuvent suivre son exposition générale ; tertio, jusqu’à quel point il les a convaincus qu’il a raison. S’il voit, primo qu’ils ne le comprennent pas, il s’expliquera d’une façon si primitive et si claire que le dernier de ses auditeurs le comprendra ; s’il sent – secundo – qu’ils ne peuvent pas le suivre, il va échelonner son exposition d’une façon si lente et progressive, que le plus faible d’entre eux ne restera pas en arrière ; et – tertio – s’il lui paraît qu’ils ne sont pas encore convaincus du bien-fondé de ses assertions, il les répétera encore et toujours, avec de nouveaux exemples à l’appui, il exposera lui-même les objections inexprimées qu’il pressent chez eux, et il les réfutera et les pourfendra jusqu’à ce que les derniers groupes d’opposants finissent par avouer, par leur attitude et l’expression de leurs visages, qu’ils ont capitulé devant son argumentation.
Il s’agit là, bien souvent, de vaincre chez les hommes des préventions qui ne sont pas fondées sur la raison, mais qui sont pour la plupart inconscientes, et ancrées seulement dans le sentiment. Surmonter cette barrière d’antipathie instinctive, de haine passionnée, de prévention hostile, est mille fois plus difficile que de corriger une opinion scientifique défectueuse ou erronée. On peut éliminer les fausses conceptions et l’insuffisance du savoir en instruisant, mais on ne vaincra pas ainsi la résistance du sentiment. Seul, un appel à ces forces mystérieuses peut avoir de l’effet ; et ce n’est presque jamais l’écrivain, c’est presque uniquement l’orateur qui en est capable.
La preuve la plus éclatante de cette assertion, la voici : bien que la presse bourgeoise, souvent très habilement « faite », fût répandue dans notre peuple à je ne sais combien de millions d’exemplaires, cette presse n’a pas empêché la grande masse du peuple de devenir un ennemi implacable de ce monde bourgeois. Tout ce déluge de journaux, et tous les livres produits, année par année, par les intellectuels, glissent sur les millions d’hommes qui forment les couches inférieures du peuple, comme l’eau sur un cuir huileux. Cela ne peut s’expliquer que de deux manières : ou bien le contenu de toute cette production littéraire de notre monde bourgeois ne vaut rien, ou bien il est impossible d’atteindre jusqu’au cœur des masses par l’écrit seul. Ceci est évidemment d’autant plus vrai que la littérature en question fera montre de moins de psychologie, ce qui était ici le cas.
Surtout qu’on ne vienne pas nous répondre (comme l’a fait un journal nationaliste de Berlin) que le marxisme lui-même, par sa littérature, et surtout par l’influence de l’œuvre fondamentale de Karl Marx, prouve le contraire de cette assertion. Jamais argument plus superficiel n’a été fourni à l’appui d’une thèse fausse. Ce qui a donné au marxisme son influence étonnante sur les masses populaires, ce n’est aucunement le produit formel, exprimé par écrit, des efforts de la pensée juive, mais c’est au contraire la prodigieuse vague de propagande orale qui s’est emparée, au cours des ans, des masses ouvrières. Sur cent mille ouvriers allemands, en moyenne, on n’en trouvera pas cent qui connaissent cette œuvre, qui est étudiée mille fois plus par les intellectuels et surtout par les Juifs que par les véritables adeptes de ce mouvement dans la foule des prolétaires.
En effet, cet ouvrage n’a jamais été écrit pour les grandes masses, mais exclusivement pour l’équipe dirigeante de la machine juive à conquérir le monde ; elle fut ensuite chauffée par un tout autre combustible : par la presse. Car voilà ce qui distingue la presse marxiste de notre presse bourgeoise : dans la presse marxiste écrivent des propagandistes, et la presse bourgeoise confie sa propagande à des écrivailleurs. L’obscur rédacteur socialiste, qui presque toujours n’entre à la rédaction qu’au sortir d’un meeting, connaît son monde comme nul autre. Mais le scribe bourgeois, qui sort de son cabinet de travail pour affronter la grande masse, se sent déjà malade à la seule odeur de cette masse, et n’est pas moins impuissant vis-à-vis d’elle quand il emploie le langage écrit.
Ce qui a gagné au marxisme des millions d’ouvriers, ce ne furent pas tant les écrits des Pères de l’Église marxiste, mais plutôt la propagande inlassable et vraiment prodigieuse des dizaines de milliers d’agitateurs infatigables, en commençant par le grand apôtre de la haine, jusqu’au petit fonctionnaire syndical, à l’homme de confiance et à l’orateur qui intervient dans les discussions, ce furent des centaines de milliers de réunions, où ces orateurs populaires, debout sur une table dans une salle de brasserie pleine de fumée, inculquaient comme à coups de marteaux leurs idées aux masses ; de cette façon, ils gagnèrent la connaissance parfaite de ce matériel humain, qui leur donna les moyens de choisir les armes appropriées pour prendre d’assaut la citadelle de l’opinion publique. Et puis ce furent ces démonstrations gigantesques, ces défilés de centaines de milliers d’hommes, qui inculquaient aux petites gens miséreux la fière conviction qu’étant de petits vers, ils étaient aussi les membres d’un grand dragon dont l’haleine brûlante devait incendier un jour ce monde bourgeois tant détesté, et que la dictature du prolétariat fêterait un beau jour sa victoire finale.
Cette propagande formait ensuite les hommes qui étaient prêts et préparés pour lire une presse socialiste ; mais c’est aussi une presse qui est plutôt parlée qu’écrite. Car, tandis que, dans le camp de la bourgeoisie, les professeurs, les littérateurs, les théoriciens et les écrivailleurs de toute sorte essaient parfois de parler, chez les marxistes ce sont les orateurs qui essaient parfois d’écrire. Et justement le Juif, dont il s’agit surtout en cette occasion, par son adresse dialectique mensongère et sa souplesse, restera, même comme écrivain, plutôt un orateur propagandiste qu’un narrateur qui écrit.
Et voilà pourquoi le monde de la presse bourgeoise (faisant abstraction du fait qu’elle-même est en grande partie enjuivée et qu’elle n’a donc aucun intérêt à éduquer les grandes masses) ne peut exercer aucune influence sur l’opinion des couches les plus nombreuses de notre peuple. Jusqu’à quel point il est difficile de vaincre les préjugés, les états d’âme, les sensations, etc., et de les remplacer par d’autres, de combien d’influences et de conditions à peine prévisibles dépend le succès, l’orateur qui a les nerfs assez sensibles peut le mesurer au fait que même l’heure à laquelle la conférence a lieu peut avoir une influence décisive sur son résultat. La même conférence, le même orateur, le même sujet produisent une impression différente à 10 heures du matin, à 3 heures de l’après-midi, et le soir. Quand j’étais encore un débutant, je fixais quelquefois mes réunions dans la matinée, et je me rappelle surtout une manifestation que nous avions organisée dans la brasserie Kindlkeller à Munich pour protester contre « l’oppression de territoires allemands ». C’était, à l’époque, la plus grande salle à Munich, et le risque paraissait grand. Pour donner aux adhérents, et à tous ceux qui voudraient venir, autant de facilités que possible, j’organisai la réunion un dimanche, à 10 heures du matin. Le résultat fut déprimant, mais hautement instructif : la salle était pleine, ce qui faisait un effet prodigieux, mais l’auditoire resta froid comme la glace ; personne ne s’échauffa, et moi-même, comme orateur, je me sentais profondément malheureux de ne pouvoir établir aucun lien, pas le moindre contact, avec mes auditeurs. Je crois n’avoir pas parlé plus mal que d’habitude ; mais l’effet parut égal à zéro. Je quittai la réunion fort mécontent, mais plus riche d’une expérience. Les essais du même genre que je fis plus tard, aboutirent tous au même résultat.
On ne doit pas s’en étonner. Allez à une représentation théâtrale, et regardez une pièce à 3 heures et la même pièce, avec les mêmes acteurs, à 8 heures du soir, vous serez surpris par la différence de l’effet et de l’impression. Un homme aux sensations fines, et capable de se rendre compte de ses états d’âme, pourra établir aussitôt que la représentation de l’après- midi produit moins d’impression que le spectacle du soir. C’est le même cas pour le cinéma, ce qui est bien plus probant, parce qu’au théâtre on aurait pu dire que l’acteur ne se donne peut-être pas tant de peine l’après- midi que le soir, mais le film n’est pas autre dans l’après-midi qu’à 9 heures du soir. Non, l’heure exerce une influence certaine, aussi bien que le lieu. Il y a des locaux qui laissent froids, pour des causes qu’on ne perçoit que difficilement, mais qui opposent une résistance acharnée à toute tentative de créer une atmosphère. Les souvenirs et les images traditionnelles qui existent dans l’homme peuvent aussi exercer une influence décisive. Une représentation du Parsifal à Bayreuth produira toujours un tout autre effet qu’à n’importe quel autre lieu du monde. Le charme mystérieux de la maison sur la colline du festival, dans la vieille ville des margraves, ne peut être remplacé, ni même atteint, nulle part ailleurs.
Dans tous ces cas, il s’agit de l’affaiblissement du libre arbitre de l’homme. C’est surtout le cas pour les réunions où viennent des hommes à préjugés contraires, et qu’il s’agit de convertir. Le matin et encore pendant la journée, les forces de la volonté des hommes s’opposent avec la plus grande énergie aux tentatives de leur suggérer une volonté étrangère, une opinion étrangère. Mais le soir, ils succombent plus facilement à la force dominatrice d’une volonté plus puissante. Car, en réalité, chaque réunion de ce genre est une lutte entre deux forces opposées. Le puissant talent oratoire d’une nature dominatrice d’apôtre réussira plus facilement à insuffler un nouveau vouloir à des hommes qui ont déjà subi, d’une façon naturelle, une diminution de leur pouvoir de résistance, plutôt que s’ils étaient encore en pleine possession de tous les ressorts de leur esprit et de leur volonté.
Le même but est atteint par la pénombre artificielle et pourtant mystérieuse des églises catholiques, par les cierges allumés, l’encens, les encensoirs, etc.
Dans cette lutte de l’orateur avec les adversaires qu’il veut convertir, il acquiert peu à peu une compréhension merveilleuse des conditions psychologiques de la propagande, ce qui fait presque complètement défaut à l’écrivain. Pour cette cause, les écrits, avec leur effet limité, ne serviront, en général, qu’à conserver, raffermir et approfondir les conceptions et les opinions déjà existantes. Aucune des grandes révolutions historiques n’a été causée par la parole écrite qui ne fit que les accompagner.
Qu’on ne pense pas que la révolution française serait jamais sortie des théories philosophiques, si elle n’avait pas trouvé une armée d’agitateurs, dirigée par des démagogues de grand style, qui excitèrent les passions du peuple qui souffrait, jusqu’à ce qu’eût lieu la terrible éruption volcanique qui figea de terreur toute l’Europe. De même, la plus grande convulsion révolutionnaire des temps nouveaux, la révolution bolchéviste en Russie fut provoquée non pas par les écrits de Lénine, mais par l’activité oratoire haineuse d’innombrables apôtres – petits et grands – de la propagande parlée.
Ce peuple qui ne savait pas lire, vraiment, ne put pas se passionner pour la révolution communiste en lisant Karl Marx, mais il la fit, parce que des milliers d’agitateurs – tous, il est vrai, au service d’une même idée – lui promirent toutes les splendeurs du ciel.
Cela fut toujours ainsi, et cela restera ainsi, toujours.
Nos intellectuels allemands, avec leur manque complet de sens pratique, croient qu’un écrivain doit avoir nécessairement plus d’esprit qu’un orateur. Cette opinion est illustrée de façon exquise par un article du journal nationaliste déjà mentionné, qui déclarait qu’on était souvent déçu en lisant le discours d’un orateur de grand renom. Cela me rappelle une autre critique qui me tomba sous la main pendant la guerre ; elle examinait à la loupe les discours de Lloyd George (alors simple ministre des munitions) pour arriver à la conclusion spirituelle que ces discours étaient de deuxième ordre au point de vue moral et scientifique, et qu’il s’agissait de productions banales et triviales. Je tins plus tard dans mes mains quelques-uns de ces discours sous forme de brochure et je ne pus m’empêcher de rire aux éclats à voir comment notre chevalier de la plume allemand était resté incompréhensif devant ces chefs-d’œuvre de psychologie et cet art de manier l’âme des foules. Cet homme jugeait ces discours exclusivement au point de vue de l’impression qu’ils produisaient sur son propre esprit blasé, tandis que le grand démagogue anglais les avait composés dans le seul but d’exercer sur la masse de ses auditeurs et, dans un sens plus large, sur tout le bas peuple anglais, une influence maximum. De ce point de vue, les discours de cet Anglais étaient un chef-d’œuvre prodigieux, car ils portaient témoignage d’une connaissance étonnante de l’âme des couches profondes de la population. Aussi leur effet fut-il immense.
Qu’on leur compare le balbutiement impuissant d’un Bethmann-Hollweg ! En apparence, ses discours étaient, certes, plus spirituels, mais, en réalité, ils ne montraient que l’incapacité de cet homme à parler à son peuple qu’il ne connaissait point. Néanmoins, en sa cervelle de moineau, un écrivassier allemand – infiniment instruit, comme de juste – en vint à mesurer l’esprit du ministre anglais par l’effet que ses discours, calculés pour une action sur les masses, produisaient sur son âme desséchée par l’excès de savoir et à le comparer avec l’esprit d’un homme d’État allemand, dont le bavardage spirituel trouvait chez lui un terrain plus propice. Que Lloyd George fut par son génie, non seulement égal, mais mille fois supérieur à Bethmann- Hollweg, il le prouva en donnant à ses discours la forme et l’expression qui lui ouvrirent le cœur de son peuple et qui firent que ce peuple obéit sans réserve à sa volonté. Ce sont précisément la langue primitive et la forme élémentaire de ses expressions, l’emploi d’exemples simples et faciles à comprendre, qui prouvent le grand talent de cet Anglais. Car il faut mesurer le discours d’un nomme d’État à son peuple non d’après l’impression qu’il produit sur un professeur d’université, mais par son action sur le peuple lui-même. Et c’est cela seulement qui donne la mesure du génie d’un orateur.
* * *
Le développement étonnant de notre mouvement, qui surgit il y a peu d’années du néant, et qui est aujourd’hui jugé digne des persécutions de tous les ennemis intérieurs et extérieurs de notre peuple, tient à ce que nous avions compris cette idée et que nous l’avons mise en pratique.
Si essentielle que soit pour un mouvement la littérature de parti, son but sera toujours plutôt d’achever et d’uniformiser l’éducation des chefs supérieurs ou inférieurs que de permettre la conquête des masses de mentalité hostile. Un social-démocrate convaincu ou un communiste fanatique ne s’abaisseront que dans les cas les plus rares à acheter une brochure, et bien moins encore un livre national-socialiste, et à le lire pour jeter un coup d’œil sur notre philosophie ou pour étudier notre critique de la sienne. Ils ne liront même que bien rarement un journal qui ne porte pas d’avance l’estampille de leur parti. Ceci, du reste, ne serait que d’une utilité bien restreinte, car le sommaire d’un seul numéro de journal est trop fragmentaire et trop dispersé dans son action pour qu’on puisse attendre de lui une influence quelconque sur le lecteur occasionnel. Et l’on ne doit pas présumer, surtout quand il s’agit de pfennigs, que quelqu’un va s’abonner régulièrement à un journal ennemi par pur désir d’information objective. C’est à peine si un seul le fera sur dix mille. Seul, celui qui est déjà gagné au mouvement lira l’organe du parti, relatif à l’information courante sur son mouvement.
La proclamation « parlée » est, certes, tout autre chose ! Celle-ci, chacun sera prêt à l’accepter, surtout s’il la reçoit gratuitement ; et il le fera d’autant plus volontiers si son titre énonce de manière saisissante un sujet qui est à ce moment dans toutes les bouches. En la parcourant avec plus ou moins d’attention, il arrive qu’on se sente attiré par cette proclamation vers de nouveaux points de vue et vers de nouvelles opinions, ou même que l’on s’intéresse à ce nouveau mouvement. Mais, dans le cas le plus favorable, cela ne peut donner qu’une légère impulsion, jamais provoquer une décision définitive. Car la proclamation ne peut, elle non plus, que stimuler à quelque chose ou désigner quelque chose, et son action ne se fera sentir qu’en rapport avec une éducation et une instruction correspondantes chez le lecteur, dont l’opinion est déjà faite. Et le moyen d’agir reste encore et toujours la grande réunion populaire.
La grande réunion populaire est déjà nécessaire à cause de ceci : en elle, l’homme qui se sentait isolé au début dans sa qualité de partisan futur d’un jeune mouvement, et qui cède facilement à la peur d’être seul, reçoit pour la première fois l’image d’une plus large communauté, ce qui produit sur la plupart des hommes l’effet d’un encouragement et d’un réconfort. Ce même homme aurait marché à l’attaque dans le cadre de sa compagnie ou de son bataillon, entouré de tous ses camarades, le cœur plus léger qu’il ne l’eût fait abandonné à ses propres forces. Entouré des autres, il se sent toujours un peu plus en sûreté, même si, en réalité, mille raisons démontrent le contraire.
La communauté d’une grande manifestation ne réconforte pas seulement l’isolé, elle provoque l’union, elle aide à créer un esprit de corps. L’homme qui, en qualité de premier représentant d’une doctrine nouvelle, éprouve de grandes difficultés dans son entreprise ou dans son atelier, ressent le besoin urgent d’un appui qu’il trouve dans la conviction d’être un membre, un militant d’une grande et vaste corporation. L’impression qu’il appartient à cette corporation, il la reçoit pour la première fois dans la grande réunion populaire commune. Quand, venant de son petit atelier, ou de la grande usine où il se sent si petit, il pénètre pour la première fois dans une grande réunion populaire, quand il se voit entouré par des milliers d’hommes qui ont la même foi ; ou quand, s’il s’agit de quelqu’un qui se cherche encore, il se sent entraîné par l’action puissante de la suggestion collective et de l’enthousiasme de trois à quatre mille hommes ; quand le succès visible et des milliers d’approbations lui confirment le bien-fondé de la nouvelle doctrine et, pour la première fois, éveillent en lui des doutes sur la vérité de ses anciennes conceptions, alors, il tombe sous cette influence miraculeuse que nous appelons la suggestion de la masse. La volonté, les aspirations, mais aussi la force de milliers d’hommes s’accumulent dans chacun d’eux. L’homme qui pénètre dans une telle réunion encore hésitant et indécis, la quitte tout réconforté : il est devenu le membre d’une communauté.
Le mouvement national-socialiste ne doit jamais oublier cela ; et surtout il ne doit pas tomber sous l’influence de ces bourgeois vaniteux qui croient tout savoir mais qui néanmoins ont perdu un grand État, et leur propre existence avec la domination de leur classe. Oui, ils sont vraiment intelligents, ils savent tout, ils comprennent tout ; seulement, ils n’ont pas su une chose : éviter que le peuple allemand tombe dans les bras du marxisme. Sur ce point, ils se sont montrés impuissants de la façon la plus misérable et la plus piteuse, et la haute opinion qu’ils ont encore d’eux- mêmes n’est que l’expression de leur vanité, or, celle-ci et la sottise sont, à en croire le proverbe, le fruit du même arbre. Si ces gens accordent aujourd’hui peu d’importance à la parole, ils ne le font que pour s’être rendu compte, Dieu merci ! à quel point leurs élucubrations personnelles sont demeurées impuissantes.
Chapitre 7 – La lutte contre le front rouge
En 1919-1920 et aussi en 1921, j’ai assisté moi- même à des réunions qu’on appelle bourgeoises. Elles produisirent toujours sur moi la même impression qu’une cuillerée d’huile de foie de morue dans ma jeunesse. On doit l’avaler, et cela est peut être très bon, mais le goût en est abominable ! Si on pouvait ligoter le peuple allemand avec des cordes, et le traîner de force à ces « manifestations » bourgeoises, tenir fermées toutes les portes jusqu’à la fin du spectacle et ne laisser sortir personne, alors, peut-être, en quelques siècles, arriverait-on au succès. Il est vrai que je dois avouer ouvertement que, dans ce cas, la vie n’aurait probablement aucun attrait pour moi, et que j’aurais alors préféré n’être plus un Allemand. Mais comme, Dieu merci ! il ne peut en être question, il ne faut pas s’étonner de ce que le peuple sain et non corrompu évite ces « réunions bourgeoises de masses » comme le diable l’eau bénite.
J’ai appris à les connaître, ces prophètes d’une conception bourgeoise de la vie, et je ne m’étonne vraiment pas, mais je comprends bien pourquoi ils n’attachent aucune importance à l’art oratoire. J’ai fréquenté alors les réunions des démocrates, des nationaux allemands, du parti populiste allemand et du parti populiste bavarois (centre bavarois). Ce qui sautait tout de suite aux yeux, c’était l’uniformité homogène des auditeurs. Ce n’étaient presque toujours que des membres du parti qui assistaient à la réunion. Le tout, sans discipline aucune, ressemblait plutôt à un club où on bâille en jouant aux cartes qu’à une réunion de gens venant de traverser la plus grande des révolutions. Le conférencier, de son côté, faisait tout son possible pour maintenir cette atmosphère languissante. Les orateurs parlaient, ou plutôt ils lisaient à haute voix leurs discours, dans le style d’un article spirituel de journal ou dans celui d’une dissertation scientifique, ils évitaient toutes les expressions fortes et proféraient çà et là une plaisanterie professorale anodine, qui faisait rire obligeamment toute la table du vénérable bureau : non pas aux éclats, ce qui eût été provocant, mais en sourdine, avec réserve et distinction.
Oh ! ce bureau !
Je vis une fois une réunion dans la salle Wagner, à Munich ; c’était une manifestation à l’occasion de l’anniversaire de la bataille des nations à Leipzig. Le discours fut lu par un vieux monsieur vénérable, professeur d’une université quelconque. Sur la tribune se tenait le bureau. Un monocle à gauche, un monocle à droite, et au milieu un monsieur sans monocle. Tous les trois en redingote : on avait l’impression d’un tribunal qui venait annoncer une condamnation à mort, ou bien d’un baptême solennel, en tout cas d’une cérémonie plutôt religieuse. Le prétendu discours, qui, imprimé, aurait peut-être été assez joli, produisait un effet simplement effroyable. Après trois quarts d’heure à peine, toute la réunion était plongée dans une sorte de sommeil hypnotique, troublé seulement quand un homme ou une femme sortait, ou par le bruit que faisaient les serveuses et par les bâillements de plus en plus fréquents des auditeurs. Trois ouvriers présents à cette réunion, soit par curiosité, soit délégués par leur parti, se regardaient de temps en temps avec des sourires ironiques mal dissimulés ; ils se poussèrent enfin du coude et quittèrent tout doucement la salle. On pouvait voir qu’ils ne voulaient troubler la réunion à aucun prix. Il est vrai que cela ne valait pas la peine de discuter dans un tel milieu. Enfin la réunion parut toucher à sa fin. Quand le professeur, dont la voix était devenue de plus en plus faible, eut fini sa conférence, le président de la réunion, celui qui était assis entre les deux porteurs de monocle, se leva, et d’une voix claironnante s’adressa aux « sœurs allemandes » et aux « frères » qui étaient là, en proclamant son sentiment de la plus profonde reconnaissance pour la conférence unique et admirable que le professeur X… venait de leur faire d’une façon aussi agréable que consciencieuse et profonde, cette conférence ayant été un « événement intérieur » dans le sens le plus vrai de ce mot, et mêm « une action ». Ce serait une profanation de cette heure si sublime que de livrer à la discussion ces dissertations lumineuses ; c’est pourquoi, sûr d’être l’interprète de tous les auditeurs, il renonçait à ouvrir une discussion, et proposait à tous de lever la séance et de chanter en chœur : « Nous sommes tous un peuple uni de frères » (Wilhelm Tell, serment du Rütli), etc. Enfin, en clôturant la réunion, il proposa de chanter l’hymne national allemand. Et ils le chantèrent ; il me parut qu’au deuxième couplet les voix devinrent moins nombreuses, pour ne s’enfler qu’au refrain ; au troisième, cette impression se renforça encore, de sorte que j’eus l’impression que tous n’étaient pas tout à fait sûrs du texte.
Mais est-ce que cela importe, quand une pareille chanson s’élance vers le ciel pleine de ferveur, du fond d’une âme patriote allemande ?
Et la réunion se dispersa, c’est-à-dire chacun se pressa de sortir au plus vite, les uns pour prendre un bock, les autres un café, d’autres encore pour être à l’air libre.
Eh ! oui, sortir à l’air libre, être dehors ! Tel était aussi mon unique désir. Et c’est cela qui doit servir à glorifier la lutte héroïque de centaines de milliers de Prussiens et d’Allemands ? Au diable de pareilles manifestations !
Le gouvernement, certes, peut aimer ça. Certes, c’est une réunion « pacifique ». Ici, un ministre n’a vraiment pas à redouter, pour l’ordre et la sécurité, que les flots de l’enthousiasme dépassent la mesure administrative de correction bourgeoise, il n’a pas à redouter que des hommes, dans l’ivresse de l’enthousiasme, s’élancent de la salle non pas pour arriver au plus vite dans un café ou une brasserie, mais pour parcourir, en rangs par quatre, en marchant en cadence, et en chantant : « Honneur à l’Allemagne ! » les rues de la ville, et causer par cela des désagréments à la police qui a bien besoin de repos.
Non, on peut être content de ces citoyens-là !
* * *
Les réunions national-socialiste, au contraire, n’étaient pas des réunions « paisibles ». Ici, les vagues de deux conceptions de vie s’entrechoquaient, et elles ne finissaient pas par de fades déclamations de chants patriotiques, mais par une éruption fanatique des passions raciste et nationale.
Il importait, dès le début, d’établir dans nos réunions une discipline rigoureuse et d’assurer au bureau une autorité absolue. Car nos discours n’étaient pas un bavardage impuissant de « conférenciers » bourgeois, ils étaient, par leur sujet et par leur forme, faits pour provoquer la riposte de l’adversaire. Et il y eut des adversaires dans nos réunions ! Bien souvent ils venaient en foules compactes, encadrant quelques démagogues, et leurs visages reflétaient cette conviction : « Aujourd’hui, nous allons en finir avec vous ! »
Oui, bien souvent, ils ont été amenés chez nous en véritables colonnes, nos amis du parti communiste, avec le mandat bien inculqué d’avance de casser ce soir-là toute la boutique et d’en finir avec toute cette histoire. Et combien, souvent, tout ne tint qu’à un fil, et seule l’énergie sans bornes de notre bureau et la combativité brutale de notre propre police de salle purent encore une fois contrecarrer les desseins de nos adversaires.
Et ils avaient toutes les raisons pour être excités contre nous.
Rien que la couleur rouge de nos affiches les attirait dans nos salles de réunions. La bourgeoisie ordinaire fut épouvantée quand nous recourûmes au rouge des bolcheviks, et elle vit là quelque chose de très louche. Les nationaux allemands faisaient courir le bruit que nous n’étions au fond qu’une variété du marxisme, que nous n’étions que des socialistes larvés. Car ces têtes dures n’ont pas compris jusqu’à ce jour la différence entre le vrai socialisme et le marxisme. Surtout quand on découvrit que nous nous adressions dans nos réunions non pas à des « Mesdames et Messieurs », mais seulement à des « compatriotes », et que nous nous traitions entre nous de camarades de parti ; alors beaucoup d’entre nos adversaires nous prirent pour des marxistes. Bien souvent, nous nous sommes tordus de rire au sujet de la panique de ces stupides bourgeois en peau de lapin, devant ce spirituel jeu de devinettes sur notre origine, nos intentions et notre but.
* * *
Nous avons choisi la couleur rouge pour nos affiches après mûre et solide réflexion, pour faire enrager la gauche, pour provoquer son indignation, et pour l’amener à venir à nos réunions, ne fût-ce que dans le but de les saboter, parce que c’était la seule façon de nous faire entendre de ces gens-là.
Ce fut réjouissant de suivre ces années-là les changements perpétuels de la tactique de nos ennemis, qui témoignaient qu’ils se sentaient désorientés et impuissants. D’abord, ils enjoignirent à leurs partisans de ne prêter aucune attention à nous et d’éviter nos réunions.
Cette consigne, en général, fut suivie.
Mais comme, peu à peu, quelques-uns des leurs vinrent quand même, et que leur nombre eut une tendance à grandir, quoique lentement, et que l’impression faite sur eux par notre doctrine était visible, les chefs devinrent peu à peu nerveux et inquiets, et s’arrêtèrent à la conviction qu’on ne pouvait se borner à rester toujours spectateurs de ce développement, mais qu’on devait en finir avec lui par la terreur.
Ce furent alors des appels aux « prolétaires conscients et organisés » qui devaient aller en masse à nos réunions, afin d’asséner les coups de poing du prolétariat à l’« agitation monarchiste et réactionnaire » dans la personne de ses représentants.
Alors, tout d’un coup, il arriva que nos salles de réunions furent remplies d’ouvriers trois quarts d’heure avant l’ouverture de la séance. Elles étaient pareilles à des barils de poudre, qui pouvaient à chaque moment voler en l’air, la mèche étant déjà allumée. Mais il en advint toujours autrement. Ces hommes vinrent en ennemis, et ils partirent, sinon déjà en partisans, du moins avec des doutes sur la valeur de leur propre doctrine. Peu à peu j’arrivai à fondre partisans et adversaires, après un discours de trois heures, en une seule masse enthousiasmée. Tout signal pour briser la réunion restait vain. Les chefs furent alors vraiment pris de peur, et enfin prévalut l’avis de ceux qui s’étaient déjà auparavant opposés à cette tactique de participation aux réunions, et qui pouvaient maintenant, avec un semblant de raison, déclarer que l’expérience avait prouvé qu’on devait défendre aux ouvriers, par principe, de venir à nos séances.
De nouveau, ils ne vinrent plus, ou plutôt il en vint moins. Mais bientôt le même jeu recommença.
L’interdiction ne fut pas observée, les camarades vinrent toujours plus nombreux, et, enfin, ce furent les partisans d’une tactique radicale qui prirent de nouveau le dessus. Il fallait rendre nos réunions impossibles.
Quand il s’avéra après deux, trois, souvent après huit ou dix réunions qu’il était plus facile de les rompre en théorie qu’en pratique, et que le résultat de chaque réunion était l’effritement de troupes rouges de combat, de nouveau on entendit l’autre mot d’ordre :
« Camarades, ouvriers et ouvrières, évitez les réunions des agitateurs nationaux-socialistes ! »
Cette même hésitation dans la tactique se retrouva aussi dans la presse rouge. Tantôt on s’efforça de nous ensevelir dans le silence, puis, se rendant compte que c’était inopérant, on recourut de nouveau à la méthode contraire. On nous « mentionna » tous les jours de l’une ou de l’autre façon, et la plupart du temps, on démontrait à l’ouvrier à quel point toute notre activité était ridicule. Peu à peu, ces messieurs durent enfin sentir que cela ne nous nuisait nullement bien au contraire, parce que beaucoup de gens commencèrent à se demander pourquoi on consacrait tant de phrases à notre mouvement s’il était si ridicule que cela. La curiosité des gens s’éveilla. Alors on fit demi-tour et on commença, pendant quelque temps, à nous représenter comme d’épouvantables criminels devant l’humanité. Article sur article, commentant et démontrant toujours nos crimes, des histoires scandaleuses où tout, de A jusqu’à Z, était inventé de toutes pièces, devaient couronner ce travail. Mais on parut se rendre bientôt compte que ce genre d’attaque était également sans effet ; au fond, il n’a fait que contribuer à concentrer sur nous l’attention générale. J’adoptais alors l’attitude suivante : peu importe qu’ils se moquent de nous, ou qu’ils nous injurient ; qu’ils nous représentent comme des polichinelles ou des criminels ; l’essentiel, c’est qu’ils parlent de nous, qu’ils s’occupent de nous, que peu à peu nous apparaissions aux yeux des ouvriers comme la seule force avec laquelle il s’agit de lutter. Ce que nous étions en réalité, ce que nous voulions vraiment, nous saurions bien le montrer un beau jour à la meute juive de la presse.
Une des raisons pour lesquelles il n’y eut pas, à proprement parler, de sabotage de nos réunions, ce fut aussi la lâcheté presque inimaginable des chefs de nos adversaires. Dans tous les cas critiques, ils n’envoyèrent en ligne que des subalternes, et, tout au plus, attendirent l’issue de la bagarre en dehors de la salle.
Nous étions presque toujours très bien renseignés sur les intentions de ces messieurs. Non seulement parce que nous laissâmes, pour des raisons d’opportunité, un grand nombre des nôtres dans les formations rouges, mais parce que les indicateurs rouges furent atteints d’un penchant au bavardage qui nous fut très utile, mais qui, en général, se rencontre malheureusement trop souvent chez le peuple allemand. Ils ne pouvaient tenir la bouche close, quand ils avaient conçu quelque plan, et dans la plupart des cas, ils se mettaient à caqueter avant que l’œuf ne fût pondu. C’est ainsi que, bien souvent, nous avions fait les préparatifs les plus détaillés sans que les équipes de briseurs rouges se doutassent le moins du monde qu’ils allaient immédiatement être jetés dehors.
À cette époque, nous étions forcés de faire nous- mêmes la police de nos réunions ; on ne pouvait jamais compter sur la protection des autorités ; au contraire, elles ne protègent que les fauteurs de troubles, ainsi que l’expérience le prouve. Car le seul résultat réel d’une intervention des autorités, c’est-à-dire de la police, était la dispersion d’une réunion, c’est-à-dire sa clôture. Et c’était le but et l’unique intention des saboteurs ennemis.
D’ailleurs, un usage s’est établi dans la police à cet égard, qui est le plus monstrueux et le plus contraire à toute notion de droit qu’on puisse imaginer. Quand les autorités apprennent de quelque manière qu’on peut redouter une tentative de faire échouer une réunion, non seulement elles ne font rien pour arrêter les perturbateurs, mais elles défendent aux autres, aux innocents, de tenir leur réunion, et un esprit normal de policier considère encore que c’est la preuve d’une grande sagesse. Ils appellent cela « une mesure préventive pour empêcher une infraction aux lois ».
Le bandit résolu a donc toujours la possibilité de rendre impossible à l’homme honnête toute action et toute activité politique. Au nom de la sécurité et de l’ordre, l’autorité de l’État s’incline devant le bandit, et enjoint à l’innocent de bien vouloir ne pas le provoquer. Ainsi, quand les nationaux-socialistes voulaient tenir des réunions dans tel ou tel local, et que les syndicats déclaraient que cela amènerait leurs membres à s’y opposer par la violence, non seulement la police ne mettait point sous les verrous ces messieurs les maîtres- chanteurs, mais elle interdisait notre réunion. Oui, ces représentants de la loi eurent même l’impudence incroyable de nous faire savoir cela par écrit un nombre incalculable de fois.
Si on voulait se protéger contre de telles éventualités, il fallait prendre des mesures pour que toute tentative de désordre fût rendue impossible dès le début.
À cela s’ajoutait la considération suivante :
Toute réunion qui est protégée uniquement par la police, discrédite ses organisateurs aux yeux de la grande masse. Les réunions qui nécessitent la protection d’un fort barrage de police n’exercent aucune attraction, parce qu’un déploiement de force est la condition préalable du succès parmi les couches inférieures du peuple.
De même qu’un homme courageux peut conquérir plus aisément les cœurs féminins qu’un lâche, de même un mouvement héroïque conquiert le cœur d’un peuple mieux qu’un mouvement pusillanime, ne se maintenant que grâce à la protection de la police.
C’est surtout pour cette dernière raison que le jeune parti devait prendre des mesures pour défendre son existence lui-même et briser le terrorisme de l’adversaire par ses propres forces.
La protection des réunions fut obtenue :
1° En les dirigeant avec énergie et avec un sens psychologique sûr.
2° Grâce à une troupe organisée de camarades chargés de maintenir l’ordre.
Quand nous organisions une réunion, nous en étions les maîtres et nul autre. Et nous avons affirmé, inlassablement et en toute occasion, ce droit à rester les maîtres. Nos adversaires savaient parfaitement que celui qui nous provoquait était jeté dehors sans aucune indulgence, ne fussions-nous qu’une douzaine contre cinq cents. Dans les réunions d’alors, surtout en dehors de Munich, il arriva qu’il y avait quinze ou seize nationaux-socialistes devant cinq, six, sept ou huit cents adversaires. Mais nous n’aurions quand même pas toléré une provocation quelconque, et ceux qui assistaient à nos réunions savaient très bien que nous nous serions fait assommer sur place plutôt que de capituler. Il arriva plus d’une fois qu’une poignée de nos camarades s’affirma héroïquement contre une énorme masse de rouges qui hurlaient et cognaient. Il est vrai qu’on eût pu, finalement, venir à bout de ces quinze à vingt hommes. Mais les autres savaient qu’auparavant au moins une quantité double ou triple de leurs partisans aurait eu le crâne défoncé, et ils ne s’y risquaient pas volontiers.
Nous avons essayé donc de nous instruire en étudiant la tactique des réunions marxistes et bourgeoises, et ces observations ont porté fruit.
Les marxistes eurent toujours une discipline aveugle, à tel point que l’idée même de tenter de saboter une réunion marxiste ne pouvait se poser, du moins de la part des bourgeois. Par contre, les rouges nourrissaient d’autant plus ces intentions-là. Ils étaient non seulement parvenus sous ce rapport à une véritable virtuosité, mais ils étaient arrivés à faire régner dans de nombreuses provinces cette idée que le seul fait d’y organiser une réunion non-marxiste était une provocation envers le prolétariat ; surtout quand ceux qui tiraient les ficelles chez eux pressentaient que, dans cette réunion, on pourrait peut-être dresser la liste de leurs crimes et dévoiler leur bassesse de menteurs acharnés à tromper le peuple. Quand une telle réunion était annoncée, toute la presse rouge poussait un tolle furieux, et bien souvent ces détracteurs systématiques des lois s’adressaient d’abord aux autorités, avec la prière aussi instante que menaçante, d’interdire aussitôt cette provocation du prolétariat, afin que « le pire fût évité ». Ils conformaient leur langage à la bêtise de l’administration, et obtenaient ainsi le succès voulu. Mais si, par hasard, ils se trouvaient en face non pas d’une piteuse créature indigne de ses fonctions, mais d’un vrai fonctionnaire allemand qui repoussait leur honteux chantage, alors on lançait l’appel bien connu de ne pas tolérer une telle « provocation du prolétariat » et de se trouver à telle date en masse à cette réunion, pour « rabattre le caquet des misérables bourgeois avec les poings noueux du prolétariat ».
Ah ! il faut avoir vu une de ces réunions bourgeoises, avoir assisté une fois à toute la détresse et à toute l’anxiété de son bureau ! Bien souvent, devant de pareilles menaces, ils renonçaient à leur réunion : Ou bien, la peur restait si grande qu’ils ne la commençaient qu’à 8 heures trois quarts ou à 9 heures au lieu de 8 heures. Le président se donnait toutes les peines du monde pour expliquer aux « messieurs de l’opposition » ici présents, en leur faisant mille compliments, combien il lui était agréable (pur mensonge !) à lui et aux autres assistants, que des hommes qui ne partageaient pas encore leurs convictions fussent venus ; car, seule, une discussion contradictoire (qu’ainsi il promettait solennellement d’avance) pouvait confronter les opinions, faire naître la compréhension mutuelle et jeter un pont des uns aux autres. Il assurait encore, de plus, qu’il n’entrait aucunement dans les buts de cette réunion de rendre qui que ce soit infidèle à son ancienne opinion. En effet, chacun peut gagner le ciel à sa façon (Mot de Frédéric le Grand : « Ein jeder mag nach seiner Fasson selig werden. »), il faut donc laisser à autrui sa liberté d’opinion ; il prie donc qu’on permette au conférencier d’achever son discours, qui d’ailleurs ne sera pas long, et qu’on ne donne pas au monde, du moins dans cette réunion, le spectacle honteux de la discorde entre frères allemands… Pouah !
Les braves frères de gauche, pour la plupart, ne montrèrent aucune mansuétude ; le conférencier n’avait pas eu le temps d’entamer son discours qu’il devait déjà plier bagages sous une pluie d’injures des plus violentes ; et souvent on avait même l’impression qu’il devait encore remercier le sort qui abrégeait de la sorte son martyre. Sous une avalanche de huées, tous ces toréadors des réunions bourgeoises quittaient l’arène, si on ne les faisait pas descendre précipitamment par l’escalier la tête pleine de bosses, ce qui arriva bien souvent.
Ce fut donc pour les marxistes quelque chose de nouveau, quand nous, les nationaux-socialistes, nous organisâmes nos réunions, et surtout la façon dont nous les organisâmes. Ils venaient chez nous, sûrs de pouvoir naturellement répéter ce petit jeu qu’ils avaient joué tant de fois. « Aujourd’hui, nous en finissons avec ces gens-là ! » Bien souvent, l’un d’eux criait fièrement cette phrase à un autre en entrant dans notre salle, mais se trouvait mis dehors instantanément avant d’avoir pu proférer une seconde interjection.
D’abord, nous avions une tout autre méthode pour diriger les réunions. Chez nous, on ne mendiait pas pour que le public ait la bonté d’écouter notre conférence, on ne promettait pas une discussion interminable, nous décrétions dès l’abord que nous étions les maîtres de la réunion, et que celui qui se permettrait, ne fût-ce qu’une seule fois, de nous interrompre, serait impitoyablement jeté dehors. Nous déclinions d’avance toute responsabilité pour son sort ; si nous en avions le temps et si cela nous convenait, nous pourrions peut-être admettre une discussion ; sinon, il n’y en aurait pas, voilà tout ; pour le moment M. le conférencier Untel a la parole. Cela déjà les frappa de stupeur.
En second lieu, nous possédions une police de salle bien organisée. Chez les partis bourgeois, ce service d’ordre était effectué la plupart du temps par des personnages qui croyaient que leur âge leur donnait un certain droit à se faire obéir et respecter. Comme les masses embrigadées par le marxisme se souciaient peu de l’âge, de l’autorité et du respect, ce service d’ordre bourgeois était pour ainsi dire inexistant. Dès le début de notre campagne, j’ai jeté les fondements de l’organisation de notre service de protection sous la forme d’un service d’ordre, recruté exclusivement parmi des jeunes. Pour la plupart, c’étaient des camarades de régiment, d’autres étaient de jeunes camarades de parti récemment inscrits, auxquels on devait surtout apprendre ceci : que la terreur ne pouvait être brisée que par la terreur ; que sur cette terre, seul l’homme audacieux et résolu a toujours triomphé ; que nous luttions pour une idée si puissante, si noble et si élevée qu’elle méritait bien qu’on la défendît et la protégeât au prix de la dernière goutte de son sang. Ils étaient pénétrés de cette conviction, que quand la raison se tait, la dernière décision appartient à la violence, et que la meilleure arme défensive est l’attaque ; et que notre service d’ordre devait être partout précédé de la réputation qu’il n’était pas un club de rhéteurs, mais une association de combat extrêmement énergique. Et que cette jeunesse avait soif d’un tel mot d’ordre !
Que cette génération de combattants était déçue et indignée ! Qu’elle était pleine de mépris et de répulsion pour ces poules-mouillées de bourgeois !
On voyait clairement que la révolution n’avait pu avoir lieu que grâce à l’anéantissement des forces vives de notre peuple par le gouvernement bourgeois. Les poings pour protéger le peuple allemand étaient encore là, mais ce sont les têtes qui ont manqué pour les diriger. Quelles lueurs je vis poindre dans les yeux de mes gars quand je leur expliquais la nécessité de leur mission, quand je leur assurais que la plus grande sagesse du monde reste impuissante si aucune force ne la sert, ne la défend, ne la protège, que la douce déesse de la paix ne peut paraître qu’aux côtés du dieu de la guerre, et que toute grande œuvre de paix doit être soutenue et protégée par la force. Comme l’idée de la conscription militaire leur parut sous une forme nouvelle ! Non pas dans le sens où la conçoit l’esprit pétrifié de vieux fonctionnaires ankylosés, au service de l’autorité morte d’un État mort, mais dans la conscience vivante du devoir de s’engager à défendre, par le sacrifice de la vie individuelle, la vie du peuple entier, toujours et en tout temps, à toute place et en tout lieu.
Et comme ces gars entraient alors dans la mêlée ! Comme une nuée de guêpes, ils se ruaient sur les perturbateurs de nos réunions, sans se soucier de leur supériorité numérique, fût-elle écrasante, sans craindre d’être blessés et de verser leur sang, pleins de cette grande idée unique de frayer la voie à la mission sacrée de notre mouvement.
Dès la fin de l’été 1920, l’organisation de notre service d’ordre acquit des statuts précis et, au printemps 1921, il fut peu à peu divisé en centuries, qui se subdivisaient encore en groupes.
Et c’était urgent et nécessaire, car notre activité s’était toujours accrue. Nous nous assemblions encore assez souvent dans la salle des fêtes du Hofbräuhaus de Munich, mais encore plus souvent dans des salles plus grandes de cette ville. La salle des fêtes du Bürgerbräu (Brasserie bourgeoise, nom d’une grande brasserie) et le Kindlkeller (Caveau de l’Enfant, encore une grande brasserie) de Munich virent, au cours de l’automne et de l’hiver 1920-1921, des réunions toujours plus nombreuses et imposantes, et la même scène se répétait toujours : l’accès aux manifestations du parti national-socialiste allemand ouvrier devait être fermé par la police avant même le début de la réunion, parce que la salle était comble. L’organisation de notre service d’ordre nous amena à résoudre une question très essentielle. Le mouvement ne possédait jusqu’à ce moment aucun insigne du parti, ni aucun drapeau. L’absence de tels symboles n’avait pas seulement des inconvénients momentanés, mais était inadmissible pour l’avenir. Les inconvénients étaient surtout que les camarades du parti ne possédaient aucun signe extérieur de leur association, et, d’autre part, on ne pouvait admettre pour l’avenir l’absence d’un insigne, symbole du mouvement, à opposer à l’emblème international.
Dès ma jeunesse, j’ai eu bien souvent l’occasion de reconnaître et aussi de sentir toute l’importance psychologique d’un pareil symbole. Je vis après la guerre une manifestation de masses marxistes devant le palais royal et au Lustgarten. Une mer de drapeaux rouges, de brassards rouges, de fleurs rouges donnaient à cette manifestation, qui réunissait près de cent vingt mille personnes, un aspect extérieur vraiment impressionnant. Je pouvais sentir et comprendre moi- même combien il est aisé à un homme du peuple de se laisser séduire par la magie suggestive d’un spectacle aussi grandiose.
La bourgeoisie, qui ne possède ni ne représente, comme parti politique, aucune conception philosophique de la vie, n’avait en conséquence aucun drapeau à elle. Composée de « patriotes », elle s’ornait des couleurs du Reich. Si ces couleurs avaient été le symbole d’une conception de la vie déterminée, on aurait pu croire que les dirigeants voyaient dans ce symbole la représentation de leur conception de la vie, devenu, par leur activité même, le drapeau de l’État et du Reich.
Mais tel n’était point le cas.
Le Reich avait été charpenté sans le secours de la bourgeoisie allemande et son drapeau était né du sein de la guerre. En conséquence, il n’était véritablement qu’un drapeau représentatif d’un État et n’avait aucun sens philosophique spécial.
Sur un seul point du territoire de langue allemande, dans l’Autriche allemande, existait quelque chose d’approchant d’un drapeau bourgeois de parti. En adoptant les couleurs de 1848, noir-rouge-or, comme le drapeau de son parti, une partie de la bourgeoisie nationale autrichienne créa un symbole qui, bien que sans signification idéologique, avait un caractère révolutionnaire au point de vue de l’État. Les adversaires les plus acharnés de ce drapeau noir- rouge-or – on ne devrait jamais l’oublier de nos jours – ont été les social-démocrates et les chrétiens-sociaux, c’est-à-dire les cléricaux. Ce sont eux qui ont alors injurié, souillé et sali ces couleurs, tout comme ils jetèrent, en 1918, les couleurs noir-blanc-rouge dans la poubelle. Il est vrai que le noir-rouge-or des partis allemands de l’ancienne Autriche fut la couleur de 1848, c’est-à-dire celle d’une époque, peut-être pleine d’illusions, mais qui eut pour représentants les âmes allemandes les plus honnêtes, quoique le Juif qui tira les ficelles se tînt invisible dans la coulisse. Donc, ce n’est que la trahison à la patrie et le maquignonnage impudent d’hommes allemands et de territoires allemands qui rendirent ces drapeaux tellement sympathiques au marxisme et au centre, au point qu’ils l’adoptent aujourd’hui comme ce qu’ils ont de plus sacré et qu’ils fondent des « ligues » (Pendant l’hiver 1923-1924, les partis républicains fondèrent la ligue Reichsbanner “Bannière d’empire”) à eux pour la protection de ce drapeau sur lequel ils crachaient auparavant.
Jusqu’à l’année 1920, ne s’opposait donc en fait au marxisme aucun drapeau qui incarnât une conception de la vie diamétralement opposée à celui-ci. Quoique les partis les plus sains de la bourgeoisie allemande ne voulussent pas, après 1918, se prêter à l’adoption du drapeau noir-rouge-or du Reich qu’on avait découvert tout à coup, on n’avait aucun programme d’avenir à opposer aux tendances nouvelles, tout au plus l’idée d’une reconstitution de l’empire disparu.
C’est à cette idée que le drapeau noir-blanc-rouge de l’ancien Reich doit sa résurrection sous la forme du drapeau de nos partis bourgeois soi-disant nationaux.
Il est évident que le symbole d’une situation qui pouvait être détruite par le marxisme dans des circonstances et avec des conséquences très peu glorieuses, convient mal comme emblème au nom duquel ce même marxisme doit être anéanti. Si sacrées et si chères que doivent être ces anciennes couleurs d’une beauté unique, dans leur jeune et frais assemblage, à tout Allemand honnête qui a combattu sous ce drapeau et qui a vu toutes les victimes tomber, elles ne peuvent être le symbole d’une lutte pour l’avenir.
J’ai toujours, différant en ceci des politiciens bourgeois, défendu dans notre mouvement le point de vue que c’est un vrai bonheur pour la nation allemande d’avoir perdu son ancien drapeau. Ce que la république fait sous son propre drapeau, cela peut nous rester indifférent. Mais nous devons du fond de notre cœur remercier le sort de ce qu’il fut assez clément pour préserver le drapeau de guerre le plus glorieux de tous les temps de l’opprobre de servir de drap de lit pour la prostitution la plus honteuse. Le Reich actuel qui se vend et vend ses citoyens, n’aurait jamais dû arborer le drapeau noir-blanc-rouge de l’honneur et de l’héroïsme.
Aussi longtemps que dure la honte de novembre, le régime actuel doit en porter la marque extérieure et n’a pas le droit de voler l’emblème d’un passé plus honorable. Nos politiciens bourgeois devraient se rendre compte que quiconque revendique le drapeau noir-blanc-rouge pour cet État-ci, commet un vol à l’égard de notre passé. Le drapeau de jadis convenait seulement à l’empire de jadis, et la république – Dieu soit loué ! – a choisi pour elle celui qui lui convenait le mieux (Noir-rouge-or).
C’est ainsi que nous, les nationaux-socialistes, nous ne considérons pas que le déploiement de l’ancien drapeau soit un symbole expressif de notre activité, car nous ne voulons pas ressusciter le vieil empire qui a péri par ses propres fautes, nous voulons fonder un État nouveau.
Le mouvement qui combat aujourd’hui dans ce sens contre le marxisme doit exprimer aussi par son drapeau le symbole d’un État nouveau.
La question du nouveau drapeau, c’est-à-dire celle de son aspect, nous préoccupa alors beaucoup. De tous côtés nous recevions des suggestions pavées de bonnes intentions, mais dénuées de valeur pratique. Le nouveau drapeau devait être en même temps un symbole de notre propre lutte, être décoratif et suggestif. Celui qui a souvent eu affaire aux masses sait que ces détails insignifiants en apparence sont, en réalité, très importants. Un insigne impressionnant peut, dans des centaines de milliers de cas, éveiller le premier intérêt à l’égard d’un mouvement.
Pour cette raison, nous devions rejeter toutes les propositions qu’on nous faisait de différents côtés de symboliser notre mouvement par un drapeau blanc, ce qui eût rappelé l’ancien État ou plutôt les partis débiles dont le but unique était la reconstitution d’un état de choses disparu. De plus, le blanc n’est pas une couleur entraînante. Elle convient à de chastes sociétés de jeunes filles, mais pas à des mouvements explosifs d’une époque de révolutions.
Le noir nous fut aussi proposé : quoiqu’il convînt bien à l’époque présente, on ne pouvait voir en lui aucune indication définie sur les aspirations de notre mouvement. Enfin, cette couleur non plus n’exerce pas une action entraînante.
Blanc-bleu devait être éliminé, malgré son merveilleux effet esthétique, parce que c’était la couleur d’un État allemand particulier (Couleurs de la Bavière) et d’une tendance politique suspecte à cause de son étroit particularisme. En outre, on y aurait aussi difficilement trouvé une indication quelconque sur notre mouvement. Les mêmes raisons firent écarter le noir-blanc (Couleurs de la Prusse).
Pour noir-rouge-or, la question ne se posait même pas.
Pour noir-blanc-rouge non plus, pour les raisons déjà indiquées, du moins dans leur composition actuelle. Mais cet ensemble de couleurs exerce quand même une action bien supérieure aux autres. C’est l’accord le plus rayonnant qui existe.
Je me prononçai toujours pour la conservation des anciennes couleurs, non seulement parce qu’elles sont pour moi, en tant qu’ancien soldat, ce qu’il y a de plus sacré au monde, mais aussi parce qu’elles correspondent le plus à mon sens esthétique. Néanmoins je dus refuser sans exception les projets innombrables qui me parvenaient du sein de notre jeune mouvement, et qui, pour la plupart, traçaient la croix gammée sur le fond de l’ancien drapeau. Moi-même, étant le chef, je ne voulais pas imposer mon propre projet, parce que quelqu’un pouvait m’en suggérer un autre aussi bon ou même meilleur. En effet, un dentiste de Starnberg me soumit un projet qui n’était pas mauvais du tout, qui, d’ailleurs, se rapprochait du mien, et n’avait qu’un seul défaut : la croix gammée, aux branches caudées, se profilait sur un rond blanc. Moi- même, après d’innombrables essais, je m’arrêtai à une forme définitive : un rond blanc sur fond rouge, et une croix gammée noire au milieu. Après de longs essais, je trouvai aussi une relation définie entre la dimension du drapeau, la grandeur du rond blanc, la forme et l’épaisseur de la croix gammée.
Et c’est resté ainsi.
Dans le même esprit, nous commandâmes aussitôt des brassards pour les membres de notre service d’ordre, une bande rouge, sur laquelle se voyait un rond blanc avec une croix gammée noire.
L’insigne du parti fut tracé suivant les mêmes lignes : un rond blanc sur fond rouge, une croix gammée au milieu. Un orfèvre de Munich, Füss, livra le premier insigne valable, qui fut conservé par la suite.
À la fin de l’été 1920, notre nouveau drapeau fut présenté pour la première fois au public. Il convenait parfaitement à notre jeune mouvement. Il était jeune et nouveau comme celui-ci. Personne ne l’avait encore vu, il agit comme une torche enflammée. Nous éprouvâmes nous-mêmes une joie presque enfantine, quand une fidèle camarade de parti exécuta pour la première fois le croquis et nous livra le drapeau. Peu de mois plus tard, nous en avions déjà à Munich une demi-douzaine, et notre service d’ordre qui grandissait toujours en nombre contribua surtout à répandre ce nouveau symbole du mouvement.
Car, c’est vraiment un symbole ! Non seulement parce que les couleurs uniques, ardemment aimées de nous tous, et qui avaient jadis acquis tant d’honneur au peuple allemand, témoignaient de notre respect pour le passé, c’était aussi la meilleure incarnation des aspirations de notre mouvement. Nationaux-socialistes, nous voyions dans notre drapeau notre programme. Dans le rouge, nous voyions l’idée sociale du mouvement ; dans le blanc, l’idée nationaliste ; dans la croix gammée, la mission de la lutte pour le triomphe de l’aryen et aussi pour le triomphe de l’idée du travail productif, idée qui fut et restera éternellement antisémite.
Deux ans plus tard, quand notre service d’ordre fut devenu une troupe de combat, englobant des milliers d’hommes, il parut nécessaire de donner à cet organisme de combat un symbole spécial de victoire : l’étendard. C’est moi qui l’ai tracé, et j’ai confié son exécution à un vieux et fidèle camarade de parti, le maître-orfèvre Gahr. Depuis, l’étendard est l’emblème du combat national-socialiste.
* * *
Notre activité, qui s’intensifia sans cesse au cours de l’année 1920, nous amena enfin à tenir parfois deux réunions par semaine. Des foules s’assemblaient devant nos affiches, les plus grandes salles de la ville étaient combles, et des dizaines de milliers de marxistes égarés ont retrouvé le sentiment de leur communauté avec leur peuple pour devenir des pionniers du libre Reich de l’avenir.
Le public commença à nous connaître à Munich. On parla de nous, le mot « national-socialiste » devint courant, et c’était déjà un programme en soi. Le nombre de sympathisants, et même celui des membres du parti commença à croître sans interruption, de sorte que nous pûmes, déjà pendant l’hiver 1920-1921, paraître à Munich comme un parti puissant.
Les partis marxistes exceptés, aucun parti, surtout aucun parti national, ne put se prévaloir de manifestations aussi nombreuses, aussi imposantes que les nôtres. La salle du Kindlkeller de Munich, qui pouvait contenir cinq mille hommes, fut plus d’une fois pleine à craquer, et il n’y avait qu’une seule salle que nous n’avions pas encore osé affronter, c’était celle du cirque Krone.
Fin janvier 1921, de graves soucis assaillirent à nouveau l’Allemagne. L’accord de Paris, sur la base duquel l’Allemagne s’était engagée à payer la somme insensée de cent milliards de marks-or, devait se concréter sous la forme de l’ultimatum de Londres. L’union des associations dites racistes, qui existait à Munich depuis longtemps déjà, voulait organiser à cette occasion une grande protestation en commun. Le temps pressait beaucoup, et moi-même je devenais nerveux devant les éternelles hésitations et les atermoiements dans l’application des résolutions prises. On parla d’abord d’une manifestation sur la Königsplatz, mais on y renonça, parce qu’on avait peur d’être dispersés et roués de coups par les rouges, et on projeta une manifestation de protestation devant la Feldherrnhalle (C’est au même endroit que, le 9 novembre 1923, échoua le putsch hitlérien). Mais on renonça aussi à cela, et on proposa une réunion en commun dans le Kindlkeller de Munich. Entre temps, les jours fuyaient, les grands partis ne se souciaient aucunement de l’extrême gravité des événements et le comité central ne put se décider à fixer une date précise pour la manifestation projetée.
Le mardi 1er février 1921, je réclamai d’urgence une décision définitive. On me renvoya au mercredi. Le mercredi, j’exigeai une réponse absolument nette : la réunion aurait-elle lieu ? et quand ? La réponse fut de nouveau imprécise et évasive ; on déclara que le comité « avait l’intention » d’organiser la manifestation le mercredi suivant.
Je fus à bout de patience, et je décidai d’organiser seul la réunion de protestation. Mercredi à midi, je dictai le texte de l’affiche en dix minutes, à la machine, et je fis en même temps louer le cirque Krone pour le lendemain, jeudi 3 février.
C’était alors infiniment hasardeux. Non seulement il était douteux que nous pussions remplir l’immense salle, mais nous courions aussi le danger d’être mis en pièces. Notre service d’ordre était bien insuffisant pour cette salle immense. Je n’avais non plus aucune idée précise sur la tactique à suivre dans le cas d’une tentative de sabotage de la réunion. Je pensai que la réaction serait beaucoup plus difficile dans l’amphithéâtre d’un cirque que dans une salle ordinaire. En réalité, il s’avéra que c’était juste le contraire. Il était plus facile de maîtriser une bande de saboteurs dans l’espace immense d’un cirque que dans des salles bondées.
On était sûr d’une chose : tout échec pouvait nous rejeter dans l’ombre pour longtemps. Car un seul sabotage réussi d’une de nos réunions eût détruit d’un coup notre auréole et aurait encouragé nos adversaires à répéter ce qui leur aurait réussi une fois. Cela aurait pu conduire au sabotage de toute notre activité en fait de réunions, et nous n’aurions pu rétablir la situation que dans bien des mois et après les luttes les plus dures.
Nous n’avions qu’un seul jour pour afficher, ce même jeudi. Malheureusement, il plut dans la matinée, et l’on put redouter avec quelque raison que, dans de telles conditions, la plupart des gens ne préfèrent rester chez eux au lieu de courir, sous la pluie et la neige, à une réunion où on pouvait se faire assommer.
En somme, dans la matinée, j’eus peur tout d’un coup que la salle ne fût pas remplie (j’aurais été, dans ce cas, compromis aux yeux du comité central), de sorte que je dictai à la hâte plusieurs proclamations et les fis imprimer pour les distribuer dans l’après-midi. Elles contenaient naturellement l’invitation d’assister à la réunion.
Deux camions, que je fis louer, furent décorés d’autant de rouge que possible, on y planta quelques drapeaux, et on les fit occuper par quinze à vingt camarades du parti ; ils reçurent l’ordre de circuler inlassablement dans les rues de la ville, en jetant les proclamations, afin de faire de la propagande pour la manifestation populaire du soir. Ce fut la première fois que, dans les rues, circulèrent des camions avec drapeaux, qui ne fussent pas occupés par des marxistes. La bourgeoisie, bouche bée, suivait d’un regard fixe ces camions décorés de rouge et ornés de drapeaux à croix gammée, flottant au vent, tandis que dans les quartiers extérieurs s’élevaient d’innombrables poings serrés, dont les possesseurs paraissaient remplis de rage par cette nouvelle « provocation au prolétariat ». Car le marxisme seul avait le droit de tenir des réunions, ainsi que celui de circuler en camion.
À 7 heures du soir, le cirque était encore peu garni.
On me renseignait par téléphone toutes les dix minutes, et je devenais quelque peu inquiet ; car à 7 heures ou à 7 heures et quart, les autres salles avaient toujours été à moitié pleines, sinon plus. Mais ce fait allait m’être expliqué peu après. Je n’avais pas songé aux dimensions gigantesques de ce nouveau local : mille personnes suffisaient à remplir la salle du Hofbräuhaus, tandis que le même nombre d’assistants était comme englouti dans le cirque Krone. On les voyait à peine. Peu de temps après arrivèrent des nouvelles plus favorables et, à 7 heures trois quarts, on annonça que la salle était pleine aux trois quarts, et que des masses compactes s’amassaient encore devant les guichets. Sur ce, je me mis en route.
J’arrivai devant le cirque à 8 heures deux minutes. Il y avait encore foule devant l’édifice ; c’étaient, en partie, des curieux, en partie des adversaires, qui voulaient voir venir les événements.
Quand je pénétrai dans la salle, la même joie s’empara de moi qu’un an auparavant à notre première réunion dans la salle des fêtes au Hofbräuhaus. Mais seulement après m’être frayé un chemin parmi les murailles d’hommes, et avoir atteint l’estrade élevée, je pus voir notre succès dans toute sa grandeur. La salle béait devant moi comme un coquillage gigantesque, remplie de milliers et de milliers d’hommes. Même la piste était noire de monde. On avait vendu plus de cinq mille six cents cartes d’entrée et, en comptant tous les chômeurs, les étudiants pauvres et les équipes de notre service d’ordre, on arrive à peu près au chiffre de six mille cinq cents personnes.
« Bâtir l’avenir ou disparaître », tel était le titre de ma conférence, et mon cœur se réjouit en voyant que l’avenir, il était là, sous mes yeux.
Je commençai mon discours et je parlai près de deux heures et demie ; après la première demi-heure, je sentis que cette réunion serait un grand succès. Le contact entre ces milliers d’hommes et moi s’était établi. Dès cette première demi-heure, des acclamations spontanées, éclatant de plus en plus nourries, commencèrent à m’interrompre ; au bout de deux heures, elles firent place à ce silence religieux qui, bien des fois, depuis, dans cette même salle, me pénétra et qui restera inoubliable pour tous ceux qui l’ont vécu. On eût presque entendu un souffle dans cette foule immense, et quand j’eus prononcé mes dernières paroles, un flot d’acclamations déferla, puis la foule entonna avec ferveur le chant rédempteur : Deutschland über alles.
Je suivis encore des yeux le lent reflux de cette mer d’hommes qui s’écoulait par le vaste passage central pendant presque vingt minutes, tandis que la salle géante se vidait lentement. Alors seulement, transporté de joie, je quittai ma place pour rentrer chez moi.
De cette première réunion dans le cirque Krone furent prises des photographies. Elles montrent mieux que tous les mots le caractère grandiose de cette manifestation. Les feuilles bourgeoises en publièrent quelques reproductions, avec des notes, mais n’indiquèrent pas que c’était une manifestation « nationale » et passèrent consciencieusement sous silence ses organisateurs.
Par cette manifestation, nous sortîmes pour la première fois de la catégorie des partis sans importance. On ne pouvait plus nous ignorer. Et, pour ne pas laisser s’établir dans le public l’impression que le succès de cette réunion n’était qu’éphémère, j’annonçai aussitôt, pour la semaine suivante, une seconde manifestation dans le même cirque, et le résultat fut le même. De nouveau l’espace immense fut plein à craquer de masses humaines ; de sorte que je décidai de tenir la semaine suivante encore une réunion dans le même genre. Pour la troisième fois, le cirque géant, de haut en bas, fut comble.
Dans le courant de l’année 1921, j’intensifiai encore plus notre activité à Munich en fait de réunions. J’arrivai à tenir non seulement une réunion tous les huit jours, mais quelquefois deux réunions dans la même semaine, et même, en plein été et à la fin de l’automne, il y en eut parfois trois. Nous nous assemblions toujours dans le cirque, et nous pouvions constater, à notre satisfaction, que toutes nos soirées remportaient le même succès.
Il en résulta un nombre toujours croissant de sympathisants et une grande augmentation du nombre des membres du parti.
Devant de tels succès, nos adversaires ne restèrent naturellement pas inactifs. Ayant hésité dans leur tactique entre la terreur et le silence, ils ne purent, comme ils durent le reconnaître eux-mêmes, entraver le développement de notre mouvement. Ils se décidèrent donc à un dernier effort, à un acte de terreur qui devait définitivement exclure toute possibilité de poursuivre nos réunions.
Comme prétexte apparent, on utilisa un attentat très mystérieux contre un député de la diète, nommé Erhard Auer (Socialiste bavarois). Quelqu’un aurait fait feu, un soir, sur lui. On n’aurait pas tiré effectivement sur lui, mais on aurait tenté de le faire. Une présence d’esprit inouïe et le courage proverbial de ce chef social-démocrate auraient non seulement déjoué cet attentat criminel, mais auraient mis en fuite les scélérats. Ils avaient fui si vite et si bien que la police ne put jamais en trouver la moindre trace. Cet événement mystérieux fut utilisé par l’organe socialiste de Munich pour commencer contre nous une campagne d’excitation frénétique, en laissant pressentir, avec sa verbosité accoutumée, ce qui allait maintenant avoir lieu. De toutes façons, des mesures allaient être prises pour que nos arbres ne s’élèvent pas jusqu’au ciel ; il fallait que les bras prolétariens les abattent à temps.
Quelques jours plus tard, ce fut le grand coup.
Une réunion dans la salle des fêtes du Hofbäuhaus, dans laquelle je devais parler, fut choisie pour ce règlement de comptes définitif.
Le 4 novembre 1921, entre 6 et 7 heures de l’après- midi, nous reçûmes les premières communications annonçant que notre réunion serait impitoyablement sabotée et qu’on avait l’intention d’y envoyer dans ce but de grandes masses d’ouvriers des usines les plus rouges.
Il faut attribuer à une malchance que cette communication ne nous soit pas parvenue plus tôt. Le même jour, nous avions quitté notre vieux et vénérable bureau de la Sterneckgasse à Munich, et nous avions transféré notre siège dans un local nouveau ; ou plus exactement nous avions déjà évacué l’ancien local, mais n’avions pu nous installer dans le nouveau, parce qu’on y travaillait encore. Comme le téléphone avait été enlevé dans l’ancien bureau et n’avait pas encore été installé dans le nouveau, un grand nombre de tentatives de nous apprendre par téléphone ces projets de sabotage restèrent vaines.
En conséquence, cette réunion ne fut protégée que par un service d’ordre numériquement très faible, soixante hommes environ, l’appareil pour donner l’alarme n’était pas encore suffisamment perfectionné pour pouvoir amener en une heure les renforts suffisants. Signalons en outre que, souvent, des bruits alarmants de ce genre étaient parvenus à nos oreilles et qu’il n’était jamais rien arrivé d’anormal. Le vieux dicton que les révolutions annoncées d’avance meurent dans l’œuf, s’était jusqu’à présent montré vrai en ce qui nous concernait.
Pour cette raison aussi, donc, on ne fit peut-être pas tout ce qui pouvait être fait pour empêcher par la force le sabotage de notre réunion. Enfin, nous avons toujours estimé que la salle des fêtes du Hofbräuhaus de Munich était la moins appropriée pour une tentative de sabotage. Nous en avions plutôt redouté dans des salles plus grandes, surtout dans le cirque. Sous ce rapport, cette journée nous a donné une leçon précieuse. Plus tard, nous avons étudié toutes ces questions – je puis le dire – avec des méthodes scientifiques et nous sommes arrivés à des conclusions aussi imprévues qu’intéressantes ; par la suite, elles furent d’une importance décisive pour l’organisation et la tactique de nos sections d’assaut.
Quand je pénétrai, à 8 heures moins un quart, dans le vestibule du Hofbräuhaus, l’intention de sabotage ne pouvait plus faire de doutes. La salle était archi-pleine et la police, en conséquence, en avait fermé l’accès. Les adversaires qui étaient venus très tôt, se trouvaient dans la salle et nos propres partisans étaient encore dehors pour la plupart. La petite section d’assaut m’attendait dans le vestibule. Je fis fermer les portes de la grande salle et je dis à nos quarante-cinq ou quarante-six hommes de se mettre au garde à vous. Je déclarai alors à mes gars que c’était probablement la première fois qu’ils devaient prouver leur fidélité au mouvement, quoi qu’il arrive, aucun de nous ne devait quitter la salle, qu’à l’état de cadavre, personnellement je resterais dans la salle et je ne pouvais croire que nul d’entre eux pût m’abandonner ; si j’en voyais un se conduire en lâche, je lui arracherais moi-même son brassard et lui enlèverais son insigne. Ensuite, je leur enjoignis de réagir immédiatement contre toute tentative de sabotage, et de se rappeler toujours que la meilleure forme de la défense, c’est l’attaque.
Un Heil proféré trois fois, d’un son plus âpre et plus rauque que d’habitude, répondit à mes paroles.
Alors j’entrai dans la salle et je pus me rendre compte de la situation par mes propres yeux. C’était plein et une foule innombrable me foudroyait d’un regard de haine. Tandis que certains proféraient des interjections très explicites avec des grimaces ironiques : « On en finirait avec nous… Nous devions veiller à nos tripes… On nous fermerait la gueule une fois pour toutes » et bien d’autres expressions aussi élégantes. Ils étaient sûrs d’être les plus forts, et se comportaient en conséquence.
Néanmoins, la séance put être ouverte, et je commençai à parler. Dans le Hofbräuhaus, je me tenais toujours à un des fronts latéraux de la salle, et mon estrade était une table de brasserie. Je me trouvais donc au beau milieu des assistants. Peut-être cette circonstance contribua-t-elle à créer dans cette salle un état d’esprit tel que je n’ai retrouvé depuis rien de pareil nulle part. Devant moi, surtout à ma gauche, se tenaient assis et debout, exclusivement, des adversaires. C’étaient tous des hommes ou des gars robustes pour la plupart venant de la fabrique Maffei ou de chez Kustermann, ou de l’usine de compteurs Isaria, etc. Le long du mur de la salle, à gauche, ils s’étaient massés jusqu’à ma table même, et ils commandaient sans cesse de la bière, alignant les cruches vides sur la table devant eux. Des batteries entières s’amoncelaient et je compris qu’il était impossible que la soirée se passât sans accrochage.
Après une heure et demie environ – je pus parler tout ce temps en dépit des interruptions – on put croire que je m’étais rendu maître de la situation. Les meneurs de la troupe des saboteurs paraissaient le sentir aussi, ils devenaient de plus en plus inquiets, sortaient souvent, revenaient et parlaient à leurs hommes avec un énervement manifeste.
Une petite erreur psychologique que je commis en ripostant à une interruption, et dont je me rendis compte sur-le-champ, donna le signal de la tempête.
Quelques interruptions furieuses se firent entendre et tout d’un coup un homme sauta sur une chaise et hurla dans la salle : Liberté ! À ce signal, les champions de la liberté commencèrent leur tâche. En peu de secondes, la salle fut remplie d’une masse humaine hurlante, au-dessus de laquelle, pareilles aux décharges des obusiers, volaient d’innombrables cruches ; tout autour, le craquement des pieds de chaises, l’écrasement des cruches, des hurlements, des beuglements, des cris stridents, c’était un vacarme infernal.
Je restai debout à ma place et je pus observer comment mes gars remplissaient sans réserve leur devoir.
J’aurais bien voulu voir une réunion bourgeoise en pareil cas.
La danse n’avait pas encore commencé que mes hommes de la section d’assaut – qui s’appelèrent ainsi depuis ce jour-là – se lancèrent à l’attaque. Comme des loups, ils se jetèrent sur leurs adversaires par meutes de huit à dix, et commencèrent en effet à les chasser de la salle en les rouant de coups. Cinq minutes après, tous étaient couverts de sang. C’étaient des hommes ! J’appris à les connaître en cette occasion : à leur tête, mon brave Maurice ; mon secrétaire particulier actuel, Hess, bien d’autres qui, même grièvement atteints, attaquaient toujours tant qu’ils pouvaient se tenir debout. Le vacarme dura vingt minutes ; à ce moment, les adversaires qui étaient peut-être sept à huit cents, avaient été pour la plupart jetés hors de la salle et chassés au bas de l’escalier par mes hommes qui n’étaient même pas cinquante.
Mais dans le coin à gauche, au fond de la salle, se maintenait encore un bloc considérable d’adversaires qui nous opposaient une résistance acharnée. Tout à coup, près de l’entrée de la salle, éclatèrent deux coups de revolver dans la direction de l’estrade, et il s’ensuivit une terrible fusillade. Cela faisait tressaillir le cœur d’une sorte de jubilation, en évoquant des souvenirs de la guerre.
De mon poste, on ne pouvait distinguer qui tirait ; on ne pouvait établir qu’une chose : à partir de ce moment, la fureur de mes gars ensanglantés atteignit son paroxysme et les derniers saboteurs, vaincus, furent enfin expulsés de la salle. Vingt-cinq minutes à peu près s’étaient écoulées ; il semblait qu’une grenade eût éclaté dans la salle. On pansait beaucoup de mes partisans ; d’autres durent être emmenés en voiture, mais nous étions les maîtres de la situation. Hermann Esser, qui avait assumé ce soir la présidence de la réunion, déclara : « La séance continue. La parole est au conférencier », et je continuai mon discours. Nous avions déjà clos notre réunion, qu’arriva en courant un lieutenant de police, très excité, qui cria dans la salle, en agitant les bras comme un forcené : « La réunion est dissoute ! »
Je ne pus m’empêcher de rire à la vue de ce retardataire, arrivant après la bataille ; voilà bien la manière de faire l’important, si propre à la police ! Plus ils sont petits, plus ils cherchent à paraître grands.
Ce soir-là, nous avons vraiment appris beaucoup de choses et nos adversaires aussi n’ont plus oublié les leçons qu’ils reçurent alors.
Jusqu’à l’automne de 1923, la Münchener Post (Organe socialiste de Munich) ne nous menaça plus des « poings du prolétariat ».
Chapitre 8 – Le fort est plus fort quand il reste seul
Dans le chapitre précédent, j’ai parlé d’une communauté de travail des associations racistes allemandes : je voudrais maintenant m’expliquer très brièvement à ce sujet.
En général on comprend sous ce terme un groupement d’associations qui entrent en rapports dans le but de s’alléger mutuellement leur tâche ; qui élisent un comité directeur commun, et poursuivent alors une action commune. Il va de soi qu’il ne peut s’agir que d’associations, de ligues ou de partis dont les buts et les méthodes ne diffèrent pas trop. On croit généralement que c’est toujours le cas. Il est agréable et rassurant, pour l’Allemand moyen, d’apprendre que telles et telles associations, entrant ainsi dans une communauté de travail, ont découvert ce qui les unit et supprimé ce qui les séparait. On s’imagine alors qu’un tel groupement verra sa force d’action considérablement accrue, et que les faibles petits groupes qui le composent acquièrent ainsi brusquement de la puissance.
Mais la plupart du temps cela est faux !
À mon avis, pour mieux comprendre la question, il est intéressant et important d’élucider ce qu’il peut advenir de la formation d’associations prétendant vouloir poursuivre le même but. De prime abord et logiquement, un seul but ne devrait être poursuivi que par une seule association, et il semble peu raisonnable que plusieurs y concourent.
Il est hors de doute que cet objectif est choisi tout d’abord par un groupe unique. Un homme proclame quelque part une vérité, préconise la solution d’une question déterminée, impose un but, crée un mouvement qui doit aboutir à réaliser son intention.
Ainsi se fonde une association ou un parti, que son programme soit de provoquer la suppression d’abus existants ou de préparer certaines innovations dans l’avenir.
Mais une fois qu’il a vu le jour, un tel mouvement se trouve, de ce fait, posséder pratiquement un certain droit de priorité. Il serait naturel et compréhensible que tous ceux qui poursuivent le même but que ce mouvement, premier en date, se rangent derrière lui et le renforcent, au plus grand bénéfice de leurs intentions communes. Les esprits éclairés, en particulier, ne devraient voir, dans leur adhésion au nouveau parti, que le meilleur moyen de faire véritablement triompher une cause commune.
Par suite, il serait raisonnable et, dans un certain sens, loyal (et la loyauté, je le démontrerai plus loin, a, elle aussi, une grande importance) de ne constituer qu’un seul mouvement poursuivant un but unique.
Lorsqu’il n’en est pas ainsi, c’est généralement pour deux causes. La première, je suis presque tenté de la qualifier de tragique ; la seconde, il faut misérablement la chercher dans la faiblesse de la nature humaine.
Mais, en allant au fond des choses, je ne vois dans ces deux causes qu’une raison de plus pour tendre sa volonté, pour lui donner toute son intensité, pour parvenir enfin, grâce à la mise en valeur et à l’exaltation des forces réalisatrices de tout son être, à la solution du problème posé.
Voici la raison tragique pour laquelle, le plus souvent, des gens poursuivant une mission commune ne se mettent pas à l’ouvrage dans un groupement unique :
Presque toujours toute action de grand style, en ce monde, n’est que l’accomplissement d’un vœu inclus depuis longtemps déjà dans le cœur des hommes, d’un désir ardent qui y couvait en silence. Oui, il arrive que, des siècles durant, les hommes réclament la solution d’une question déterminée, souffrant d’une situation intolérable, mais persistante, sans que semble se rapprocher l’accomplissement du vœu qui leur est cher. On ne peut que qualifier d’impotents des peuples qui, à une semblable détresse, n’ont pas le courage de trouver une solution. Rien n’établira mieux, au contraire, la force vitale d’un peuple et son droit à la vie, garanti par cette force, que s’il engendre un jour, par un bienfait du sort, l’homme doué des grâces nécessaires pour combler enfin ses vœux, qu’il s’agisse de le délivrer d’une lourde servitude, ou d’écarter de lui une détresse amère, ou de calmer les âmes tourmentées par un sentiment d’insécurité.
Il est inhérent à certaines de ces questions de grande envergure que des milliers d’hommes s’attachent à les résoudre et que beaucoup se croient voués à cette tâche. Il arrive même que le sort en présente plusieurs en même temps au choix de leurs contemporains, et donne enfin, dans un libre jeu des forces, la victoire au plus fort, au plus apte, lui confiant ainsi la mission de résoudre le problème.
Il peut ainsi arriver que, pendant des siècles, les hommes, mécontents de leur vie religieuse, désirent en renouveler la forme et que, comme conséquence de cette agitation spirituelle, il surgisse de la masse quelques douzaines d’hommes qui, se croyant voués, par leur pénétration et leur savoir, à guérir cette détresse religieuse, se donnent comme les prophètes d’un enseignement nouveau, ou tout au moins comme les adversaires déclarés de l’enseignement jusque-là professé.
Là aussi, la loi naturelle veut que le plus fort soit désigné pour remplir la plus haute mission. Mais les autres hommes ne reconnaîtront le plus souvent que très tard que cet homme, et lui seul, était l’homme prédestiné. Au contraire, tous s’imaginent avoir autant de droits que lui et être également désignés pour résoudre le problème. Quant aux contemporains, ils sont, en général, incapables de distinguer celui d’entre eux qui, seul apte à accomplir de grandes choses, mérite, seul, d’être soutenu par eux tous.
C’est ainsi qu’entrent en scène, dans le cours des siècles, et souvent à la même époque, différents hommes qui fondent des mouvements pour atteindre des buts semblables ou supposés ou estimés tels. Le peuple lui-même est loin d’exprimer des vœux précis ; il a des idées d’ensemble, sans pouvoir se rendre compte avec précision et avec clarté de l’essence même de son idéal et de ses vœux, sans être même fixé sur la possibilité de les satisfaire.
Ce qu’il y a de tragique là-dedans, c’est le fait que deux hommes fassent effort, par des voies complètement différentes, vers le même but, et cela sans se connaître ; c’est qu’animés de la foi la plus pure en leur mission personnelle, ils se croient tenus de s’avancer sur leur propre route sans tenir aucun compte des autres.
Le fait qui, à première vue, paraît tout au moins tragique, c’est que tels mouvements politiques ou tels groupements religieux se forment dans une totale indépendance les uns des autres, bien que, étant issus des tendances générales d’une époque ; ils exercent leur activité dans le même sens. Il n’est que trop évident que si ces forces dispersées sur des voies différentes se ramassaient en une force unique, elles obtiendraient plus vite et plus sûrement le succès. Mais cela n’est pas. Car, dans sa rigoureuse logique, la nature tranche ; elle laisse les divers groupements se faire concurrence et se disputer les palmes de la victoire, tandis qu’elle conduit au but le mouvement qui a choisi le chemin le plus franc, le plus court, le plus sûr.
Comment pourra-t-on donc décider, du dehors, quel est le bon chemin, si les forces en présence ne peuvent pas entrer librement en jeu, si la décision suprême n’est pas soustraite au jugement doctrinaire des hommes infatués de leur savoir pour être remise à la démonstration irréfutable que fournit un succès manifeste, car c’est ce succès qui, en dernière analyse, confirme la convenance et l’utilité d’une action !
Si donc des groupes différents marchent vers le même but par des voies différentes, ils ne manqueront pas, après avoir pris connaissance des efforts semblables réalisés autour d’eux, d’examiner de plus près ce que vaut leur chemin, de l’abréger le plus possible, et, en tendant leur énergie au maximum, d’atteindre le plus tôt possible leur but.
Cette rivalité a pour effet d’élever le niveau de chaque combattant, en sorte que l’humanité doit souvent ses progrès aux enseignements qui ressortent de plusieurs tentatives manquées. Il faut en conclure que la connaissance de la meilleure route à suivre résulte finalement d’un état de choses qui nous paraissait tout d’abord tragique, et qui est la dispersion initiale d’éléments isolés, inconscients et irresponsables.
Ayant étudié tous les moyens possibles de résoudre la question allemande, l’histoire n’en retient que deux qui auraient dû être employés simultanément. Les tenants principaux, les champions des deux solutions étaient l’Autriche et la Prusse : les Habsbourg et les Hohenzollern.
Des deux côtés, on estimait devoir suivre toutes forces réunies, soit l’une, soit l’autre de ces routes, et en ce temps-là, on aurait plutôt pris la route sur laquelle s’engageait l’Autriche qui était alors du plus grand poids ; pourtant, les fins qu’elle poursuivait alors n’étaient pas la création d’un Reich allemand.
Somme toute, les événements qui permirent la constitution d’une unité allemande très forte furent ceux que des millions d’Allemands déplorèrent, le cœur en sang, comme la plus récente et la plus terrible manifestation de nos discordes fraternelles. Car la couronne impériale allemande fut, en vérité, forgée sur le champ de bataille de Königgrätz et non autour de Paris, comme on le pensa plus tard.
C’est ainsi que la fondation du Reich allemand ne fut pas le fruit d’une volonté commune appliquée à des voies communes, mais bien plutôt celui d’une lutte consciente et parfois inconsciente pour l’hégémonie, lutte dans laquelle la Prusse fut finalement victorieuse. Et quiconque recherche la vérité sans se laisser éblouir par la politique des partis, devra reconnaître que ce que l’on appelle la sagesse humaine n’aurait jamais conduit à prendre une décision aussi sage que celle que la sagesse de la vie, c’est-à-dire le libre jeu des forces, a laissé se transformer en une réalité. Qui donc, en effet, dans les pays allemands, aurait bien pu croire, sérieusement, il y a deux cents ans, que la Prusse des Hohenzollern deviendrait un jour la cellule de base, la fondatrice et l’éducatrice du nouveau Reich… et non pas les Habsbourg ? Qui donc voudrait encore nier, par contre, que le sort a beaucoup mieux fait d’en décider ainsi ? Ou qui pourrait se représenter aujourd’hui, en aucune façon, un Reich allemand reposant sur la base d’une dynastie pourrie et dépravée ?
Non, force est de reconnaître que le développement naturel des choses a mis – après des combats séculaires – celui qui convenait le mieux à la place qui lui revenait.
Il en sera toujours ainsi, de même que cela a toujours été.
Aussi ne faut-il pas regretter que des hommes différents puissent se mettre en route vers un même but : le plus vigoureux et le plus alerte s’affirmera dans la course et en sera le vainqueur.
Il y a une deuxième cause pour laquelle souvent, dans la vie des peuples, des mouvements, analogues en apparence, cherchent cependant à atteindre par des voies différentes un but qui semble le même. Cette cause-là n’a plus rien de tragique. Elle n’est que pitoyable.
Elle réside dans le lamentable mélange d’envie, de jalousie et de malhonnêteté que l’on trouve malheureusement souvent réunies dans certains spécimens de l’espèce humaine.
Qu’un homme se lève, renseigné à fond sur la détresse de son peuple, et que, sachant parfaitement de quoi il souffre, il essaie sérieusement de le soulager : dès qu’il aura fixé le but à atteindre et choisi la voie qui peut y conduire, aussitôt des esprits étroits et même très étroits surveilleront attentivement et passionnément les agissements de cet homme, qui aura attiré sur lui les regards du public. Je comparerai ces gens-là aux moineaux qui ont l’air de se désintéresser de tout, mais observent, au contraire, longuement et avec la plus grande attention le compagnon plus heureux qui a trouvé un petit morceau de pain : et ils l’en dépouillent tout à coup, au moment où il s’y attend le moins.
Voici un homme qui s’engage dans un chemin nouveau : aussitôt apparaissent des flâneurs et des fainéants à la recherche de quelque bouchée, aubaine qu’ils espèrent bien trouver au bout de ce chemin.
Et dès qu’ils ont supputé où pourrait bien se trouver un autre chemin, ils se mettent ardemment en marche pour chercher celui qui les conduira, si possible, plus rapidement au but.
Si le nouveau mouvement est fondé et s’il a arrêté un programme bien défini, alors surviennent les hommes de cette espèce qui prétendent combattre pour le même but : mais qu’à Dieu ne plaise, ils se gardent d’entrer loyalement dans les rangs du mouvement en question et de reconnaître ainsi sa priorité : ils lui volent, au contraire, son programme et fondent sur lui, et pour leur propre compte, un nouveau parti.
Ils sont, en outre, assez impudents pour affirmer à leurs contemporains mal renseignés qu’ils avaient voulu exactement la même chose que l’autre parti, et depuis bien plus longtemps que lui : et il n’est pas rare qu’ils parviennent ainsi à paraître sous un jour favorable, au lieu de succomber, comme il serait juste, sous le mépris général.
N’est-ce pas une grande impudence que de prétendre inscrire sur son propre drapeau la mission qu’un autre a déjà inscrite sur le sien, d’emprunter les directives de son programme, puis, comme si l’on était le créateur de tout cela, de faire bande à part ?
L’impudence apparaît surtout en ceci : ces mêmes éléments qui, en fondant un parti nouveau, ont commencé par être cause d’une dislocation, parlent, eux surtout (nous en avons l’expérience) de la nécessité de l’union et de l’unité ; et cela dès qu’ils croient remarquer que l’avance de l’adversaire ne peut plus vraiment être rattrapée.
Voilà comment on arrive à l’émiettement raciste. Dans tous les cas, la création de toute une série de groupes, partis, etc., qualifiés de « racistes », avait eu lieu, en 1918 et 1919, sans que les fondateurs en aient la responsabilité et par le simple développement des événements. L’un d’entre eux s’était lentement cristallisé et avait remporté de beaux succès dès 1920 ; c’était le Parti national, socialiste, démocratique et travailliste (le N. S. D. A. P.). La loyauté foncière de ses fondateurs ne saurait être démontrée de façon plus éclatante que par le fait suivant : la majorité de ses dirigeants prit cette décision, vraiment admirable, de sacrifier leur propre mouvement, qui paraissait avoir moins de chances de succès, au mouvement qui était le plus fort, en dissolvant le leur et en l’incorporant sans conditions dans l’autre.
Ceci s’applique particulièrement à Julius Streicher, le principal militant du parti, qui, à Nuremberg, s’appelait, alors, le Parti allemand socialiste (D. S. P.). Le N. S. D. A. P. et le D. S. P. s’étaient formés d’une façon complètement indépendante l’un de l’autre, mais avec les mêmes buts. Le champion principal du D. S. P. était, comme je viens de le dire, à Nuremberg, Julius Streicher, professeur dans cette ville. Au début, lui aussi, était persuadé du caractère sacré de sa mission et de l’avenir de son mouvement.
Dès qu’il put se rendre compte de la supériorité en force et en puissance d’expansion du N. S. D. A. P., il cessa toute activité au profit du D. S. P. et de la Werkgemeinschaft (Association ouvrière), et obligea ses partisans à entrer dans les rangs du N. S. D. A. P., qui, dans sa lutte contre lui, l’avait emporté, et à continuer à lutter dans le sens de ce nouveau parti, pour le but commun. Cette décision, grave en soi, était aussi profondément opportune.
Dès les débuts de notre activité comme parti, nous n’avons plus eu à constater chez nous de traces d’émiettement : grâce à la volonté loyale des hommes d’alors, tout a abouti de façon non moins loyale, droite et heureuse.
Ce que nous entendons aujourd’hui par l’expression « émiettement raciste » ne doit son existence, comme je l’ai déjà dit, qu’exceptionnellement à la deuxième des causes que j’ai indiquées : des hommes ambitieux, qui n’avaient jamais eu auparavant d’idées propres ni encore bien moins de buts propres, se sentant tout à coup une « vocation » au moment précis où ils s’apercevaient que le succès du N. S. D. A. P. était indéniable.
Soudain, surgirent des programmes qui étaient intégralement copiés sur les nôtres ; on défendait des idées qui nous étaient empruntées, on indiquait des buts pour lesquels nous avions déjà lutté depuis des années, on s’engageait sur des voies que le N. S. D. A. P. suivait depuis longtemps. On cherchait à expliquer, par tous les moyens possibles, pourquoi on avait été obligé de fonder ces nouveaux partis, malgré l’existence déjà ancienne du N. S. D. A. P. ; mais plus les motifs invoqués étaient nobles, plus ces déclarations étaient fausses.
En vérité, il n’y avait au fond de tout cela qu’un seul mobile : l’ambition personnelle des fondateurs voulant jouer un rôle à tout prix, alors que l’entrée en scène de leur parti, parfaitement insignifiante, ne prouvait absolument que leur audace à s’approprier les idées d’autrui, audace que d’ordinaire, dans la vie courante, on a coutume d’appeler « vol ».
Il n’était alors aucune conception ni aucune idée qu’un de ces kleptomanes de la politique ne ramassât sans retard au bénéfice de son affaire. Ce furent d’ailleurs les mêmes qui, plus tard, déploraient profondément et les larmes aux yeux « l’émiettement raciste » ; qui parlaient constamment de la nécessité de l’union, dans la douce espérance de pouvoir couvrir suffisamment la voix des autres pour que ceux-ci, fatigués de leurs cris et de leurs plaintes éternelles, jettent en pâture aux voleurs, non seulement les idées déjà volées par ceux-ci, mais aussi les mouvements créés pour les soutenir.
Comme ils ne réussirent pas et comme ces nouvelles entreprises (en raison de la maigre valeur intellectuelle de leurs promoteurs) ne rendirent pas ce qu’ils en attendaient, on les vit, communément, réduire leurs prétentions et se contenter de pouvoir prendre pied dans quelqu’une des « associations ouvrières ».
Tout ce qui ne pouvait pas, alors, tenir debout par soi-même, se ralliait à ces « associations ouvrières » ; on partait de cette croyance que huit paralytiques, pendus les uns aux autres, forment sûrement un gladiateur.
Il pouvait se trouver, parmi les paralytiques, un homme vraiment sain : mais alors il n’avait pas trop de toutes ses forces pour maintenir debout tous les autres et il se trouvait ainsi paralysé lui-même. Nous avons toujours considéré cette fusion avec les associations ouvrières comme une manœuvre, mais, à ce sujet, nous ne devons jamais oublier les importantes considérations suivantes :
La constitution en association ouvrière ne permet jamais de transformer des groupements faibles en groupements forts ; par contre, un groupement fort s’affaiblira bien souvent, par une telle collusion. L’opinion d’après laquelle, en assemblant des groupes faibles, on peut former un faisceau fort, est fausse : en effet, la majorité, sous toutes ses formes et quelles que soient les conditions premières dans lesquelles elle a été constituée, ne représente – l’expérience le prouve – que bêtise et lâcheté et, par suite, toute réunion de groupes multiples, dirigée elle-même par un commandement élu et à plusieurs têtes, est livrée à la lâcheté et à la faiblesse. En outre, une telle concentration contrarie le libre jeu des forces, le combat pour la sélection du meilleur chef est supprimé et, par suite, la victoire définitive des idées les plus saines et les plus fortes est pour toujours compromise. De telles associations sont ainsi les ennemies du développement naturel des choses, car, le plus souvent, elles empêchent plutôt qu’elles ne hâtent la solution du problème pour lequel on combat.
Il peut arriver cependant que des considérations de pure tactique et certaines prévisions de l’avenir amènent la direction suprême d’un mouvement à consentir à une union avec des groupes semblables et peut-être à s’engager dans des démarches communes : ce ne doit être que pour un très court délai et pour traiter certaines questions bien déterminées.
Mais jamais cette situation ne doit se perpétuer : ce serait, pour le mouvement, renoncer à sa mission rédemptrice. Car, dès qu’il se serait empêtré définitivement dans une telle union, le mouvement perdrait la possibilité (et aussi le droit) de laisser sa propre force se développer intégralement dans son sens naturel ; par suite, de dominer les mouvement rivaux et d’atteindre en vainqueur le but fixé.
Il ne faut jamais oublier que tout ce qui est, en ce monde, véritablement grand, n’a pas été obtenu de haute lutte par des coalitions, mais a toujours été conquis par un vainqueur unique.
Par suite de leur origine, les succès des coalitions portent en eux-mêmes le germe de l’émiettement futur, et même de la perte totale des résultats atteints. Les mouvements révolutionnaires d’ordre spirituel, vraiment grands et susceptibles de bouleverser le monde, ne peuvent être conçus et menés à bien que par des combats titanesques livrés par un groupement indépendant, jamais par des coalitions de groupements.
Ainsi, et avant tout, l’État raciste ne peut pas être créé par la volonté – faite de compromis – d’une assemblée ouvrière populaire, mais par la volonté agissante d’un mouvement unique qui s’est frayé la route à travers les autres.
Chapitre 9 – Conséquences sur le sens et l’organisation des sections d’assaut
La force de l’ancien État reposait principalement sur trois colonnes : sa forme monarchique, son corps de fonctionnaires administratifs et son armée. La révolution de 1918 a aboli la forme de l’État, a dissous l’armée et a livré le corps des fonctionnaires à la corruption des partis ; les appuis essentiels de ce qu’on appelle l’autorité d’État étaient ainsi abattus.
Le premier fondement sur lequel repose l’autorité, c’est toujours la popularité. Pourtant, une autorité qui ne repose que sur elle est encore extrêmement faible ; sa sécurité et sa stabilité sont incertaines. Aussi tous ceux qui ne tiennent leur autorité que de la popularité, doivent-ils s’efforcer d’en élargir la base et pour cela de constituer fortement le pouvoir.
C’est donc dans le pouvoir, dans la puissance, que nous voyons le deuxième fondement de toute autorité.
Celui-ci est déjà notablement plus stable et plus sûr que le premier, mais il n’est nullement plus robuste.
Si la popularité et la force s’unissent, et si elles peuvent se maintenir unies, pendant un certain temps, alors peut se former, sur des bases encore plus solides, une nouvelle autorité, celle de la tradition. Si enfin popularité, force et tradition s’unissent, l’autorité qui en dérive peut être considérée comme inébranlable.
La révolution a rendu impossible ce triple concours ; elle a retiré toute autorité à la tradition. Avec l’écroulement de l’ancien Empire, la mise au rancart de l’ancienne forme de gouvernement, l’anéantissement des anciens signes de la souveraineté et des symboles impériaux, la tradition a été soudainement déchirée. Il en est résulté un très grand ébranlement de l’autorité de l’État.
Même la deuxième colonne de l’autorité de l’État n’existait plus : d’ailleurs, pour pouvoir faire la révolution, on avait été obligé de dissoudre ce qui était l’incarnation de la force et de la puissance organisées de l’État, je veux dire l’armée. Oui, il a fallu utiliser même les débris rongés de l’armée, comme éléments des combats révolutionnaires.
Les armées du front n’étaient peut-être pas tombées dans une égale déliquescence : mais elles furent de plus en plus rongées par l’acide de la désorganisation du pays natal, à mesure qu’elles s’éloignèrent davantage des lieux glorieux où elles avaient héroïquement combattu pendant quatre ans et demi ; elles finirent, en arrivant dans les centres de démobilisation, par cette méconnaissance de l’obéissance que fut la soi-disant obéissance volontaire aux conseils de soldats.
On ne pouvait plus, en tous cas, n’appuyer aucune autorité sur ces mutins qui considéraient le service militaire comme du travail à huit heures par jour. Dès lors, le deuxième élément, celui qui garantit avant tout la solidité de l’autorité était également éliminé, et la révolution ne possédait plus, à proprement parler, que l’élément originel, la popularité, sur lequel elle put asseoir son autorité. Or ce fondement présentait justement une extraordinaire insécurité. Sans doute, la révolution réussit, d’un seul coup de bélier, à abattre le vieil édifice de l’État, mais si l’on regarde au fond des choses, on doit reconnaître que ce résultat ne fut atteint que parce que l’équilibre normal de notre peuple et sa structure intime avaient déjà été détruits par la guerre.
Tout peuple considéré dans son ensemble s’articule en trois grandes classes :
D’une part, un groupe extrême, composé de l’élite des citoyens est bon, doué de toutes les vertus, et par- dessus tout, est remarquable par son courage et par son esprit de sacrifice ; à l’opposé, un autre groupe extrême, composé du pire rebut des hommes, est rendu exécrable par la présence en son sein de tous les instincts égoïstes et de tous les vices. Entre ces deux groupes extrêmes est la troisième classe, la grande et large classe moyenne, qui ne participe ni à l’héroïsme éclatant de la première ni à la mentalité vulgaire et criminelle de la seconde.
Les périodes d’ascension d’un corps social se produisent, il faut le dire, exclusivement sous l’impulsion de la classe extrême des meilleurs citoyens.
Les périodes de développement normal et régulier ou d’état stable, se produisent et durent visiblement lorsque dominent les éléments moyens, tandis que les classes extrêmes ne bougent pas ou s’élèvent.
Les époques d’effondrement d’un corps social sont déterminées par l’arrivée au pouvoir des pires éléments.
Il est remarquable, à cet égard, que la grande masse, ou classe moyenne – je la désignerai ainsi – ne peut se manifester de façon sensible que lorsque les deux classes extrêmes sont aux prises dans une lutte mutuelle ; il est remarquable aussi que cette grande masse se soumet toujours complaisamment au vainqueur, après la victoire d’un des partis extrêmes. Si les meilleurs ont eu le dessus, la grande masse les suivra ; si ce sont les pires, elle ne s’opposera pas, tout au moins, à leur action : car la masse du centre ne combattra jamais.
Or la guerre a troublé, en ses quatre ans et demi de durée sanglante, l’équilibre intérieur de ces trois classes, à un point tel que – tout en reconnaissant le nombre des victimes de la guerre dans les rangs de la classe moyenne – il faut bien constater que cette guerre a conduit à faire couler presque jusqu’à la dernière goutte le sang de l’élite de la nation. Car c’est effrayant le torrent de sang héroïque que l’Allemand a versé pendant ces quatre ans et demi.
Que l’on additionne, en effet, les milliers et les milliers de cas dans lesquels on faisait appel à des volontaires : volontaires pour le front, patrouilleurs volontaires, porteurs d’ordres volontaires, téléphonistes volontaires, volontaires pour l’aviation, volontaires pour les passages de rivière, volontaires pour les sous- marins, volontaires pour les bataillons d’assaut, etc., toujours et toujours et encore, pendant quatre ans et demi, en mille occasions, il fallait des volontaires et encore des volontaires, et l’on voyait toujours le même geste ; le jeune homme imberbe ou l’homme mûr, tous deux brûlants de patriotisme ou remplis d’un grand courage personnel ou de la plus haute conscience du devoir, se présentaient.
Dix mille, cent mille cas semblables se présentaient et peu à peu, cette réserve d’hommes se tarissait, s’épuisait. Ce qui ne tombait pas était mutilé par les projectiles ou s’égrenait peu à peu dans le nombre infime des survivants. Que l’on pense donc, avant tout, que l’année 1914 a mis sur pied des armées entières de soi-disant volontaires, qui, par suite du criminel manque de conscience de nos propres-à-rien de parlementaires, n’avaient reçu, en temps de paix, aucune instruction de quelque valeur : ils furent donc livrés à l’ennemi comme une chair à canon sans défense.
Les quatre cent mille hommes qui tombèrent alors, tués ou mutilés dans les Flandres, ne purent plus être remplacés. Leur perte n’était plus seulement numérique. Leur mort fit rapidement pencher la balance et pas du bon côté : plus lourds qu’auparavant pesaient les éléments de grossièreté, d’infamie et de lâcheté, bref, la masse extrême, la mauvaise.
Car il y avait quelque chose de plus :
C’est que, non seulement pendant quatre ans et demi, le meilleur des groupes extrêmes avait été atrocement décimé sur les champs de bataille, mais encore le groupe des mauvais s’était, pendant le même temps, merveilleusement conservé.
Alors, chacun des héros qui s’était offert comme volontaire et qui, après le sacrifice de sa vie, était monté au Walhalla, était remplacé par un embusqué qui avait jusque-là très prudemment tourné le dos à la mort, pour s’occuper plus ou moins utilement à l’intérieur de son pays.
La fin de la guerre offrait donc le tableau suivant : la nombreuse classe moyenne de la nation a payé régulièrement son impôt du sang. La classe extrême des meilleurs s’est presque intégralement sacrifiée avec un héroïsme exemplaire.
La classe extrême des mauvais, favorisée par les lois les plus insensées d’une part, par un insuffisant usage du code militaire d’autre part, est malheureusement là, intégralement.
Cette crasse bien conservée de notre corps social a alors fait la révolution ; et elle n’a pu la faire que grâce à ce fait que la fraction extrême des meilleurs éléments du pays ne pouvait plus s’y opposer : elle était morte.
On ne saurait donc qualifier qu’avec beaucoup de réserves la Révolution allemande de « populaire » : ce n’est pas le peuple allemand lui-même qui a commis ce crime de Caïn, c’est la canaille ténébreuse de ses déserteurs, de ses souteneurs, etc.
L’homme du front saluait la fin de la lutte sanglante ; il était heureux de pouvoir de nouveau
fouler le sol de son pays natal, de revoir sa femme et ses enfants, mais il n’avait par lui-même rien de commun avec la révolution. Il ne l’aimait pas, il aimait encore moins ses instigateurs et ses organisateurs. Au cours de ces quatre années et demie des plus durs combats, il avait oublié les hyènes des partis ; tous les gredins qui les composent lui étaient devenus étrangers. La révolution n’avait été vraiment populaire que chez une petite partie du peuple allemand : notamment dans la classe de ceux qui l’avaient favorisée et qui avaient choisi le sac tyrolien, comme signe de reconnaissance de tous les citoyens d’honneur du nouvel État. Ils n’aimaient pas la révolution pour elle-même, comme tant de gens commettent encore l’erreur de le croire, ils l’aimaient pour ses possibilités. Mais la popularité ne semblait pas devoir suffire bien longtemps à étayer l’autorité chez ces brigands marxistes. Et, pourtant, la jeune République avait à tout prix besoin d’autorité, si elle ne voulait pas, après une courte période de chaos, se voir de nouveau enlacée subitement par une puissance pratiquant la loi du talion et composée des derniers éléments du parti des bons.
Ce que craignaient alors le plus les hommes qui avaient fait la révolution, c’était de perdre complètement pied eux-mêmes dans le tourbillon de leur propre confusion et de se sentir soudain saisis et transportés sur un autre terrain par une poigne d’airain, comme il en surgit plus d’une fois dans l’histoire d’un peuple, en de telles conjonctures. Il fallait à tout prix que la République se consolidât.
Elle fut donc presque aussitôt forcée, par la fragilité de sa faible popularité, de créer de nouveau une force organisée, pour pouvoir fonder sur elle une autorité plus solide.
Quand, aux jours de décembre, janvier et février 1918-1919, les matamores de la révolution sentirent fléchir le sol sous leurs pieds, ils cherchèrent à la ronde des hommes prêts à consolider, par la force des armes, la faible garantie qu’était pour eux l’amour de leur peuple.
La république « antimilitariste » avait besoin de soldats, mais le premier et le seul appui de son autorité d’État – j’entends, sa popularité – n’avait de racines que dans une société de souteneurs, de voleurs, de cambrioleurs, de déserteurs, d’embusqués, etc., donc dans cette partie du peuple que nous avons appelée la classe extrême des mauvais : dans ces conditions, il eût été vain d’espérer recruter dans ces milieux aucun homme qui fût prêt à mettre sa vie au service d’un nouvel idéal.
La couche sociale, où brillait la pensée révolutionnaire et par laquelle la révolution avait été faite, n’était ni capable de fournir des soldats pour la défense de cette révolution, ni disposée à le faire. Car cette couche sociale ne désirait, en aucune manière, l’organisation d’un État républicain, mais seulement la désorganisation de l’État précédent, afin de mieux satisfaire ses instincts. Son mot d’ordre n’était pas « Ordre et construction de la République allemande », mais plutôt : « Pillage de la République ».
Le cri d’alarme que poussèrent alors avec la pire angoisse les représentants du peuple, ne trouva pas d’écho dans cette couche sociale : il n’y déchaîna, au contraire, que résistance et amertume.
On éprouvait en effet, en ces premiers jours, une impression d’absence de confiance et de foi ; on devinait, en voyant se constituer une autorité qui ne reposait plus seulement sur la popularité, mais sur la puissance, qu’allait commencer la lutte contre les pratiques, qui étaient pour ces éléments le but essentiel de la révolution : contre le droit au vol, contre la tyrannie déchaînée d’une horde de voleurs et de pillards, de toute la canaille évadée des prisons.
Les représentants du peuple pouvaient bien multiplier leurs appels ! Nul ne sortait des rangs, seul le cri hostile de « traîtres » leur marquait les sentiments de ceux sur lesquels reposait leur popularité.
Il se trouva alors, pour la première fois, de jeunes Allemands prêts à endosser, une fois de plus, leur vareuse de soldats, à saisir mousqueton ou fusil, pour se mettre, du moins ils le pensaient, au service du « calme et de l’ordre », prêts à marcher, le casque d’acier sur la tête, contre les destructeurs de leur pays natal.
Ils se groupèrent comme volontaires en corps francs, et tout en haïssant furieusement la révolution, entreprirent de la protéger, donc, en fait, de la renforcer. Ils agissaient ainsi de la meilleure foi du monde.
Le véritable organisateur de la révolution, celui qui en tirait effectivement les ficelles, le Juif international, avait alors bien apprécié la situation. Le peuple allemand n’était pas encore mûr pour pouvoir être, comme il advint en Russie, traîné dans la boue sanglante du marécage bolcheviste. Cela tenait en grande partie à l’unité de race qui rapprochait toujours davantage les intellectuels allemands et les travailleurs allemands.
Cela tenait aussi à la grande interpénétration des couches populaires et des éléments cultivés, phénomène social commun aux pays de l’ouest de l’Europe, mais totalement inconnu en Russie. Dans ce pays, en effet, les éléments intellectuels n’étaient pas, pour la plupart, de nationalité russe, ou, tout au moins, n’avaient rien de slave.
La même couche intellectuelle supérieure de la Russie d’avant-guerre pouvait être à tout moment détruite, par suite de l’absence totale d’un élément intermédiaire qui l’eût reliée à la masse du peuple. Tandis que le niveau intellectuel et moral de cette masse était incroyablement bas.
Dès que l’on réussit, en Russie, à exciter la multitude des ignorants et des illettrés de la grande masse contre le petit nombre des intellectuels, le sort de ce pays fut réglé, et la révolution réussie. L’analphabète russe était devenu l’esclave sans défense de ses dictateurs juifs qui, de leur côté, avaient été assez habiles pour parer cette dictature de la rubrique : « Dictature populaire ».
Voici ce qui se passa en Allemagne :
Autant il est vrai que la révolution n’a pu réussir en Allemagne qu’en raison de la décomposition progressive de l’armée, autant il est certain que le véritable agent de la révolution et de la dissociation de l’armée n’a pas été le soldat du front : ce fut cette canaille plus ou moins ténébreuse qui traînait ses guêtres dans sa garnison natale ou qui servait quelque part, au titre économique, comme « indispensable ». Cette armée-là fut renforcée par des dizaines de milliers de déserteurs qui avaient pu, sans grand risque, tourner le dos au front.
En tous temps, le véritable lâche ne redoute, bien entendu, rien plus que la mort. La mort, elle, se présentait à lui tous les jours, au front, sous des milliers de formes différentes.
Si l’on veut maintenir quand même dans leur devoir des garçons faibles, chancelants ou même poltrons, il n’y a et il n’y a eu de tout temps qu’un seul moyen : il faut que le déserteur sache que sa désertion lui procurera, à coup sûr, ce qu’il veut éviter. Au front, on peut mourir ; comme déserteur, on doit mourir.
Seule, cette menace draconienne, visant rigoureusement tout acte de désertion, peut permettre d’obtenir un effet de terreur à l’égard de l’individu, comme de la collectivité.
C’étaient là tout le sens et tout le but de la loi martiale.
Il était très beau de croire à la possibilité de mener jusqu’au bout le grand combat pour l’existence d’un peuple, en s’appuyant uniquement sur des dévouements innés, accrus encore du sentiment de la nécessité. L’accomplissement volontaire du devoir a toujours déterminé la conduite des meilleurs citoyens ; mais cela n’est plus vrai pour les hommes moyens.
C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir de telles lois : les lois contre le vol, par exemple, n’ont pas été instituées contre les gens foncièrement honnêtes, mais contre les éléments chancelants et faibles. Sans ces lois qui imposent aux mauvaises gens une crainte salutaire, on verrait fleurir l’opinion que l’homme d’honneur n’est qu’un imbécile et qu’il est beaucoup plus opportun de participer à un vol que de rester les mains vides ou même d’être volé.
De même, il était absurde de penser que dans une guerre qui, selon toutes les prévisions, devait faire rage pendant plusieurs années, on pourrait se passer des moyens qu’une expérience, vieille de plusieurs dizaines de siècles, a enseignés comme seuls capables de contraindre à l’exécution de leur devoir des hommes faibles ou peu sûrs d’eux-mêmes dans les moments critiques, et dans les instants où les nerfs sont le plus durement mis à l’épreuve.
À l’égard des héros volontaires, la loi martiale est naturellement inutile : elle ne vaut que pour le lâche et l’égoïste qui, à l’heure où son peuple est dans la détresse, estime sa propre existence plus précieuse que celle de la collectivité.
Ce n’est que par la crainte du plus rigoureux châtiment que l’on peut empêcher ces hommes faibles, sans caractère, de céder à leur lâcheté. Lorsque des hommes doivent sans répit lutter avec la mort, tenir pendant des semaines, souvent mal nourris, l’appelé du contingent, qui commence à flancher, ne sera pas maintenu dans la bonne voie par la crainte de la prison ou même des travaux forcés, mais uniquement par celle de la peine de mort, appliquée sans merci, car l’expérience lui montre qu’à de tels moments, la prison est un séjour encore mille fois plus agréable que le champ de bataille, puisque, au moins en prison, sa vie – d’une valeur inappréciable – n’est pas menacée.
Les circonstances se sont cruellement vengées de ce que l’on ait, au front, supprimé la peine de mort, et rendu inopérante la loi martiale. Une armée de déserteurs se répandit, surtout en 1918, dans la zone de l’arrière ; elle aida à constituer cette grande organisation criminelle que nous vîmes soudain apparaître devant nous après le 7 novembre 1918 et qui fit la révolution.
Quant au front lui-même, il n’avait, à vrai dire, rien de commun avec elle. Ceux du front étaient naturellement tous animés d’un fervent désir de paix. Mais c’était justement ce fait, et ce fait seul, qui constituait pour la révolution un danger des plus sérieux.
Car lorsque, après l’armistice, les armées allemandes commencèrent à se rapprocher du pays natal, les révolutionnaires d’alors, pleins d’effroi, étaient obsédés par cette unique question : « Que vont faire les troupes du front ? Est-ce que les poilus vont tolérer cela ? »
Pendant ces semaines-là, il fallait qu’extérieurement tout au moins, la révolution parût très modérée, sinon elle risquait d’être soudain taillée en pièces avec la vitesse de la foudre par quelques divisions allemandes.
Car si, alors, un seul général avait décidé de faire descendre à coups de fusil, par sa division fidèlement dévouée, toutes les loques rouges, de faire aligner au mur les « conseils de soldats », de briser les résistances possibles à coups de minenwerfer ou de grenades, en moins de quatre semaines cette division se serait grossie d’assez d’hommes pour pouvoir donner naissance à soixante divisions.
C’était cette pensée qui faisait le plus trembler les Juifs, qui tiraient les ficelles. Et cette crainte les détermina à maintenir à la révolution une allure assez modérée : la révolution ne devait pas dégénérer en bolchevisme, mais devait au contraire, étant donné les circonstances, jouer hypocritement le régime du calme et de l’ordre.
De là, ses nombreuses et importantes concessions, son appel au vieux corps des fonctionnaires, aux vieux chefs de l’armée. On avait besoin d’eux, au moins pour un certain temps, et ce n’était qu’après que ces hommes, véritables têtes de Turcs, auraient fait l’office qu’on attendait d’eux, que l’on pouvait oser leur décocher les coups de pieds qui leur étaient dus et arracher la République des mains des anciens serviteurs de l’État pour la livrer aux griffes des vautours de la révolution.
C’était par ce moyen seul que l’on pouvait espérer duper de vieux généraux et de vieux fonctionnaires de l’État, afin de désarmer d’avance une résistance éventuelle de leur part, en présentant ce nouvel état de choses sous des apparences d’innocence et de douceur.
Cette manœuvre a très bien réussi, l’expérience l’a démontré.
Seulement, la révolution n’avait pas été faite par des éléments d’ordre et de calme, mais bien plutôt par des éléments d’émeute, de vol et de pillage. Et si, pour ces derniers, le développement de la révolution n’était pas celui qu’ils avaient voulu, il n’était pas davantage possible, pour des raisons de tactique politique, qu’elle prît le cours qui aurait le plus favorisé leurs goûts.
Par son accroissement progressif, la Social- Démocratie avait de plus en plus perdu son caractère de parti révolutionnaire brutal. Ce n’était pas qu’elle eût mentalement adopté un but autre que celui de la révolution ou que ses chefs aient jamais eu d’autres intentions que les siennes : pas du tout !
Mais il ne restait, en fin de compte, que ces intentions et un corps de partisans qui n’était plus apte à passer aux actes.
Avec un parti de dix millions de membres, on ne peut plus faire une révolution.
Dans un mouvement de cette importance, on n’a plus devant soi un parti extrême, mais la grande masse centrale, donc une multitude paresseuse. À ce propos, il faut encore mentionner la scission provoquée par les Juifs dans la Social-Démocratie ; je m’explique : pendant que le parti social-démocrate, en raison de l’inertie paresseuse de sa masse, s’agrippait comme un bloc de plomb à la défense nationale, on sut extraire de ce parti ses éléments radicaux-activistes et on les constitua en colonnes d’assaut qui constituaient des troupes de choc particulièrement redoutables.
Le parti indépendant et l’association spartakiste constituèrent les bataillons d’assaut du marxisme révolutionnaire. Leur mission était de parfaire l’œuvre que la masse du parti social-démocrate, préparée à ce rôle depuis plusieurs dizaines d’années, pouvait dès lors exploiter.
La bourgeoisie couarde fut, à cet égard, appréciée à sa juste valeur par le marxisme et traitée tout
simplement « en canaille ». On ne s’en occupa d’ailleurs pas du tout, sachant que l’obséquiosité rampante de cette formation politique, composée d’une génération vieille et usée, ne serait jamais capable d’opposer une résistance sérieuse.
Puisque la révolution avait réussi et que les appuis principaux de l’ancien État pouvaient être considérés comme réduits à néant, que l’armée du front commençait à surgir comme un sphinx inquiétant, il fallait freiner le développement naturel de la révolution.
Le gros de l’armée social-démocratique occupait la position conquise et les bataillons d’assaut indépendants et spartakistes furent mis de côté.
Cela ne se passa pourtant pas sans combat.
Ce n’est pas seulement parce que les formations d’attaque les plus fébrilement actives se sentaient trompées dans leurs espérances et voulaient continuer à piller autour d’elles, que leur vacarme effréné était redouté par ceux qui tiraient les ficelles de la révolution.
Car à peine le bouleversement était-il accompli qu’il donnait lieu lui-même aussitôt, semble-t-il, à la formation de deux camps, à savoir : le parti du calme et de l’ordre et le groupe de la terreur sanglante. Alors quoi de plus naturel que de voir notre bourgeoisie se rendre avec armes et bagages dans le camp du calme et de l’ordre ? Pour une fois, ces misérables organisations politiques trouvaient une occasion de passer aux actes. Sans éprouver le besoin de le dire et au contraire en silence, il leur était permis de mettre leurs pieds sur un sol résistant et de se solidariser, dans une certaine mesure, avec la puissance qu’ils haïssaient le plus, mais qu’ils redoutaient encore davantage, au fond d’eux- mêmes. La bourgeoisie allemande acquerrait ainsi le grand honneur de s’asseoir à la même table que les chefs marxistes trois fois maudits, pour combattre les bolcheviks !
En décembre 1918 et janvier 1919, la situation se présentait donc déjà comme il suit :
C’est une minorité composée des pires éléments qui a fait la révolution et derrière elle marchaient immédiatement tous les partis marxistes. La révolution elle-même conserve une physionomie modérée, ce qui lui attire l’hostilité des extrémistes fanatiques. Ceux-ci commencent à lancer des grenades à main et à faire crépiter des mitrailleuses, à occuper des monuments publics, bref à menacer la révolution modérée. Pour bannir la crainte que ces menaces font concevoir, un armistice est conclu entre les adeptes du nouvel état de choses et les partisans de l’ancien, afin d’être en mesure de mener désormais en commun le combat contre les extrémistes. Le résultat est le suivant : les ennemis de la république s’organisent pour combattre la République en elle-même, et ils aident à vaincre ceux-là mêmes qui, pour des raisons toutes différentes, sont également des ennemis de cette république.
Un autre résultat, c’est que cette combinaison semble écarter tout danger d’un combat entre les partisans de l’ancien État et ceux du nouveau.
On ne pourra jamais considérer assez souvent, ni avec assez d’attention, ce dernier fait : seul, celui qui l’a saisi, peut comprendre comment il a été possible qu’un peuple, dont les neuf dixièmes n’ont pas fait la révolution, dont les sept dixièmes n’en veulent pas, dont les six dixièmes en ont horreur, ait été, en fin de compte, contraint à la révolution par un dixième de sa population.
Peu à peu les combattants des barricades, spartakistes, d’un côté et, de l’autre, les fanatiques et les idéalistes nationalistes, perdirent tout leur sang ; et, dans la mesure même où ces deux partis extrêmes s’usaient l’un contre l’autre, la masse du centre, comme toujours, restait victorieuse. La bourgeoisie et le marxisme se rencontrèrent sur le terrain des faits acquis et la République commença dès lors à se consolider. Ce qui n’empêcha pas d’ailleurs les partis bourgeois, surtout avant les élections, de revenir pendant quelque temps encore à des idées monarchiques, associant, dans une même conjuration, les esprits de ceux d’autrefois et les faibles lumières de leurs adeptes.
Cela n’était pas honnête, car la bourgeoisie avait au fond d’elle-même rompu depuis longtemps avec la monarchie, et la malpropreté du nouvel état de choses avait déjà commencé à déteindre sur elle et à la rendre sensible à sa corruption. Dans l’ensemble, le politicien bourgeois se sent aujourd’hui plus à son aise dans la boue fétide du parti républicain que sur le roc demeuré propre de la forme d’État passée dont il garde encore le souvenir.
* * *
Comme je l’ai déjà dit, les révolutionnaires furent forcés, après la destruction de l’ancienne armée, de se créer un nouvel instrument de puissance pour consolider leur autorité dans l’État. Vu la situation, ils ne pouvaient le trouver que parmi les partisans d’une conception de vie qui leur était diamétralement opposée. Dans ce milieu seulement pouvait se former, quoique lentement, le corps d’une armée nouvelle qui, limitée extérieurement par les traités de paix, pouvait être au cours du temps transformée moralement pour devenir un instrument de la nouvelle conception de l’État.
Si on pose la question de savoir pourquoi, indépendamment de toutes les erreurs de l’ancien État qui en furent la cause, la révolution put réussir en tant qu’action, on arrive aux réponses suivantes :
1° Parce que nos conceptions du devoir et de l’obéissance s’étaient ankylosées.
2° À cause de la lâche passivité de nos partis soi- disant conservateurs.
Il faut ajouter encore ce qui suit :
L’ankylose de nos notions de devoir et d’obéissance avait sa cause la plus profonde dans notre éducation qui, orientée tout entière dans le sens de l’État, manquait de sens national. Il en résulte une confusion entre les moyens et les buts. La conscience du devoir, l’observation du devoir et l’obéissance ne sont pas des buts en soi, de même que l’État n’est pas un but en soi : ils doivent être seulement des moyens de rendre possible et d’assurer l’existence sur cette terre d’une communauté d’êtres vivants, unis par des affinités morales et physiques. À une heure où un peuple succombe visiblement et est livré, de toute évidence, à l’oppression la plus dure, grâce aux actes de quelques vauriens, l’obéissance et l’observance du devoir envers ces derniers sont preuves d’un formalisme doctrinaire, et même de la folie pure, si, d’autre part, le refus d’obéir et de faire son devoir eussent pu préserver le peuple de la ruine. D’après notre conception bourgeoise actuelle de l’État, le commandant de la division, qui reçut l’ordre d’en haut de ne pas tirer, a agi selon son devoir et, par conséquent, a eu raison de ne point tirer, parce que l’obéissance formelle et aveugle est plus précieuse aux yeux des bourgeois que la vie de leur propre peuple. Mais, selon la conception national- socialiste, ce n’est pas l’obéissance à de faibles supérieurs, c’est l’obéissance envers la communauté qui doit entrer en ligne de compte. À une heure pareille, c’est la responsabilité personnelle devant la nation entière qui devient le devoir.
Si la révolution a réussi, c’est qu’une telle conception vivante de ces notions avait été perdue par notre peuple ou plutôt par nos gouvernements.
En ce qui concerne le second point, on peut faire la remarque suivante :
La cause profonde de la lâcheté des partis « conservateurs » fut, en premier lieu, la disparition des éléments, les meilleurs et les plus actifs de notre peuple, qui tombèrent au front. À part cela, nos partis bourgeois, que nous pouvons désigner comme les seuls qui acceptaient pour base l’ancien État, étaient convaincus qu’ils ne pouvaient défendre leurs opinions que sur le plan de l’esprit et par les armes de l’esprit, parce que l’État, seul, avait le droit d’appliquer la force. Non seulement cette conviction porte le stigmate d’une croissante dégénérescence, mais, en outre, elle est inadmissible à une époque où l’un des adversaires politiques a depuis longtemps abandonné ce point de vue et déclare ouvertement qu’il luttera, autant que possible, pour ces buts politiques, même par la violence. Au moment où le marxisme surgit dans le monde de la démocratie bourgeoise dont il fut la conséquence, ses appels à mener la lutte « seulement par les armes spirituelles » étaient un non-sens qui devait être cruellement expié un jour. Car le marxisme lui-même défendit toujours le point de vue que l’emploi d’une arme était déterminé seulement par des considérations d’opportunité, et que le droit d’y recourir se justifiait par le succès.
Les journées du 7 au 11 novembre prouvèrent à quel point cette conception était juste. À ce moment, le marxisme n’eut aucun souci du parlementarisme, ni de la démocratie ; il leur asséna à tous les deux le coup mortel par des bandes de criminels qui hurlaient et tiraient. Si les organisations de bourgeois bavards restèrent à ce moment impuissantes, cela se conçoit.
Après la révolution, quand les partis bourgeois, quoique sous de nouveaux pavillons, surgirent de nouveau, et quand leurs braves chefs sortirent en rampant de la protection des caves obscures et des greniers bien aérés, ils n’avaient rien oublié et rien appris, comme c’est toujours le cas avec les représentants de vieux organismes. Leur programme politique, c’était le passé, dans la mesure où ils ne s’étaient pas ralliés intérieurement aux nouvelles circonstances, et leur but fut de pouvoir participer autant que possible au nouvel état de choses, et leurs seules armes étaient leur parole.
Les partis bourgeois ont capitulé dans la rue de la façon la plus pitoyable, même après la révolution.
Quand il fut question de la loi sur la défense de la République, elle ne trouva d’abord pas de majorité (L’adoption de cette loi (juillet 1922) nécessitait la majorité de deux tiers. Les populistes ne la votèrent que sous la pression d’une grande manifestation socialiste : les nationalistes votant contre). Mais, à l’aspect de deux cent mille marxistes qui manifestaient, une telle peur s’empara de nos « hommes d’État » bourgeois, qu’ils acceptèrent cette loi contre leur conviction, pris de peur à l’idée que, dans le cas contraire, la masse furieuse pourrait leur casser les reins à la sortie du Reichstag. Ce qui n’eut pas lieu, malheureusement, parce que la loi fut adoptée.
Le nouvel État se développa donc comme s’il n’y avait aucune opposition nationale. Les seules organisations qui eurent à cette époque le courage et la force de s’opposer au marxisme et aux masses soulevées par lui, c’étaient d’abord les corps francs, ensuite les organisations d’auto-protection, les gardes civiques, et enfin les ligues pour les traditions (Freicorps : groupements recrutés dans l’ancienne armée, surtout parmi les officiers et les étudiants. Selbstschutz, Einwohnerwehr : organisations se rapprochant des gardes nationaux de 1848. Traditions verbande : unions de membres d’anciens régiments dissous, etc), formées en majorité d’anciens combattants.
Mais leur existence ne provoqua non plus aucun revirement tant soit peu perceptible dans le développement de l’histoire allemande, et pour les causes suivantes :
De même que les partis dénommés nationaux ne pouvaient exercer aucune influence, parce qu’ils ne possédaient aucune puissance effective dans la rue, les prétendues ligues de protection ne purent exercer aucune influence, parce que toute idée politique leur faisait défaut et surtout tout véritable but politique.
Ce qui avait donné naguère la victoire au marxisme, ce fut la parfaite cohésion entre leur volonté politique et leur brutalité dans l’action. Ce qui priva entièrement l’Allemagne nationale de toute influence sur le développement du sort de l’Allemagne, ce fut l’absence d’une collaboration de la force brutale avec une volonté nationale.
Quelle que fût la volonté des partis « nationaux », ils n’avaient pas la moindre force pour la faire triompher, du moins dans la rue.
Les ligues de défense avaient la force, elles dominaient la rue et l’État, mais elles ne possédaient aucune idée politique ni aucun but politique, pour lesquels leur force aurait pu être engagée, dans l’intérêt de l’Allemagne nationale. Dans les deux cas, c’est l’astuce du Juif qui arriva par une persuasion habile (en renforçant une tendance déjà existante), à faire en sorte que la situation se perpétuât et que le mal s’approfondît.
Ce fut le Juif qui sut lancer par sa presse, avec une habileté infinie, l’idée d’un caractère « non-politique » des ligues de défense, de même qu’il louait dans la lutte politique « les armes pures de l’esprit ». Des millions d’imbéciles allemands discouraient ensuite en adoptant cette ânerie, sans pressentir le moins du monde que, de cette façon, ils se désarmaient en pratique et se livraient sans défense au Juif.
Mais il y a une explication encore plus simple. Le manque de toute grande idée réformatrice a toujours impliqué une limitation de la force combative. La conviction d’avoir le droit d’employer les armes les plus brutales est toujours liée à l’existence d’une foi fanatique en la nécessité de la victoire d’un nouvel ordre de choses révolutionnaire.
Un mouvement qui ne combat pas pour ces buts et ces idéals suprêmes, ne recourra donc jamais aux moyens les plus extrêmes.
La proclamation d’une grande idée est le secret du succès de la Révolution française ; c’est à l’idée que la révolution russe doit sa victoire ; et le fascisme ne reçut sa force que de l’idée de soumettre un peuple, d’une manière bienfaisante, à une réforme des plus vastes.
Les partis bourgeois ne possèdent pas les capacités pour cela.
Mais non seulement les partis bourgeois voyaient leur but politique dans une restauration du passé : les ligues de défense, dans la mesure où elles se préoccupaient de buts politiques, le faisaient aussi. De vieilles tendances d’unions militaires et kyffhauseriennes (Montagne où, selon la légende, Frédéric Barberousse dormait sous le charme d’un enchantement, pour ne se réveiller que pour faire triompher l’idéal pangermaniste. Dans le Kyffhauserbund étaient réunies, déjà avant la guerre, toutes les associations patriotiques d’anciens militaires, d’étudiants, etc) prirent vie dans leur milieu et contribuèrent à émousser, au point de vue politique, l’arme la plus tranchante que l’Allemagne possédait à ce moment, et à la laisser dépérir en servant de lansquenet à la république. Qu’elles le fissent avec les meilleures intentions, et surtout en parfaite bonne foi, cela ne change rien à l’incohérence fatale de leur évolution.
Le marxisme obtint peu à peu dans la Reichswehr consolidée l’appui nécessaire pour son autorité, et il commença alors, avec logique et esprit de suite, à licencier les ligues nationales de défense qui lui paraissaient dangereuses et qui étaient devenues inutiles. Quelques-uns des chefs les plus audacieux, dont on se méfiait, furent cités devant les tribunaux et mis sous les verrous. Tous furent frappés du sort qu’ils avaient mérité par leur erreur.
* * *
Quand le parti national-socialiste fut fondé, ce fut la première fois que fit son apparition un mouvement dont le but n’était pas, comme chez les partis bourgeois, la restauration mécanique du passé, mais d’ériger à la place du mécanisme absurde de l’État actuel un État organique raciste.
Le jeune mouvement, dès son premier jour, adopta le point de vue qu’il fallait propager ses idées par les moyens spirituels, mais que cette propagande devait être étayée, le cas échéant, sur la force brutale.
Fidèle à sa foi en l’énorme importance de la nouvelle doctrine, il considérait comme évident qu’aucun sacrifice ne peut être trop grand en vue du but à atteindre.
J’ai déjà indiqué qu’il y a des moments où un mouvement qui veut conquérir le cœur d’un peuple est obligé de trouver, dans ses propres rangs, la défense contre les tentatives de terreur ennemies. C’est aussi une des leçons éternelles de l’histoire qu’une idée philosophique appuyée par la terreur ne peut jamais être vaincue par des méthodes administratives abstraites, mais seulement par une nouvelle idée philosophique, se traduisant en actions aussi audacieuses que décidées. Ce fait sera toujours désagréable aux protecteurs officiels de l’État, mais c’est un fait indéniable. Les dirigeants peuvent garantir la tranquillité et l’ordre seulement dans le cas où l’État correspond à l’idée philosophique répandue dans le pays, de façon que les éléments de violence puissent être taxés de criminels isolés, au lieu d’être considérés comme les représentants d’une idée diamétralement opposée aux opinions officielles. Si tel est le cas, l’État peut employer pendant des siècles les mesures de répression les plus violentes contre la terreur qui le menace, à la fin il sera impuissant contre elle, et il succombera.
L’État allemand est assailli bien rudement par le marxisme. Dans une lutte qui dure depuis soixante-dix ans, non seulement il n’a pu empêcher le triomphe de cette idéologie, mais il a été forcé de capituler presque sous tous les rapports, en dépit de milliers d’années de bagne et de prison, et des répressions les plus sanglantes dont il frappait les militants de cette idéologie marxiste qui le menaçait. (Les dirigeants d’un État bourgeois essayeront de nier tout cela, mais en vain.)
L’État qui, le 9 novembre 1918, capitula sans conditions devant le marxisme, ne pouvait, du jour au lendemain, s’en rendre maître ; au contraire : les bourgeois idiots, assis dans les fauteuils ministériels, radotent déjà aujourd’hui de la nécessité de ne pas gouverner contre les ouvriers, ce qui signifie pour eux
« contre les marxistes ». En identifiant l’ouvrier allemand avec le marxisme, ils commettent non seulement une falsification, aussi lâche que mensongère, de l’histoire, mais ils s’efforcent de dissimuler ainsi leur propre effondrement devant l’idée et l’organisation marxistes.
En présence de la subordination complète de l’État actuel au marxisme, le mouvement national-socialiste a d’autant plus le devoir, non seulement de préparer par les armes de l’esprit le triomphe de son idée, mais aussi celui d’organiser, sous sa propre responsabilité, la défense contre la terreur de l’Internationale ivre de sa victoire.
J’ai déjà décrit comment, dans la pratique, un service d’ordre fut créé pour nos réunions, et comment il revêtit peu à peu le caractère d’un service de police générale ayant des cadres organisés.
Quoique sa structure qui s’édifiait peu à peu ressemblât beaucoup à ce qu’on nommait les « ligues de défense » nationales, il n’y avait, en réalité, aucune comparaison entre celles-ci et celle-là.
Comme je l’ai dit, les organisations allemandes de défense n’avaient aucune idée politique précise. Elles n’étaient réellement que des ligues de protection particulières, avec une préparation et une organisation appropriées, de sorte qu’elles ne constituaient qu’un complément illégal aux moyens légaux de l’État. Leur caractère de corps francs ne se motivait que par leur constitution et par la situation de l’État à cette époque ; mais leur titre ne leur convenait aucunement, parce qu’elles n’étaient que des organisations privées, ne luttant que pour des convictions particulières. Elles ne remplissaient nullement leur but, en dépit de l’attitude hostile de quelques chefs et même de ligues entières envers la république. Car il ne suffit pas d’être convaincu de l’infériorité d’un état de choses existant pour établir une conviction dans le sens supérieur de ce mot ; celle-ci ne prend racine que dans la prescience intime d’un nouvel état de choses et dans le pressentiment qu’il est nécessaire ; elle ne prend racine que dans la lutte pour l’instauration de ce nouvel état de choses, lutte considérée comme la tâche suprême de la vie.
Ce qui distingue essentiellement le service d’ordre du mouvement national-socialiste de cette période de toutes les ligues de défense, c’est qu’il ne fut ni ne voulut être, même dans la plus faible mesure, le serviteur des conditions créées par la révolution, mais qu’il combattit exclusivement pour une Allemagne nouvelle.
Ce service d’ordre avait, il est vrai, au début le caractère d’un service de protection des salles. Sa première tâche était limitée : il devait assurer la possibilité de tenir des réunions sans que l’adversaire pût les saboter. Il avait d’ores et déjà été créé pour attaquer à fond, non par adoration exclusive de la matraque – comme on le prétendait dans les stupides cénacles des racistes allemands (Les deutsch-völkische furent une organisation qui faisait concurrence aux hitlériens pour la propagande des idées racistes ; elle disparut peu à peu) – mais parce que l’idée la plus élevée peut être étouffée si son protagoniste est assommé d’un coup de matraque. C’est un fait que bien souvent, dans l’histoire, les têtes les plus nobles tombèrent sous les coups des derniers des ilotes. Notre organisation ne considérait pas la violence comme but en soi, mais voulait protéger contre la violence ceux qui poursuivaient des buts idéaux. Et elle comprit en même temps qu’elle n’avait pas à assumer la protection d’un État qui n’accordait aucune protection à la nation, mais qu’elle devait, au contraire, se charger de la défense de la nation contre ceux qui voulaient détruire le peuple et l’État.
Après la bataille de la réunion dans le Hofbrauhaus de Munich, notre service d’ordre reçut, une fois pour toutes, en commémoration constante des attaques héroïques de la petite troupe de naguère, le nom de section d’assaut. Comme ce nom l’indique, il ne désigne qu’une section du mouvement. C’en est un membre, tout comme la propagande, la presse, les institutions scientifiques et les autres membres du même parti.
Nous avons pu voir, non seulement au cours de cette réunion mémorable, mais aussi dans nos tentatives de faire rayonner notre mouvement dans le reste de l’Allemagne, combien cette organisation était nécessaire. Quand le marxisme commença à voir en nous un danger, il ne laissa passer aucune occasion pour étouffer dans l’œuf toute tentative de tenir une réunion national-socialiste, ou, le cas échéant, il chercha à l’empêcher par le sabotage. Il va de soi que, dans toutes ces occasions, les organisations officielles des partis marxistes de toutes nuances couvraient aveuglément toutes ces intentions de sabotage, cela jusque parmi les assemblées élues. Mais que doit-on dire des partis bourgeois, qui, assommés eux-mêmes par le marxisme, n’osaient pas, dans beaucoup de localités, laisser parler en public leurs orateurs, et qui, suivant des yeux cependant tous nos combats contre les marxistes, assistaient à nos quelques échecs avec une satisfaction béate tout à fait incompréhensible. Ils étaient heureux de voir que celui qu’ils n’avaient pu vaincre, celui qui les avait vaincus eux-mêmes, ne pût être brisé par nous non plus. Que penser de ces fonctionnaires, de ces préfets de police, de ces ministres même, qui, avec un manque de caractère tout à fait scandaleux, prenaient extérieurement des attitudes d’hommes « patriotes », mais qui, dans tous les conflits des nationaux-socialistes avec le marxisme, rendaient les services les plus vils à ce dernier ? Que penser d’hommes qui, pour de misérables louanges dans les journaux juifs, tombèrent si bas qu’ils poursuivirent sans crier gare ces mêmes hommes à l’héroïsme desquels ils étaient en partie redevables de ne pas avoir été pendus, quelques années plus tôt, par la meute rouge, et de ne pas avoir été des cadavres déchiquetés, accrochés à une lanterne.
Ce sont là des faits si tristes, qu’ils inspirèrent une fois à feu le préfet Pohner – cet homme inoubliable, qui, dans sa stricte droiture, détestait ces reptiles avec toute la force d’un homme de cœur – cette dure parole : « Toute ma vie, je n’ai voulu être qu’un Allemand, et ensuite un fonctionnaire ; et je ne veux pas qu’on me confonde jamais avec ces créatures, qui, fonctionnaires catins, se prostituent à tout venant, susceptible de passer pour le maître de l’heure. »
Ce qui est surtout triste, c’est que cette engeance soumit non seulement peu à peu des dizaines de milliers de serviteurs les plus honnêtes et les plus loyaux de l’État allemand, mais leur inocula aussi peu à peu son propre manque de principes ; elle poursuivit ensuite les plus honnêtes avec une haine féroce, elle les délogea enfin de leurs postes et fonctions, tout en continuant à se présenter, avec une hypocrisie mensongère, sous l’étiquette de « nationaux ».
Nous n’avions jamais à espérer aucun secours de tels hommes, et nous ne l’avons obtenu en effet que très rarement. Seul, le développement de nos propres services de protection pouvait garantir la sécurité de notre mouvement, et lui attirer en même temps l’attention et l’estime générales qu’on octroie à celui qui se défend lui-même quand on l’attaque.
Notre idée directrice pour l’organisation intérieure de cette section d’assaut, fut toujours d’en faire, outre une troupe de choc parfaite, une force morale inébranlablement pénétrée de l’idéal national-socialiste, et d’y faire régner la discipline la plus stricte. Elle ne devait avoir rien de commun avec une organisation bourgeoise de défense, ou avec une société secrète.
Les raisons pour lesquelles je m’opposai à cette époque de la façon la plus ferme aux tentatives de donner aux sections d’assaut la forme de ligues de défense, sont fondées sur les considérations suivantes :
Au point de vue purement pratique, l’éducation militaire d’un peuple ne peut être faite par des ligues privées, si ce n’est avec d’énormes secours financiers de la part de l’État. Penser autrement eût été surestimer grandement ses propres possibilités. Il est impossible, en appliquant ce qu’on nomme « la discipline volontaire », de dépasser certaines limites dans la formation d’organisations qui possèdent une valeur militaire. L’instrument le plus essentiel du commandement – la faculté de punir – fait ici défaut. Au printemps 1919, il était encore possible de constituer ce qu’on appelle des « corps francs », mais cela pouvait se faire parce qu’ils étaient composés d’anciens combattants, qui, pour la plupart, étaient déjà passés par l’école de l’ancienne armée, mais aussi parce que le genre d’obligations imposées aux hommes impliquait une obéissance militaire inconditionnelle.
Ces prémisses font complètement défaut pour les « ligues de défense » volontaires. Plus la ligue est vaste, plus la discipline est relâchée ; moins on peut exiger de chaque membre, plus l’ensemble prend l’aspect des anciennes associations de militaires et de vétérans. Une préparation volontaire au service militaire, sans pouvoir de commandement inconditionnel, ne pourra jamais être appliquée aux grandes masses. Ceux qui, de leur propre gré, se soumettront à la contrainte de l’obéissance, toute naturelle dans l’armée, seront toujours une minorité. Ensuite, un véritable entraînement ne peut être appliqué à cause de l’insuffisance ridicule des moyens à la disposition des ligues de défense. Le plus solide entraînement aurait dû être la tâche essentielle de telles institutions. Huit ans ont passé depuis la guerre, et, pendant ce temps, pas une classe de notre jeunesse allemande n’a reçu un entraînement régulier. La tâche d’une ligue de défense ne peut être seulement celle d’englober les hommes ayant déjà reçu l’entraînement dans le passé, parce que, dans ce cas, on pourrait mathématiquement établir à quel moment son dernier membre quitterait la ligue. Même le plus jeune soldat de 1918 sera, dans vingt ans, sans valeur militaire, et nous nous approchons de cet état de choses avec une rapidité inquiétante. Tout ce qu’on nomme les ligues de défense acquerra alors inévitablement le caractère des anciennes associations de vétérans. Or, tel ne doit pas être une institution qui se nomme non pas association d’anciens combattants, mais Ligue de défense, et qui s’efforce d’exprimer, par son nom même, qu’elle voit sa mission non seulement dans le maintien des traditions et des liens entre les anciens soldats, mais aussi dans la propagation des idées de défense nationale et dans l’application pratique de ces idées, c’est-à-dire dans la formation d’un corps apte à cette défense.
Mais cette tâche implique alors inévitablement l’entraînement des éléments qui n’ont pas encore reçu de préparation militaire, et cela, dans la pratique, est réellement impossible. On ne peut vraiment créer un soldat avec un entraînement d’une ou de deux heures par semaine. Avec les exigences croissantes, vraiment énormes, que le service militaire impose actuellement au soldat, un service militaire de deux ans est tout juste suffisant pour transformer un jeune homme en un soldat.
Nous avons tous vu au front les conséquences terribles que le manque de préparation au métier militaire avait pour les jeunes recrues. Des formations volontaires, qui avaient été soumises à un entraînement de fer pendant quinze à vingt semaines, et animées de l’esprit de sacrifice le plus élevé, ne représentaient néanmoins au front que de la chair à canon. Seules, les jeunes recrues ayant subi un entraînement de quatre à six mois et encadrées dans les rangs de vieux soldats expérimentés, pouvaient devenir des éléments utiles dans leur régiment ; ils étaient, en cela, guidés par les « anciens » et s’adaptaient peu à peu à leur tâche.
En face de ces faits, combien paraît désespérée la tentative de créer une troupe sans pouvoir de commandement défini, sans moyens suffisants, par un soi-disant entraînement d’une à deux heures par semaine ! On peut, de cette façon, maintenir en forme peut-être d’anciens soldats, mais on ne transformera jamais de la sorte des jeunes gens en soldats.
On peut encore prouver l’inefficacité de ce prétendu entraînement par le fait suivant : lorsqu’une telle ligue de défense volontaire, au prix des plus grands efforts, et avec mille difficultés, essayait d’entraîner militairement quelques milliers d’hommes dévoués (pour les autres, elle n’existe même pas !), l’État brisait par ses directives pacifistes et démocratiques l’élan de millions et de millions de jeunes gens, empoisonnait leur âme patriotique et les transformait peu à peu en un troupeau de moutons supportant patiemment tout arbitraire.
À côté de cela, combien faibles et ridicules paraissent tous les efforts des ligues de défense pour transmettre leurs idées à la jeunesse allemande !
Mais presque plus essentiel encore est le point de vue suivant, qui me fit toujours prendre position contre toute tentative d’une soi-disant préparation militaire sur la base des organisations volontaires :
Même en admettant que, malgré toutes les difficultés indiquées plus haut, une ligue réussisse quand même, au cours des années, à transformer une certaine quantité d’Allemands en hommes entraînés militairement, aussi bien moralement que physiquement et techniquement, le résultat serait encore nul dans un État qui, par toute sa politique, ne désire nullement une telle préparation militaire, qui la déteste même, parce qu’elle est en pleine contradiction avec les buts intimes de ses dirigeants, les destructeurs de la nation.
Dans tous les cas, un tel résultat serait sans valeur avec des gouvernements qui non seulement ont prouvé que la force militaire de la nation n’a aucune valeur à leurs yeux, et qui, surtout, n’ont pas le moindre désir de se servir de cette force, si ce n’est pour la défense de leur propre existence, si funeste. Actuellement, il en est encore ainsi. N’est-il pas ridicule, vraiment, d’entraîner militairement quelques dizaines de milliers d’hommes au crépuscule, alors que l’État, il y a quelques années, abandonna honteusement huit millions et demi de soldats les mieux entraînés ? Alors que non seulement il ne voulut pas s’en servir, mais les livra, en reconnaissance de leurs sacrifices, aux insultes de la populace. On voudrait donc former des soldats pour défendre un régime qui a sali les plus glorieux soldats de jadis, qui a craché sur eux, qui leur a laissé arracher leurs croix et leurs insignes, qui leur a enlevé leurs cocardes, a piétiné leurs drapeaux et dénigré leurs exploits ? Est-ce que le régime actuel a fait un seul pas pour restaurer l’honneur de l’ancienne armée, pour traduire en justice ses destructeurs et ses détracteurs ? Pas le moindre ! Au contraire : nous les voyons trôner dans les plus hautes charges de l’État. N’a-t-on pas dit à Leipzig : « Le droit suit la force à la remorque. » Mais comme la force, aujourd’hui, dans notre république, est entre les mains des mêmes hommes qui ont attisé la révolution, comme cette révolution est la trahison la plus lâche, l’ignominie la plus basse dans toute l’histoire de l’Allemagne, on ne peut, vraiment, trouver aucune raison d’augmenter précisément la puissance de ces individus-là en créant une jeune armée nouvelle. Tous les arguments de la raison s’y opposent.
Le cas que faisait cet État, après la révolution de 1918, d’un renforcement de sa position au point de vue militaire, est clairement et ostensiblement démontré par son attitude envers les grandes organisations d’auto- protection existantes à cette époque. Aussi longtemps qu’elles avaient à assumer la protection des créatures révolutionnaires si lâches, elles n’étaient pas indésirables. Mais dans la mesure où, grâce à l’avachissement croissant de notre peuple, le danger pour ces créatures paraissait s’évanouir, et l’existence des ligues signifiait alors un renforcement au point de vue national, on les considéra comme superflues, on fit tout pour les désarmer, et même, autant que c’était possible, pour les dissoudre.
L’histoire ne connaît que de rares exemples de la gratitude des souverains. Mais, seul, un patriote néobourgeois pouvait espérer compter sur la gratitude d’incendiaires et d’assassins révolutionnaires, de ces hommes qui se sont enrichis en spoliant le peuple, de ces traîtres à la nation. En étudiant la question de savoir s’il fallait créer des ligues de défense volontaires, je me demandais : pour qui vais-je entraîner ces jeunes gens ? À quels buts seront-ils employés et quand seront-ils appelés ? La réponse à ces questions donnait en même temps les meilleures directives pour notre propre conduite.
Si l’État actuel doit jamais faire appel à ces formations entraînées, il ne le fera pas pour défendre les intérêts nationaux à l’extérieur, mais seulement pour la défense des oppresseurs de la nation, malgré la fureur générale du peuple trompé, trahi et vendu, qui éclatera peut-être un jour.
Nos sections d’assaut ne devaient donc, pour cette seule raison, avoir rien de commun avec une organisation militaire. C’était un instrument de protection et de propagande du mouvement national- socialiste, et ses tâches étaient d’un tout autre ordre que celui des organisations nommées ligues de défense.
Mais ce ne devait pas être non plus une association secrète. Le but d’organisations secrètes ne peut être qu’illégal. Cela limite le cadre d’une telle organisation. Il n’est pas possible, surtout quand on connaît le penchant au bavardage du peuple allemand, de créer une organisation tant soit peu considérable et en même temps de garder le secret ou même de voiler ses buts. De telles intentions ont déjà été déjouées mille fois. Non seulement nos institutions policières ont aujourd’hui à leur disposition tout un état-major de souteneurs et d’autres canailles, qui trahissent pour les trente deniers de Judas et qui inventeraient plutôt des trahisons imaginaires. Jamais on ne peut obtenir de ces propres partisans le silence nécessaire en pareil cas. Seuls, de tout petits groupements, après des années de filtrage, pourraient acquérir le caractère de véritables organisations secrètes. Mais l’exiguïté même de pareilles formations leur enlèverait toute valeur pour le mouvement national-socialiste. Ce dont nous avions besoin, ce n’étaient pas de cent ou deux cents conspirateurs audacieux, mais de centaines de milliers de militants fanatiques épris de notre idéal. Il fallait travailler non pas dans des conciliabules secrets, mais par de puissantes démonstrations de masses, et ce n’était point par le poignard ou le poison ou le revolver que le mouvement pouvait vaincre, c’était seulement par la conquête de la rue. Nous devions faire comprendre au marxisme que le national-socialisme était le maître futur de la rue, et qu’il serait un jour le maître de l’État.
Le danger des organisations secrètes est encore actuellement dans le fait que leurs membres perdent souvent toute notion de la grandeur de leur tâche, et qu’ils croient que le sort d’un peuple peut être décidé par un meurtre. Une telle opinion peut avoir sa raison d’être historique, dans le cas où le peuple pâtit sous la tyrannie de quelque oppresseur de génie, dont on sait que, seule, la personnalité extraordinaire garantit la solidité intérieure et le caractère terrifiant de cette oppression. Dans un tel cas, un homme prêt au sacrifice peut surgir des rangs du peuple pour plonger le fer dans le sein de l’homme détesté. Et seulement l’esprit républicain de petits lâches peut voir dans cet acte un motif de réprobation. N’oublions pas que Schiller, le plus grand pionnier de la liberté de notre peuple, a osé, dans son Guillaume Tell, glorifier un tel meurtre.
Dans les années 1919 et 1920 existait le danger que les associations secrètes, entraînées par les grands exemples de l’histoire et heurtées par les calamités sans bornes de la patrie, essayassent de se venger sur les fauteurs des malheurs de la patrie, pensant mettre fin de cette façon à la détresse du peuple. Toute tentative pareille eût été un non-sens, parce que le marxisme avait triomphé non pas grâce au génie supérieur d’un chef quelconque, mais à cause de la faiblesse pitoyable et sans bornes, à cause du lâche renoncement du monde bourgeois. Le reproche le plus cruel qu’on puisse faire à notre bourgeoisie, c’est de constater que la révolution n’a pas mis en vedette le moindre cerveau, mais qu’elle l’a soumise quand même. On peut encore comprendre qu’on puisse capituler devant un Robespierre, un Danton, un Marat, mais il est scandaleux de s’être mis à quatre pattes devant le grêle Scheidemann ou le gros Erzberger, ou un Friedrich Ebert, et tous les autres innombrables nains politiques. Il n’y eut vraiment pas une tête dans laquelle on aurait pu voir l’homme de génie de la révolution. Dans le malheur de la patrie, il n’y avait que des punaises révolutionnaires, des spartakistes de pacotille en gros et en détail. Cela n’aurait eu aucune importance si on en avait supprimé un ; le seul résultat aurait été qu’une poignée d’autres sangsues, aussi nulles et aussi avides, auraient pris sa place.
La protestation la plus énergique n’était pas de trop pour combattre cette conception, qui avait eu sa raison d’être dans de grands événements historiques, mais qui ne convenait nullement à notre époque actuelle de nains.
Les mêmes considérations sont valables pour le cas de suppression de ceux qu’on appelle les traîtres au pays. C’est un illogisme ridicule de fusiller un individu qui a dénoncé à l’ennemi la présence d’un canon, tandis que, dans les postes les plus élevés du gouvernement, se trouvent des canailles qui ont vendu tout un empire, qui ont sur leur conscience le vain sacrifice de deux millions de morts, qui portent la responsabilité de millions d’invalides, et qui font en pleine tranquillité d’âme leurs « affaires » républicaines. C’est un non- sens que de punir les petits traîtres dans un État où le gouvernement innocente les grands traîtres. Car il pourrait arriver un jour qu’un idéaliste honnête, ayant, pour servir son peuple, supprimé un vaurien qui a trahi aux armées, soit traîné en justice devant un jury de grands traîtres. Alors, doit-on faire supprimer un traître par un autre traître ? Ou par un idéaliste ? Dans le premier cas, le succès est douteux, et la trahison, pour l’avenir, est assurée ; dans l’autre cas, un petit vaurien est éliminé, et la vie d’un idéaliste, peut-être irremplaçable, est menacée.
Du reste, mon attitude dans cette question est la suivante : on ne doit pas pendre les petits voleurs quand les grands restent libres et impunis ; un jour, un tribunal national allemand aura à juger et à faire exécuter quelques dizaines de milliers d’organisateurs responsables de la trahison de novembre et de tout ce qui s’y rapporte. Un pareil exemple servira aussi au petit traître d’armes (Ceux qui dénonçaient les dépôts d’armes clandestins aux autorités interalliées après la guerre), une fois pour toutes, de leçon salutaire.
Toutes ces considérations m’ont amené à interdire, à plusieurs reprises, toute participation aux associations secrètes, et à empêcher les sections d’assaut de prendre le caractère de ces associations. J’ai tenu, dans ces années, le mouvement national-socialiste à l’écart d’expériences dont les exécuteurs ont été pour la plupart d’admirables jeunes Allemands idéalistes ; mais leurs actes n’ont abouti qu’à leur propre sacrifice, sans qu’ils aient pu améliorer dans la moindre mesure le sort de la patrie.
* * *
Si la S. A. ne devait être ni une organisation de défense militaire, ni une association secrète, il fallait tirer de cela les conséquences suivantes.
1° Leur entraînement devait avoir lieu non pas sous l’angle de leur utilité militaire, mais sous celui de leur conformité aux intérêts du parti.
Dans la mesure où leurs membres devaient se perfectionner au point de vue physique, le centre de gravité ne devait pas être dans les exercices militaires, mais plutôt dans la pratique des sports. La boxe et le jiu-jitsu m’ont toujours paru plus essentiels qu’un entraînement au tir, qui ne pouvait qu’être mauvais, parce qu’incomplet. Qu’on donne à la nation allemande six millions de corps parfaitement entraînés au point de vue sportif, brûlants d’un amour fanatique pour la patrie et élevés dans un esprit offensif le plus intense ; un État national en saura faire, en cas de besoin, une armée en moins de deux ans, si toutefois il y a des cadres. Ceux- ci sont constitués dans les circonstances actuelles par la Reichswehr, et non par une ligue de défense empêtrée dans des demi-mesures. Le perfectionnement physique doit inoculer à chacun la conviction de sa supériorité et lui donner cette assurance qui réside toujours dans la conscience de sa propre force ; elle doit aussi leur donner les qualités sportives qui peuvent servir d’armes pour la défense du mouvement.
2° Pour empêcher dès l’abord que la S. A. revête un caractère secret, il faut que, indépendamment de son uniforme auquel tous peuvent immédiatement la reconnaître, ses effectifs, par leur nombre même, soient utiles pour le mouvement et connus de tous. Elle ne doit pas siéger en secret ; elle doit marcher à ciel découvert et se consacrer à une activité qui dissipe définitivement toutes les légendes sur son « organisation secrète ». Pour préserver aussi son esprit de toutes les tentations de nourrir son activité par de petites conspirations, on devait, dès le début, l’initier complètement à la grande idée du mouvement et l’entraîner si entièrement à la tâche de la défense de cette idée, que son horizon s’élargirait aussitôt et que chacun de ses membres ne verrait plus sa mission dans l’élimination de tel filou plus ou moins grand, mais le don total de soi en vue de l’édification d’un nouvel État national-socialiste et raciste. De cette façon, la lutte contre l’État actuel était élevée au-dessus de l’atmosphère de petits actes de vengeance et d’activités de conspirateurs ; elle parvenait au niveau d’une guerre de destruction pour une conception de vie idéale contre le marxisme et ses formations.
3° Les formes de l’organisation de la S. A., ainsi que son uniforme et son équipement, ne devaient pas suivre les modèles de l’ancienne armée ; elles devaient se conformer aux besoins de la tâche qui lui incombait.
Ces idées qui me servaient de directives déjà dans les années 1920 et 1921, et que je m’efforçai d’inoculer peu à peu à la jeune organisation, eurent pour résultat le fait que, dès la fin de l’été 1922, nous possédions un nombre appréciable de centuries, qui reçurent, en automne 1922, l’habillement qui les distinguait. Trois événements eurent une importance infinie pour le développement ultérieur de la S. A.
1° La grande démonstration de toutes les associations patriotiques contre la loi de défense de la république sur le Königsplatz à Munich.
Les associations patriotiques de Munich avaient alors lancé l’appel de se réunir pour une manifestation gigantesque, à Munich, pour protester contre l’introduction de la loi de défense de la république. Le mouvement national-socialiste devait y participer aussi. Le défilé du parti, en rangs serrés, s’ouvrit par les six centuries de Munich, suivies par les sections politiques du parti. Deux orchestres prirent part au défilé, et on portait près de quinze drapeaux. L’arrivée des nationaux-socialistes sur la vaste place, déjà remplie à moitié, déchaîna un enthousiasme sans bornes. Moi- même, j’eus l’honneur de prendre la parole devant une foule comptant soixante mille hommes.
Le succès de cette manifestation fut foudroyant, surtout parce qu’il fut prouvé pour la première fois, en dépit de toutes les menaces des rouges, que le Munich national pouvait aussi marcher dans la rue. Les membres des associations de protection rouge républicaine, qui essayèrent d’agir par la terreur contre les colonnes en marche, furent dispersés, la tête ensanglantée, en quelques minutes par les centuries des
S. A. Le mouvement national-socialiste a montré alors, pour la première fois, qu’il était décidé à l’avenir à prétendre défiler dans la rue et à arracher ainsi ce monopole des mains des traîtres internationaux et des ennemis de la patrie.
Le résultat de cette journée fut une preuve incontestable de ce que nos conceptions sur la structure de la S. A. étaient bonnes, tant au point de vue psychologique qu’au point de vue de l’organisation.
Elle fut donc élargie énergiquement sur les bases qui lui avaient apporté le succès, et, peu de semaines plus tard, nous avions mis sur pied une quantité double de centuries.
2° L’expédition à Cobourg en octobre 1922.
Les ligues « racistes » avaient l’intention d’organiser, à Cobourg, ce qu’elles nommaient un
« Congrès allemand ». Je reçus aussi une invitation à ce Congrès, avec la prière d’amener quelques hommes. Cette invitation, que je reçus à 11 heures, m’arrivait juste à point. Une heure après, les dispositions pour la participation à ce Congrès allemand étaient déjà prises. Pour m’accompagner, je désignai huit cents hommes de la S. A., qui, divisés en quatorze centuries, devaient être transportés de Munich, par un train spécial, à Cobourg, devenue bavaroise (Cobourg, avec son canton, qui faisait partie de l’ex-duché de Saxe- Cobourg-Gotha, venait de décider, par voie de plébiscite, son rattachement avec la Bavière). Des ordres correspondants furent donnés aux autres groupements de S. A. national- socialistes, qui s’étaient formés entre temps dans d’autres localités. C’était la première fois qu’un tel train spécial traversait l’Allemagne. Dans toutes les localités où de nouveaux membres de la S. A. montèrent, notre voyage produisait une sensation énorme. Beaucoup de gens n’avaient encore jamais vu nos drapeaux ; l’impression qu’ils produisirent fut grande.
Quand nous arrivâmes en gare de Cobourg, nous fûmes reçus par une délégation du comité des fêtes du Congrès, qui nous transmit un ordre, intitulé « compromis », des syndicats locaux, ainsi que du parti socialiste indépendant et du parti communiste, qui stipulait que nous ne devions pas entrer dans la ville ni drapeaux déployés, ni musique en tête (nous avions amené avec nous notre orchestre de quarante-deux hommes), ni en colonne serrée.
Je rejetai séance tenante ces humiliantes conditions, et je ne manquai pas de faire entendre à messieurs les dirigeants de cette manifestation que le fait d’avoir engagé des pourparlers et d’avoir conclu des compromis avec la municipalité socialiste me paraissait surprenant ; et je déclarai que les centuries de la S. A. allaient aussitôt se mettre en rangs et marcher dans la ville, avec leur fanfare et drapeaux déployés.
Et c’est ce qu’on fit.
Sur la place de la gare une foule hurlante et ricanante de milliers d’hommes nous reçut. « Assassins ! », « Bandits ! », « Criminels ! », tels furent les jolis petits noms que nous jetaient aimablement à la tête ces fondateurs exemplaires de la république allemande. La jeune S. A. garda une tenue exemplaire, les centuries se formèrent sur la place de la gare, ne prêtant d’abord aucune attention aux injures de la populace. Des organes policiers apeurés pilotèrent d’abord notre marche par cette ville, inconnue de nous tous, non pas, comme il était convenu, vers nos quartiers mais vers la salle du Hofbrauhaus, située près du centre de la ville. À gauche et à droite de notre procession, le tumulte des masses populaires qui nous suivaient augmentait toujours. À peine la dernière centurie était-elle entrée dans la cour de la salle qu’une foule compacte, avec des cris assourdissants, essaya d’y pénétrer à notre suite. Pour les en empêcher, la police fit fermer la salle. Comme cette situation était intenable, je mis la S. A. de nouveau au garde-à-vous, je lui fis une courte allocution et j’exigeai de la police l’ouverture immédiate des portes. Après une longue hésitation, ils consentirent à le faire.
Nous marchâmes donc de nouveau par le même chemin, mais en sens contraire, pour arriver à nos quartiers, et cette fois il fallut réellement faire front. Comme les cris et les exclamations insultantes ne pouvaient faire perdre leur sang-froid à nos centuries, ces représentants du vrai socialisme, de l’égalité et de la fraternité, eurent recours aux pierres. Alors notre patience fut à bout et des coups tombèrent comme grêle à droite et à gauche ; un quart d’heure plus tard, plus rien de rouge n’osait montrer le bout du nez dans les rues.
La nuit, il y eut encore de dures rencontres. Des patrouilles de la S. A. avaient trouvé des nationaux- socialistes, assaillis isolément, dans un état atroce. Alors, on régla leur compte aux adversaires. Dès le lendemain matin, la terreur rouge dont Cobourg avait souffert pendant des années était brisée.
Avec l’hypocrisie typique des marxistes-juifs, on essaya encore, par des proclamations, de lancer une fois de plus les « camarades du prolétariat international » dans la rue, en affirmant, en falsifiant les faits, que nos « bandes d’assassins » avaient commencé à Cobourg « une guerre exterminatrice contre les ouvriers pacifiques ». À une heure et demie, une grande « démonstration populaire » devait avoir lieu, et on y avait convié des dizaines de milliers d’ouvriers de la région. Fermement décidé à liquider définitivement la terreur rouge, j’ordonnai, à midi, à la S. A., qui comptait quinze cents hommes, de former une colonne, et je me mis avec elle en marche vers la citadelle de Cobourg, en passant par la grande place où la démonstration hostile devait avoir lieu. Je voulais voir s’ils oseraient encore nous molester. Quand nous pénétrâmes sur la place, il n’y avait, au lieu des dix mille hommes annoncés, que quelques centaines de pauvres bougres qui se tinrent cois à notre approche ou prirent la fuite.
En quelques endroits seulement, des détachements rouges qui étaient venus du dehors et qui ne nous connaissaient pas encore, essayèrent de nouveau de s’en prendre à nous ; mais, en un tournemain, on leur fit radicalement passer toute envie de le faire. Et alors on put voir comme la population, intimidée jusqu’à ce moment, se réveilla peu à peu, prit courage, osa nous acclamer et, dans la soirée, à notre départ, éclata en beaucoup d’endroits en acclamations joyeuses.
Tout à coup, le personnel du chemin de fer nous déclara à la gare qu’il ne conduirait pas notre train. Je fis alors savoir à plusieurs des meneurs rouges que, dans ce cas, je comptais mettre la main sur autant de bonzes rouges que j’en pourrais attraper, et que nous conduirions notre train nous-mêmes, en prenant avec nous sur la locomotive, le tender et dans chaque voiture, quelques représentants de la solidarité internationale. Je ne manquai pas d’attirer l’attention de ces messieurs sur le fait qu’un voyage entrepris avec nos propres moyens serait, certes, une aventure infiniment risquée et que nous nous casserions tous peut-être le cou. Mais nous pourrions alors, en tout cas, nous réjouir de ce que nous n’irions pas faire ce plongeon dans l’au-delà tout seuls, mais en pleine égalité et fraternité avec les messieurs rouges.
Sur ce, le train partit exactement à l’heure, et nous arrivâmes de nouveau sains et saufs à Munich le lendemain matin.
À Cobourg, la première fois depuis l’année 1914, fut ainsi rétablie l’égalité des citoyens devant la loi. Car si, aujourd’hui, quelque fat de fonctionnaire supérieur prétend affirmer que c’est l’État qui protège la vie de ses citoyens, ce n’était alors vraiment pas le cas ; car les citoyens devaient être protégés contre les représentants mêmes de l’État.
L’importance de cette journée ne put être tout de suite appréciée dans toutes ses conséquences. Mais les hommes de la S. A. victorieuse sentirent croître leur foi en eux-mêmes et en la sagacité de leurs chefs.
Le monde environnant commença à s’occuper de nous, et nombreux furent ceux qui reconnurent, pour la première fois, dans le mouvement national-socialiste, l’institution qui devait, selon toute probabilité, préparer au marxisme une fin digne de lui.
Seule, la démocratie gémit qu’on pût oser ne pas se laisser paisiblement bourrer le crâne, et que nous ayons assumé, dans une république démocratique, le droit de repousser une attaque brutale par nos poings et nos cannes, au lieu d’y répondre par des incantations pacifistes.
La presse bourgeoise, en général, fut piteuse, ou lâche comme toujours, et seuls quelques journaux sincères se réjouirent qu’au moins à Cobourg, on eût su donner enfin sur les doigts aux bandits marxistes.
À Cobourg même, du moins une partie des ouvriers marxistes, celle que nous considérions comme égarée, avait appris, par l’enseignement des poings des ouvriers nationaux-socialistes, que ces ouvriers aussi luttaient pour des idéaux, car on sait par l’expérience qu’on ne se bat que pour ce qu’on croit et ce qu’on aime.
La S. A., elle-même, en retira le plus grand profit.
Elle crût si rapidement qu’au congrès du parti, le 27 janvier 1923, déjà près de 6000 hommes purent participer à la consécration du drapeau ; à cette occasion, les premières centuries parurent entièrement habillées de leur uniforme nouveau.
L’expérience de Cobourg avait démontré à quel point il était essentiel d’introduire une tenue uniforme pour la S. A., non seulement pour fortifier l’esprit de corps, mais aussi pour éviter des confusions et comme signe de reconnaissance. Jusqu’à présent, ils ne portaient que des brassards ; maintenant s’y ajoutèrent la vareuse et la casquette bien connues.
L’expérience de Cobourg eut encore cette importante conséquence : nous commençâmes à briser méthodiquement la terreur rouge dans toutes les localités où celle-ci avait, depuis des années, empêché toute réunion d’autres partis, et à rétablir la liberté de réunions. À partir de ce moment, nous avons concentré nos bataillons nationaux-socialistes dans de telles localités, et peu à peu les citadelles rouges de la Bavière tombèrent l’une après l’autre devant la propagande nationale-socialiste. La S. A. s’est toujours de plus en plus adaptée à sa tâche, elle s’est éloignée de plus en plus du type d’un mouvement de défense sans but et sans importance vitale, et elle se haussa jusqu’au rôle d’une organisation vivante de combat pour la création d’un nouvel État allemand.
Le développement logique se poursuivit jusqu’au mois de mars 1923. À ce moment se produisit un événement qui me força de faire dévier le mouvement de la voie établie, et de l’amener à une transformation.
3° L’occupation du territoire de la Ruhr par les Français, dans les premiers mois de l’année 1923, eut une grande importance pour le développement de la S. A.
Il n’est pas encore possible aujourd’hui, et cela ne correspond surtout pas à l’intérêt national, de parler ou d’écrire là-dessus en pleine liberté. Je ne puis en parler que dans la mesure où ce sujet a déjà été abordé dans des discussions publiques, et où il a été ainsi porté à la connaissance de tous.
L’occupation de la Ruhr, qui ne fut point une surprise pour nous, fit naître l’espoir bien fondé que, maintenant, on allait rompre avec la politique lâche des reculades et qu’on devait assigner aux lignes de défense une tâche parfaitement définie. La S. A. aussi, qui comptait alors dans ses rangs plusieurs milliers d’hommes jeunes et pleins de force, ne pouvait se refuser à prendre part à ce service national. Au printemps et au cours de l’été de l’année 1923, s’accomplit sa transformation en une organisation militaire de combat. C’est à cette réorganisation qu’il faut attribuer, en grande partie, le développement ultérieur des événements de l’année 1923 en ce qui concerne notre mouvement.
Comme je traite autre part, dans leurs grandes lignes, les événements de l’année 1923, je veux seulement établir que la transformation de la S. A. de cette époque devait être nuisible pour le mouvement, si les conditions qui motivaient cette réorganisation, c’est- à-dire la reprise d’une résistance active contre la France, ne se trouvaient pas remplies.
La conclusion de l’année 1923, si terrible que cela puisse paraître à première vue, fut presque nécessaire en se plaçant à un point de vue supérieur, parce qu’elle a empêché la transformation définitive de la S. A., rendue inutile par l’attitude du gouvernement allemand et nuisible pour le mouvement lui-même ; aussi reprit- on la marche dans la même voie dont on s’était écarté.
Le parti, réorganisé en 1925, doit reconstruire sa S. A. suivant les principes indiqués au début. Il doit retourner aux saintes conceptions initiales et il doit considérer de nouveau, comme sa tâche la plus essentielle, de créer dans sa S. A. un instrument pour la représentation et le renforcement de la lutte pour l’idéal du mouvement.
Il ne doit pas tolérer que la S. A. se rabaisse au rôle d’une ligue de défense ou d’une association secrète ; il doit, au contraire, s’efforcer de créer en elle une garde de cent mille hommes pour l’idéal national-socialiste et raciste.
Chapitre 10 – Le fédéralisme n’est qu’un masque
Pendant l’hiver de 1919, et plus encore au printemps et pendant l’été de 1920, le jeune parti fut forcé de prendre position sur une question qui avait déjà eu, pendant la guerre, une extraordinaire importance. Dans la première partie de ce livre, lorsque je décrivais brièvement les symptômes que j’avais personnellement constatés et qui annonçaient l’effondrement dont l’Allemagne était menacée, j’ai fait allusion au genre de propagande usitée par les Anglais, et aussi par les Français, pour agrandir l’ancien fossé qui séparait le Nord du Sud de l’Allemagne. Au printemps de 1915 avaient paru les premiers pamphlets dirigés systématiquement contre la Prusse qu’ils rendaient seule responsable de la guerre. En 1916, cette campagne avait reçu sa forme définitive, aussi adroite que méprisable. Faisant appel aux plus bas instincts, elle tendait à ameuter les Allemands du sud contre ceux du nord et elle avait commencé à porter des fruits. On a le droit de reprocher aux autorités supérieures d’alors,
aussi bien dans le gouvernement que dans la direction de l’armée – ou, pour mieux dire, aux chefs de l’armée bavaroise – et c’est une inculpation dont ils ne pourront jamais se laver, de n’être pas intervenus avec la résolution nécessaire pour faire cesser cette campagne ; mais Dieu les aveuglait et leur faisait oublier leur devoir. On ne fit rien ! Au contraire, il semblait qu’en différents endroits, on la voyait d’un assez bon œil ; on était peut-être assez borné pour se figurer que non seulement une pareille propagande barrerait la route à l’évolution qui conduisait le peuple allemand à l’unité, mais aussi qu’elle renforcerait automatiquement les tendances fédératives. Mais rarement, dans l’histoire, une négligence aussi perfide a été plus cruellement punie. L’insulte qu’on voulait faire à la Prusse a atteint toute l’Allemagne. Elle eut pour conséquence de hâter l’effondrement qui ne mit pas seulement l’Allemagne en pièces, mais tout d’abord les États allemands eux- mêmes.
Ce fut dans la ville de Munich où la haine artificiellement attisée contre la Prusse s’était déchaînée avec le plus de rage qu’éclata d’abord un soulèvement contre la maison royale héréditaire.
Il serait d’ailleurs faux de croire que la propagande ennemie pendant la guerre ait seule pu fabriquer de toutes pièces ce mouvement d’opinion hostile à la Prusse et qu’il n’y ait pas des excuses à la décharge du peuple qui tomba dans son piège. La façon incroyable dont fut organisée l’économie publique pendant la guerre, la centralisation vraiment insensée qui mettait en tutelle toute l’étendue du Reich et l’exploitait comme un escroc fait de ses dupes, telles sont les principales causes qui ont contribué à la naissance de cette tournure d’esprit antiprussienne.
Car, pour l’homme du peuple du type courant, les offices de guerre, qui avaient, notez-le bien, leur direction à Berlin, étaient Berlin même ; et Berlin, c’était la Prusse.
Que cette entreprise de rapines, connue sous le nom d’offices de guerre, eût été organisée par des gens qui n’étaient ni des Berlinois, ni des Prussiens, ni parfois même des Allemands, l’homme du peuple s’en doutait à peine alors. Il ne voyait que les fautes grossières et les empiétements continuels de cette odieuse organisation fonctionnant dans la capitale du Reich et faisait naturellement retomber toute sa haine en même temps sur la capitale et sur la Prusse ; cela d’autant plus que d’un certain côté (le gouvernement bavarois), non seulement on ne faisait rien pour réfuter cette interprétation des faits, mais qu’on l’accueillait in petto avec un sourire complaisant.
Le Juif était trop malin pour ne pas comprendre dès alors que l’infâme campagne de pillages que, sous le couvert des offices de guerre, il avait organisée aux dépens du peuple allemand, finirait, et devait fatalement finir, par provoquer des résistances. Tant qu’elles ne lui sauteraient pas à la gorge, il n’avait pas à les craindre. Mais, pour empêcher que l’explosion du désespoir et de l’indignation des masses ne vienne à l’atteindre, il n’y avait pas de meilleure recette que de diriger vers un autre côté les éclats de leur fureur et de l’épuiser ainsi.
Que la Bavière se contente de se quereller avec la Prusse et la Prusse avec la Bavière, à merveille ! Et plus la querelle serait violente, mieux cela vaudrait pour lui ! Si les deux pays se combattaient avec acharnement, la paix du Juif n’en serait que mieux assurée. L’attention générale fut ainsi complètement détournée de ce maquignonnage international ; on sembla l’avoir absolument oublié. Lorsque le danger que présentaient ces querelles commença à devenir évident et quand les hommes réfléchis, qui étaient nombreux en Bavière même, conseillèrent d’ouvrir les yeux, de rentrer en soi- même et de montrer plus de modération, de sorte que cette lutte acharnée menaçait de s’apaiser, le Juif n’eut qu’à mettre en jeu une autre provocation et à en attendre le succès. Immédiatement, tous ceux qui tiraient profit de la lutte mettant aux prises le Nord et le Sud se jetaient sur l’incident et soufflaient sur le feu jusqu’à ce que l’indignation qui couvait encore eût recommencé à jeter des flammes.
Ce fut une manœuvre habile et raffinée qu’employa le Juif à ce moment pour occuper les différents peuples allemands et détourner leur attention, afin de pouvoir entre temps les dépouiller plus complètement.
Puis vint la révolution.
Si l’homme de la foule, et particulièrement le petit bourgeois et l’ouvrier peu cultivés, avaient pu, jusqu’en 1918, ou plutôt jusqu’au mois de novembre de cette année-là, ne pas se rendre exactement compte de ce qui se passait réellement et des conséquences que devaient fatalement avoir les querelles qui divisaient les éléments ethniques allemands, surtout en Bavière, la partie du peuple allemand qui se disait « nationale » aurait au moins dû le comprendre le jour où éclata la révolution. Car, à peine le mouvement eut-il réussi, que le chef et l’organisateur de la révolution en Bavière se fit le représentant des intérêts bavarois ! Le Juif internationaliste Kurt Eisner commença à jouer contre la Prusse l’atout de la Bavière. Il était pourtant évident que, tout compte fait, cet Oriental, dont toute l’existence s’était passée à vagabonder comme barbouilleur de journaux à travers le reste de l’Allemagne, était le dernier qui fût qualifié pour défendre les intérêts de la Bavière, et qu’il lui était des plus indifférent que précisément une Bavière continuât à exister dans le vaste monde créé par Dieu.
En donnant au soulèvement révolutionnaire en Bavière le caractère d’une offensive contre le reste du Reich, Kurt Eisner ne se plaçait pas le moins du monde au point de vue des intérêts ou des désirs de la Bavière ; il agissait en mandataire de la juiverie. Il tirait parti des tendances instinctives et des antipathies du peuple bavarois pour mettre plus facilement l’Allemagne en pièces avec leur aide. Le Reich démantelé serait devenu tout uniment la proie du bolchévisme.
Après sa mort, on continua d’abord à employer la tactique dont il avait usé. Le marxisme, qui avait couvert des insultes les plus sanglantes les États allemands et leurs souverains, fit subitement, sous le nom de « Parti indépendant » (Die Unabhangige Sozialistische Partei était cette fraction du parti social-démocrate qui s’était séparée de la majorité des députés socialistes, dans les derniers mois des hostilités, en refusant de continuer à voter les crédits pour la guerre. Depuis, les brebis égarées étaient rentrées au bercail), appel précisément aux sentiments et aux instincts qui avaient leurs racines dans l’existence des dynasties et des États allemands.
Le combat mené par la république des conseils (des ouvriers et soldats) contre les troupes qui venaient d’en délivrer la Bavière, fut représenté par la propagande comme le « combat des ouvriers bavarois » contre le « militarisme prussien ». C’est ce qui explique pourquoi l’écrasement de la république des conseils n’eut pas à Munich l’effet qu’il produisit dans les autres pays allemands : au lieu de rappeler les masses à la raison, il aigrit et irrita encore davantage les Bavarois contre la Prusse.
L’art avec lequel les agitateurs bolchévistes firent de la suppression de la république des conseils une victoire du « militarisme prussien » sur le peuple bavarois « antimilitariste » et « antiprussien », porta abondamment ses fruits. Alors que Kurt Eisner avait, à l’occasion des élections au Landtag constituant de Bavière, récolté à Munich moins de dix mille partisans et que le parti communiste était même resté au-dessous de trois mille voix, les voix données aux deux partis après la chute de la république s’élevèrent à près de cent mille.
C’est dès cette époque que j’engageai personnellement le combat contre ces excitations insensées qui dressaient les éléments ethniques allemands les uns contre les autres.
Je crois que, de toute ma vie, je n’ai pas entrepris de campagne plus impopulaire que celle par laquelle je protestais contre l’hostilité témoignée aux Prussiens. Déjà, pendant le règne des conseils, de grandes réunions populaires s’étaient tenues à Munich où la haine du reste de l’Allemagne, mais particulièrement de la Prusse, était prêchée avec tant de succès que non seulement un Allemand du nord risquait sa vie à y assister, mais que la clôture de ces manifestations était accompagnée, la plupart du temps, de cris insensés comme : « Séparons-nous de la Prusse ! », « À bas la Prusse ! », « Guerre à la Prusse ! », disposition d’esprit qu’un représentant particulièrement brillant des droits de souveraineté de la Bavière résuma dans le cri de guerre poussé en plein Reichstag : « Plutôt mourir Bavarois que pourrir Prussien. »
Il faut avoir assisté aux réunions de cette époque pour comprendre ce que cela signifiait pour moi quand, pour la première fois, entouré d’une poignée d’amis, je m’élevai contre cette folie dans une réunion tenue au Löwenbräukeller à Münich. C’étaient des camarades de guerre qui m’assistaient alors et l’on peut peut-être se figurer ce que nous ressentions quand une foule délirante braillait contre nous et menaçait de nous assommer ; cette foule était composée pour la plus grande partie de déserteurs et d’embusqués, qui avaient passé leur temps dans les services de l’arrière ou au pays, tandis que nous défendions la patrie. Ces scènes avaient, il est vrai, un avantage pour moi : la petite troupe de mes partisans se sentait plus étroitement unie à moi et bientôt elle me prêta serment de fidélité à la vie et à la mort.
Ces luttes, qui se répétèrent constamment pendant toute l’année 1919, semblèrent devenir encore plus âpres dès le début de 1920. Il y eut des réunions – je me souviens particulièrement de celle qui eut lieu salle Wagner dans la Sonnenstrasse à Munich – au cours desquelles mon groupe, qui entre temps avait grossi, eut à soutenir les plus violents assauts ; il arriva plus d’une fois que mes partisans furent, par douzaines, maltraités, jetés à terre, foulés aux pieds, pour être finalement, plus morts que vifs, jetés à la porte de la salle.
La lutte que j’avais engagée en isolé, soutenu seulement par mes compagnons du front, fut alors poursuivie par le jeune mouvement qui la considérait, je dirais presque, comme un devoir sacré.
C’est encore aujourd’hui ma fierté de pouvoir dire que nous avons, alors que nous ne pouvions compter presque exclusivement que sur nos partisans bavarois, travaillé à mettre fin, lentement, mais sûrement, à cet amalgame de sottise et de trahison. Je dis sottise et trahison, parce que, si je suis convaincu que la masse de ceux qui suivaient était composée de braves gens sans intelligence, je ne puis trouver de telles excuses à la décharge des organisateurs et des meneurs. Je les tenais et les tiens encore aujourd’hui pour des traîtres à la solde de la France. Dans un cas, le cas Dorten, l’histoire a déjà rendu sa sentence (Dorten fut un des chefs du séparatisme rhénan).
Ce qui rendait alors notre campagne particulièrement difficile, c’était l’habileté avec laquelle on savait dissimuler le but réellement poursuivi, en mettant au premier plan la tendance fédéraliste représentée comme l’unique cause de ces intrigues. Il est d’ailleurs évident que le fait d’attiser la haine contre la Prusse n’a rien à voir avec le fédéralisme. On s’étonne aussi de constater qu’un « mouvement fédéraliste » tente de dissoudre ou de découper en plusieurs morceaux un État faisant partie de la confédération. Car un fédéraliste sincère, pour lequel la formule employée par Bismarck pour définir le Reich n’est pas un mot d’ordre déclamatoire et hypocrite, ne devrait pas, au moment même où il s’en réclame, souhaiter qu’on arrache quelques-uns de ses territoires à cet État prussien créé ou du moins définitivement constitué par Bismarck, ou même soutenir ouvertement des tendances séparatistes. Quels cris n’aurait-on pas poussés à Munich si un parti conservateur prussien avait favorisé, ou même réclamé et hâté publiquement, la séparation de la Franconie d’avec la Bavière. Néanmoins, on ne pouvait que plaindre ceux que séduisait sincèrement le fédéralisme et qui n’avaient pas vu de quels infâmes saltimbanques ils étaient les dupes ; c’étaient surtout des gens trompés. En chargeant l’idée fédéraliste d’une telle tare, ses propres partisans creusaient sa tombe. On ne peut pas faire de la propagande pour une organisation fédéraliste du Reich en dénigrant, insultant et couvrant de boue l’élément le plus essentiel d’une telle constitution politique, c’est-à- dire la Prusse, bref en rendant, autant que faire se peut, impossible l’existence de cet État confédéré. Ce résultat était d’autant plus invraisemblable que les prétendus fédéralistes s’attaquaient précisément à cette Prusse que l’on pouvait le moins identifier avec le régime démocratique instauré par la révolution de novembre. Car les injures et les critiques de ces prétendus « fédéralistes » ne s’adressaient pas aux auteurs de la constitution de Weimar, qui d’ailleurs étaient eux- mêmes en majorité des Allemands du sud ou des Juifs, mais aux représentants de la vieille Prusse conservatrice, qui était aux antipodes de la constitution de Weimar. Le fait que cette campagne se gardait soigneusement de toucher aux Juifs, ne doit pas étonner et donne peut-être la clef de toute l’énigme.
De même qu’avant la révolution, le Juif avait su détourner l’attention du public de ses offices de guerre, ou plutôt de lui-même, et soulever les masses, et spécialement le peuple de Bavière, contre la Prusse, de même il lui fallait, après la révolution, voiler d’une façon quelconque sa nouvelle entreprise de pillage dix fois plus active. Et il réussit encore à exciter les uns contre les autres les « éléments nationaux » de l’Allemagne : les conservateurs bavarois contre les conservateurs prussiens. Il s’y prit à nouveau de la façon la plus perfide, en provoquant, lui qui tenait seul tous les fils et dont dépendait le sort du Reich, des abus de pouvoir si brutaux et si maladroits qu’ils devaient mettre en ébullition le sang de tous ceux qui en étaient continuellement les victimes. Celles-ci n’étaient jamais des Juifs, mais des compatriotes allemands. Ce n’était pas le Berlin de quatre millions de travailleurs et de producteurs, appliqués à leur tâche, que voyait le Bavarois, mais le Berlin fainéant et corrompu des pires quartiers de l’Ouest ! Mais sa haine ne se tournait pas contre ces quartiers-là ; elle ne visait que la ville « prussienne ».
Il y avait souvent de quoi perdre courage.
Cette habileté qu’apporte le Juif à détourner de lui l’attention du public en l’occupant ailleurs, on peut encore l’observer aujourd’hui.
En 1918, il ne pouvait être question d’un antisémitisme systématique. Je me rappelle encore combien il était difficile de prononcer alors seulement le nom de Juif. Ou bien l’on vous regardait avec des yeux stupides ou bien l’on se heurtait à l’opposition la plus vive. Nos premières tentatives pour montrer à l’opinion publique quel était notre véritable ennemi, ne paraissaient avoir à cette époque presque aucune chance de succès et ce ne fut que lentement que les choses prirent une meilleure tournure. Si défectueuse qu’ait été l’organisation de la Ligue défensive et offensive, elle n’en eut pas moins le grand mérite de poser de nouveau la question juive et de la traiter en soi. En tout cas, c’est grâce à la ligue que l’antisémitisme commença, pendant l’hiver de 1918-1919, à prendre lentement racine. Il est vrai que le mouvement national-socialiste lui fit faire plus tard bien d’autres progrès. Il est parvenu surtout à élever ce problème au-dessus de la sphère étroite des milieux de la grande et de la petite bourgeoisie et à en faire le ressort et le mot d’ordre d’un grand mouvement populaire. Mais, à peine avions-nous réussi à doter ainsi le peuple allemand d’une grande idée qui devait faire en lui l’union et le conduire au combat, que le Juif avait déjà organisé sa défense. Il eut recours à son ancienne tactique. Avec une fabuleuse rapidité, il jeta au milieu des troupes racistes la torche de la discorde et sema la désunion. Soulever la question des menées ultramontaines et provoquer ainsi une lutte mettant aux prises le catholicisme et le protestantisme, c’était, étant données les circonstances, le seul procédé possible pour détourner l’attention du public vers d’autres problèmes, de façon à empêcher que la juiverie ne fût attaquée par des forces coalisées. Le tort que les hommes, qui ont posé cette question devant le public, ont fait au peuple ne pourra jamais être réparé par eux. En tout cas, le Juif a atteint son but : catholiques et protestants se combattent à cœur joie et l’ennemi mortel de l’humanité aryenne et de toute la chrétienté rit sous cape.
On avait su autrefois occuper, pendant des années, l’opinion publique avec le combat que se livraient le fédéralisme et la centralisation et les user l’un par l’autre, tandis que le Juif faisait métier et marchandise de la liberté de la nation et trahissait notre patrie au profit de la grande finance internationale ; aujourd’hui, il réussit à lancer l’une contre l’autre les deux confessions allemandes, pendant que les bases sur lesquelles elles reposent toutes deux sont rongées et minées par le poison que secrète le Juif cosmopolite et internationaliste.
Qu’on se représente les ravages que la contamination par le sang juif cause quotidiennement dans notre race et que l’on réfléchisse que cet empoisonnement du sang ne pourra être guéri que dans des siècles, ou jamais, de façon à ce que notre peuple en soit indemne ; qu’on réfléchisse, en outre, que cette décomposition de la race diminue, souvent même anéantit les qualités aryennes de notre peuple allemand, si bien que l’on voit décroître de plus en plus la puissance dont nous étions doués comme nation dépositaire de la civilisation et que nous courons le danger de tomber, au moins dans nos grandes villes, au niveau où se trouve aujourd’hui l’Italie du sud. Cette contamination pestilentielle de notre sang, que ne savent pas voir des centaines de milliers de nos concitoyens, est pratiquée aujourd’hui systématiquement par les Juifs. Systématiquement, ces parasites aux cheveux noirs, qui vivent aux dépens de notre peuple, souillent nos jeunes filles inexpérimentées et causent ainsi des ravages que rien en ce monde ne pourra plus compenser. Les deux, mais oui ! les deux confessions chrétiennes voient d’un œil indifférent cette profanation, cette destruction de l’être noble et d’une espèce particulière dont la grâce divine avait fait don à la terre. Ce qui est important pour l’avenir de la terre, ce n’est pas de savoir si les protestants l’emporteront sur les catholiques ou les catholiques sur les protestants, mais si l’homme de race aryenne survivra ou mourra. Pourtant les deux confessions ne luttent pas aujourd’hui contre celui qui veut anéantir l’aryen : elles cherchent réciproquement à s’anéantir. Celui qui se tient sur le plan raciste a le devoir sacré, quelle que soit sa propre confession, de veiller à ce qu’on ne parle pas sans cesse à la légère de la volonté divine, mais qu’on agisse conformément à cette volonté et qu’on ne laisse pas souiller l’œuvre de Dieu. Car c’est la volonté de Dieu qui a jadis donné aux hommes leur forme, leur nature et leurs facultés. Détruire son œuvre, c’est déclarer la guerre à la création du Seigneur, à la volonté divine. Aussi chacun doit agir – bien entendu, au sein de son Église – et chacun doit considérer comme le premier et le plus sacré de ses devoirs de prendre position contre tout homme qui, par sa conduite, ses paroles ou ses actes, quitte le terrain de sa propre confession pour aller chercher querelle à l’autre confession. Car critiquer les particularités d’une des confessions, c’est aggraver le schisme religieux existant déjà chez nous et provoquer une guerre d’extermination entre les deux confessions qui se partagent l’Allemagne. Notre situation au point de vue de la religion n’offre aucun point de comparaison avec celle de la France, de l’Espagne et surtout de l’Italie. On peut, par exemple, dans ces trois pays, prêcher la lutte contre le cléricalisme ou l’ultramontanisme sans courir le danger que cette tentative divise le peuple français, espagnol ou italien en tant que peuple. Mais on ne le peut pas en Allemagne, parce que les protestants prendraient certainement part à cette campagne. Ainsi les mesures de défense, qui seraient prises dans les autres pays par les seuls catholiques contre les abus de pouvoir que commettrait leur pasteur suprême au point de vue politique, auraient immédiatement chez nous le caractère d’une attaque dirigée par le protestantisme contre le catholicisme. Ce qui est supporté par les fidèles d’une confession, même quand cela leur semble injuste, est rejeté a priori et avec la plus grande violence par tout tenant d’une autre confession. Cela va si loin que ceux-là mêmes qui seraient tout prêts à réformer les abus qu’ils constatent au sein de leur propre Église, y renonceront immédiatement et tourneront tous leurs efforts vers l’extérieur sitôt qu’une pareille réforme sera conseillée ou surtout exigée par une autorité appartenant à une autre confession. Ils considèrent cette prétention comme une tentative aussi injustifiée qu’inadmissible, et même inconvenante, de se mêler de choses qui ne regardent pas l’autorité en cause. De semblables tentatives ne paraissent pas excusables même quand elles se fondent sur le droit supérieur que possède la communauté nationale de défendre ses intérêts, parce qu’aujourd’hui les sentiments religieux ont toujours une influence beaucoup plus profonde que les considérations nationales et politiques. Et l’on ne changera rien à cet état de choses en poussant les deux confessions à se faire réciproquement une guerre acharnée ; il ne deviendrait autre que si une tolérance réciproque assurait à la nation le bienfait d’un avenir dont la grandeur agirait aussi sur ce terrain dans le sens de la réconciliation.
Je n’hésite pas à déclarer que je vois, dans les hommes qui cherchent aujourd’hui à mêler le mouvement raciste aux querelles religieuses, de pires ennemis de mon peuple que ne le peut être n’importe quel communiste internationaliste. Car, convertir ce communiste-là, c’est à quoi est appelé le mouvement national-socialiste. Mais celui qui veut faire sortir du rang les racistes et les rendre infidèles à leur mission commet l’acte le plus condamnable. Il est, que ce soit consciemment ou inconsciemment ne fait rien à l’affaire, le champion des intérêts juifs. Car l’intérêt des Juifs est aujourd’hui de faire couler, jusqu’à épuisement, le sang du mouvement raciste dans une lutte religieuse au moment où il devient un danger pour les Juifs. Et j’insiste sur l’expression : faire couler le sang jusqu’à épuisement ; car seul un homme n’ayant aucune connaissance de l’histoire peut s’imaginer que ce mouvement est capable de résoudre actuellement une question sur laquelle ont échoué des siècles et de grands hommes d’État.
D’ailleurs, les faits parlent d’eux-mêmes. Les messieurs qui découvrirent subitement, en 1924, que la plus haute mission du mouvement raciste était de combattre « l’ultramontanisme » n’ont pas anéanti ce dernier, mais ils ont brisé le mouvement raciste. Je proteste contre la supposition qu’il ait pu se trouver dans les rangs des racistes un cerveau assez peu mûr pour s’imaginer capable de faire ce qui avait été impossible pour un Bismarck. Ce sera toujours le premier devoir des chefs du mouvement national- socialiste de s’opposer, de la façon la plus décidée, à toute tentative faite pour engager le mouvement national-socialiste dans de pareilles querelles, et d’exclure immédiatement des rangs du parti ceux qui font de la propagande pour de tels projets. En fait, ils y sont définitivement parvenus à l’automne de 1923. Le protestant le plus croyant pouvait marcher dans nos rangs à côté du catholique le plus croyant, sans que sa conscience dût le moins du monde entrer en conflit avec ses convictions religieuses. L’âpre combat que tous deux menaient en commun contre le destructeur de l’humanité aryenne leur avait appris au contraire à s’estimer et à s’apprécier mutuellement. Et, en même temps, c’est pendant ces années-là que le parti a combattu avec le plus d’acharnement le parti du Centre, non pas, il est vrai, pour des raisons religieuses, mais exclusivement au point de vue national, raciste et économique. Le succès se déclara alors aussi clairement en notre faveur qu’il prouve aujourd’hui l’erreur de ceux qui se prétendaient mieux informés.
Les querelles confessionnelles ont parfois atteint pendant ces dernières années une telle acuité que des milieux racistes, en proie à un aveuglement qui frappe ceux que Dieu abandonne, ne voyaient pas à quel point leur conduite était insensée, tandis que des journaux marxistes et athées se faisaient au besoin les avocats de confessions religieuses et, en colportant d’un camp à l’autre des déclarations dont la sottise dépassait parfois toute mesure, et qui étaient mises à la charge de l’une ou l’autre partie, s’efforçaient de jeter de l’huile sur le feu.
Mais c’est précisément pour un peuple qui, comme le peuple allemand, est capable, ainsi que son histoire l’a si souvent prouvé, de faire la guerre jusqu’à la dernière goutte de son sang pour des fantômes, que tout appel aux armes de ce genre comporte un danger mortel. Il a toujours détourné notre peuple de s’attacher à résoudre les questions dont dépendait pratiquement son existence. Pendant que nous nous consumions dans nos querelles religieuses, les autres peuples se partageaient le reste du monde. Et pendant que le mouvement raciste se demande si le danger ultramontain est plus à craindre que le péril juif, et inversement, le Juif détruit ce qui constitue les bases de notre existence en tant que race et, par là, détruit notre peuple pour toujours. Je peux, en ce qui concerne ces champions racistes-là, faire, en faveur du mouvement national-socialiste et par suite du peuple allemand, d’un cœur sincère, cette prière : « Seigneur, protège-le de pareils amis ; quant à ses ennemis, il en viendra bien à bout tout seul. »
* * *
La lutte entre le fédéralisme et l’unitarisme, que les Juifs surent si astucieusement susciter en 1919, 1920, 1921 et au-delà, força le mouvement national-socialiste, bien qu’il se refusât à y participer, à prendre position sur les questions essentielles qu’elle soulevait. L’Allemagne doit-elle être un État fédératif ou centralisé et que signifient pratiquement ces deux définitions ? À mon avis, la seconde question est la plus importante, non seulement parce qu’on ne peut comprendre toute la portée du problème sans y avoir d’abord répondu, mais aussi parce qu’elle est de nature à éclairer et à réconcilier les adversaires.
Qu’est-ce qu’un État fédératif ?
Par État fédératif, nous entendons une association d’États souverains, qui s’unissent de leur propre volonté et en vertu de leur souveraineté, et qui se désaisissent, en faveur de la fédération, de ceux de leurs droits souverains dont l’exercice lui est nécessaire pour exister et subsister.
Cette formule théorique ne trouve, dans la pratique, son application sans réserve chez aucune des confédérations, existant actuellement sur la terre. C’est à la constitution des États-Unis d’Amérique qu’elle convient le moins, car on ne pourrait dire que le plus grand nombre, et de beaucoup, des États particuliers qui composent cette confédération aient jamais joui primitivement d’une souveraineté quelconque, attendu que beaucoup d’entre eux ont été, pour ainsi dire, dessinés au cours des temps sur l’ensemble du territoire que dominait la confédération. C’est pourquoi, lorsqu’il est question des États particuliers composant les États- Unis d’Amérique, il s’agit, dans la plupart des cas, de territoires plus ou moins grands, délimités pour des raisons techniques et administratives, dont souvent les frontières ont été tracées avec une règle sur la carte, mais qui ne possédaient et ne pouvaient posséder auparavant aucun des droits de souveraineté propres à un État. Car ce ne furent pas ces États qui fondèrent la confédération, mais ce fut la confédération qui forma d’abord une grande partie de ces soi-disant États. Les droits indépendants, très étendus, qui furent laissés, ou, pour mieux dire, reconnus, aux différents territoires n’ont rien à voir avec le caractère spécifique de cette association d’États ; ils correspondent à l’étendue de son domaine, à ses dimensions dans l’espace qui sont presque celles d’un continent. On ne peut donc parler de la souveraineté politique des États composant l’Union américaine, mais des droits qui leur ont été constitutionnellement définis et garantis, ou, pour mieux dire, de leurs privilèges.
La formule donnée ci-dessus ne s’applique pas non plus exactement à l’Allemagne, bien que les États particuliers aient, sans aucun doute, d’abord existé en Allemagne en qualité d’États, et que le Reich soit sorti d’eux. Seulement, le Reich n’a pas été formé par la libre volonté et l’égale collaboration des États particuliers, mais par les effets de l’hégémonie d’un d’entre eux, la Prusse. Déjà la grande inégalité qui règne entre les États allemands en ce qui concerne l’étendue de leurs territoires ne permet pas de comparer le mode de formation du Reich avec celui des États- Unis. Il y avait un tel disparate, au point de vue de la puissance, entre les plus petits des anciens États confédérés allemands et les plus grands, surtout le plus grand de tous, que les services qu’ils pouvaient rendre à la confédération étaient de très inégale importance et qu’ils n’ont pu prendre la même part à la fondation du Reich, à la formation de la confédération. En fait, on ne pouvait parler, au sujet de la plupart de ces États, d’une véritable souveraineté et l’expression : souveraineté de l’État, n’était pas autre chose qu’une formule administrative et vide de sens. En réalité, le passé, et aussi le présent, avaient mis au rancart beaucoup de ces prétendus « États souverains » et avaient ainsi prouvé de la façon la plus claire la fragilité de ces formations politiques « souveraines ».
Ce n’est pas ici le lieu d’exposer dans le détail comment ces États se sont constitués au cours de l’histoire ; il suffit de signaler que, presque en aucun cas, leurs frontières ne coïncident avec l’habitat d’une race allemande déterminée. Ce sont des créations purement politiques et dont la plupart remontent à la plus triste époque du Reich : à celle de son impuissance et du morcellement de notre patrie qui était à la fois la conséquence et la cause de cette impuissance.
La constitution de l’ancien Reich tenait compte, du moins en partie, de cet état de choses, en ne permettant pas aux États particuliers d’être également représentés au Bundesrat, mais en leur accordant une représentation proportionnelle à l’étendue de leur territoire et au chiffre de leur population, à leur importance effective, ainsi qu’au rôle qu’ils avaient joué dans la formation du Reich.
L’abandon que les États particuliers avaient fait de leurs droits de souveraineté en faveur du Reich, pour lui permettre de naître, n’avait été spontané que pour une très petite part ; en pratique, ces droits n’avaient, pour la plupart, jamais existé ou bien la Prusse s’en empara simplement en usant de sa puissance prépondérante. Il est vrai que Bismarck ne prit pas pour principe de donner au Reich tout ce qu’il lui était possible d’enlever par n’importe quel procédé aux États particuliers ; il ne réclama d’eux que ce dont le Reich avait absolument besoin. C’était un principe aussi modéré que sage : d’une part il tenait le plus grand compte des coutumes et de la tradition ; de l’autre, il assurait d’avance au nouveau Reich, dans une grande mesure, l’affection et la collaboration cordiale des États allemands. Mais il serait absolument faux d’attribuer cette décision de Bismarck à la conviction où il aurait été que le Reich posséderait ainsi, pour tous les temps, une somme suffisante de droits de souveraineté. Cette conviction, Bismarck ne l’avait pas du tout ; au contraire, il voulait laisser à l’avenir le soin d’accomplir ce qu’il aurait été trop difficile d’exécuter au moment présent et ce que les États n’auraient supporté qu’avec peine. Il comptait sur l’effet niveleur du temps et sur la pression qu’exercerait l’évolution dont l’action continue lui paraissait plus efficace qu’une tentative faite pour briser incontinent la résistance qu’auraient alors opposée à ses projets les États particuliers. En agissant ainsi, il a montré et prouvé de la façon la plus évidente à quel point il était un homme d’État. Car, en fait, la souveraineté du Reich n’a cessé de croître aux dépens des États particuliers. Le temps a fait ce que Bismarck attendait de lui.
L’effondrement de l’Allemagne et la disparition des régimes monarchiques ont donné à cette évolution une impulsion décisive. Car, les États allemands devant leur existence moins à des causes ethniques qu’à des causes purement politiques, leur importance tombait à zéro sitôt que la forme qu’avait prise le développement de ces États, c’est-à-dire la forme monarchique et leurs dynasties, était supprimée. Un grand nombre de ces « États fantômes » furent alors si bien privés de toute base qu’ils renoncèrent d’eux-mêmes à survivre et, pour des raisons de pure utilité, fusionnèrent avec des États voisins ou s’agrégèrent spontanément à d’autres plus puissants ; c’est là la preuve la plus frappante de l’extraordinaire faiblesse de la souveraineté effective dont jouissaient ces petits États et de la piètre opinion qu’avaient d’eux leurs propres citoyens.
Si l’élimination du régime monarchique et de ses représentants avait déjà porté un coup très dur au caractère fédératif du Reich, il fut encore plus touché par les obligations que nous avions contractées en acceptant le traité de « paix ».
Il allait de soi que les droits souverains en matière de finance, dont avaient joui jusqu’alors les « États », passaient au Reich, du moment que la perte de la guerre lui imposait des obligations pécuniaires auxquelles n’auraient jamais pu satisfaire les contributions personnelles des Pays. Les autres mesures, comme la prise en charge des postes et des chemins de fer par le Reich, étaient aussi la conséquence inéluctable de l’asservissement de notre peuple auquel conduisaient peu à peu les traités de paix. Le Reich était contraint de s’assurer la possession exclusive de ressources de plus en plus nombreuses pour pouvoir satisfaire aux obligations qu’on ne cessait de lui extorquer.
Les formes que prit souvent cette extension des pouvoirs du Reich purent être insensées ; le processus n’en était pas moins naturel et logique. La responsabilité en revient aux partis et aux hommes qui n’ont pas fait autrefois tout ce qu’il fallait pour finir victorieusement la guerre. Les principaux responsables étaient, particulièrement en Bavière, les partis auxquels la poursuite de buts égoïstement intéressés avait fait oublier pendant la guerre de rendre au Reich ce qu’ils devaient au Reich, omissions qu’ils durent compenser au décuple après la défaite. Histoire vengeresse ! On peut dire seulement que le ciel a rarement puni aussi promptement le péché. Ces mêmes partis qui, peu d’années auparavant, avaient mis les intérêts de leurs États particuliers – et surtout en Bavière – au-dessus de ceux du Reich, durent voir alors, sous la pression des événements, l’intérêt supérieur du Reich étrangler les États particuliers. Et ils étaient victimes de leurs propres fautes.
C’est une hypocrisie sans pareille que de se lamenter, quand on s’adresse aux électeurs (car c’est
seulement à ceux-ci que s’adresse la campagne d’agitation menée par les partis actuels), sur la perte que les Pays ont faite de leurs droits souverains, tandis que tous ces partis sans exception ont à l’envi pratiqué une politique d’exécution dont les dernières conséquences devaient naturellement amener les modifications les plus profondes dans la vie intérieure de l’Allemagne. Le Reich de Bismarck était, vis-à-vis de l’extérieur, libre et sans entraves. Ce Reich n’avait pas contracté les obligations financières si lourdes et en même temps absolument improductives que l’Allemagne doit supporter aujourd’hui sous le régime du plan Dawes. Sa compétence était limitée à l’intérieur à quelques droits absolument nécessaires. Il pouvait donc très bien se passer, en ce qui touchait ses revenus, de droits régaliens qui lui fussent propres et vivre des contributions que lui fournissaient les Pays ; et, comme ceux-ci s’étaient vu garantir la possession de leurs droits de souveraineté et que, d’autre part, le montant des contributions qu’ils payaient au Reich étaient relativement peu élevé, ils étaient très bien disposés en sa faveur. Mais c’est se livrer à une propagande injustifiée et même mensongère que d’expliquer le peu de popularité dont jouit aujourd’hui le Reich auprès des Pays par la dépendance financière dans laquelle ils se trouvent vis-à-vis de lui. Non, ce n’est pas là la véritable raison. La défaveur dont souffre la conception politique que représente le Reich ne doit pas être attribuée à la perte de droits souverains imposés aux Pays ; elle est bien plutôt l’effet de la façon lamentable dont le peuple allemand se voit aujourd’hui représenté par son État. Malgré toutes les fêtes de la Bannière du Reich et de la Constitution, le Reich actuel est resté étranger au cœur de toutes les classes de notre peuple et les lois de défense de la république peuvent bien, par la terreur qu’elles cherchent à inspirer, empêcher qu’on touche aux institutions républicaines : elles ne parviendront pas à les rendre chères à un seul Allemand. Le souci poussé à l’extrême de protéger, par des articles de loi et par la menace des travaux forcés, la république contre ses propres citoyens constitue la critique la plus écrasante et la plus avilissante de tout le régime.
Mais c’est encore pour une autre raison que certains partis mentent en prétendant que le Reich a cessé d’être populaire, parce qu’il a empiété sur les droits de souveraineté des pays. Supposons que le Reich n’ait pas donné une aussi grande extension à son hégémonie, il ne faudrait pas croire qu’il serait pour cela plus en faveur auprès des pays particuliers, du moment que les charges générales resteraient aussi lourdes qu’elles le sont actuellement. Au contraire, si les pays devaient acquitter des impôts aussi élevés que ceux dont le Reich a besoin pour satisfaire au Diktat qui nous a réduits en esclavage, l’hostilité qu’il rencontre serait encore beaucoup plus vive. Il ne serait pas seulement très difficile d’encaisser les contributions que les Pays devraient au Reich ; on ne pourrait les obtenir que par la voie de la contrainte. Car, puisque la république s’est placée sur le terrain des traités de paix et n’a ni le courage ni l’envie de les dénoncer, elle doit tenir compte de ses obligations. La faute en est encore aux partis qui parlent continuellement aux patientes masses électorales de la nécessité de maintenir l’indépendance des Pays, et qui, en même temps, réclament du Reich et soutiennent une politique qui a fatalement pour conséquence la suppression des derniers de ce qu’on appelle « droits de souveraineté ».
Je dis « fatalement », parce que le Reich actuel n’a pas d’autre moyen de pourvoir aux charges que lui a imposées une politique intérieure et extérieure absolument insensée. Ici encore un clou chasse l’autre ; et toute nouvelle dette que le Reich contracte par la façon criminelle dont il représente les intérêts de l’Allemagne vis-à-vis des pays étrangers, nécessite un tour de vis donné à l’intérieur : opération qui entraîne la suppression progressive de tous les droits de souveraineté des États particuliers, pour empêcher de naître ou de se développer chez eux des germes de résistance.
Voici quelle est, en général, la différence caractéristique entre la politique du Reich actuel et celle d’autrefois : l’ancien Reich faisait régner la paix à l’intérieur et montrait sa force au dehors, tandis que la République montre sa faiblesse vis-à-vis de l’étranger et opprime les citoyens à l’intérieur. Dans les deux cas, l’une des attitudes conditionne l’autre : un État national plein de vigueur n’a pas besoin de beaucoup de lois à l’intérieur, parce que les citoyens ont pour lui de l’affection et de l’attachement ; un État d’esprit international qui règne sur des esclaves, ne peut imposer que par la contrainte la corvée à ses sujets. Car le régime actuel commet un mensonge aussi éhonté qu’impudent quand il parle de « libres citoyens ». Il n’y en avait de tels que dans l’ancienne Allemagne. La république étant une colonie d’esclaves au service de l’étranger n’a pas de citoyens, mais tout au plus des sujets. Aussi n’a-t-elle pas de drapeau national ; elle n’a qu’une marque de fabrique, introduite par un décret des autorités et protégée par des dispositions législatives. Ce symbole qui, pour la démocratie allemande, doit jouer le rôle du chapeau de Gessler, est par suite toujours resté étranger au cœur de notre peuple. La république, qui, étant au pouvoir, a traîné dans la boue le symbole d’une tradition à laquelle elle restait insensible et d’un passé dont la grandeur ne lui inspirait pas le moindre respect, sera stupéfaite un jour quand elle verra combien superficiel est l’attachement que ses sujets éprouvent pour son symbole. Elle a pris d’elle-même le caractère d’un intermède dans l’histoire de l’Allemagne.
C’est ainsi que cet État est aujourd’hui forcé, pour continuer à vivre, de rogner de plus en plus les droits de souveraineté des Pays, non pas seulement pour des raisons matérielles, mais aussi pour des raisons psychologiques. Car, tout en saignant ses citoyens jusqu’à la dernière goutte par sa politique d’exaction au point de vue financier, il doit fatalement leur enlever aussi leurs derniers droits, s’il ne veut pas que le mécontentement général explose un jour sous la forme d’une rébellion ouverte.
En renversant les termes de la formule citée plus haut, nous trouverons, nous autres nationaux- socialistes, la règle fondamentale suivante : Un Reich national et vigoureux, qui sait reconnaître et protéger dans toute leur étendue les intérêts de ses citoyens au- delà des frontières, peut leur offrir la liberté à l’intérieur, sans avoir à craindre pour la solidité de l’État. Mais, d’autre part, un gouvernement national énergique peut se permettre d’empiéter largement sur la liberté des particuliers aussi bien que sur celle des Pays, du moment que chaque citoyen se rend compte que de pareilles mesures sont nécessaires à la grandeur de la nation.
Il est sûr que tous les États du monde s’acheminent, par l’évolution de leur organisation intérieure, vers une certaine centralisation. L’Allemagne ne fera pas non plus exception à cet égard. C’est déjà aujourd’hui une sottise de parler de la « souveraineté d’État » des pays, car elle ne convient pas, en réalité, à la taille ridicule de ces formations politiques. L’importance des États particuliers n’a fait que décroître au point de vue des communications et de la technique administrative. Le trafic moderne, la technique moderne diminuent continuellement les distances et rétrécissent l’espace. Un État d’autrefois ne représente plus aujourd’hui qu’une province, et les États du temps présent auraient passé autrefois pour des continents. La difficulté, évaluée sous son aspect purement technique, d’administrer un État comme l’Allemagne, n’est pas plus grande qu’était il y a cent vingt ans celle de gouverner une province comme le Brandebourg. Il est plus facile aujourd’hui de franchir la distance qui sépare Munich de Berlin qu’il ne l’était il y a cent ans d’aller de Munich au Starnberg. Et tout le territoire du Reich d’aujourd’hui est, en proportion des moyens de transport actuels, moins étendu que celui de n’importe lequel des États de taille moyenne qui formaient la Confédération Germanique au temps des guerres napoléoniennes. Celui dont l’esprit reste fermé aux conséquences découlant de faits constatés est en retard sur son temps. Il y a eu à toutes les époques de pareils aveugles et il y en aura toujours. Mais ils peuvent tout au plus ralentir le mouvement de la roue de l’histoire ; ils ne l’arrêteront jamais.
Nous autres nationaux-socialistes ne devons pas rester aveugles aux conséquences qu’il faut tirer de ces axiomes. Ici non plus nous ne devons pas nous laisser séduire par les grandes phrases des partis bourgeois qui se disent nationaux. J’emploie l’expression de grandes phrases, parce que ces partis ne croient pas sincèrement eux-mêmes que la réalisation de leurs intentions soit possible et parce que, secondement, ils sont les principaux responsables du tour qu’ont pris les événements. Surtout en Bavière, les cris que l’on pousse pour demander qu’on diminue la centralisation ne sont qu’une farce de parti politique et ne révèlent aucune intention sincère. À tous les moments où ces partis auraient dû faire de ces déclamations quelque chose de réel et de sérieux, ils ont, sans exception, lamentablement flanché. Chaque fois que le Reich a commis ce qu’ils appelaient un « brigandage des droits de souveraineté » de l’État bavarois, il ne lui a été opposé pratiquement aucune résistance, à part quelques clabauderies répugnantes. Oui ! quand quelqu’un osait faire vraiment front contre ce régime insensé, il était, sous prétexte « qu’il ne se plaçait pas sur le terrain de l’État actuel », mis hors la loi et banni par ces mêmes partis et on le persécutait jusqu’à ce qu’on l’eût réduit au silence soit en le jetant en prison, soit en lui interdisant illégalement de parler en public. Nos partisans peuvent voir par là combien ces milieux soi- disant fédéralistes sont foncièrement menteurs. La théorie d’un État confédéré n’est pour eux, de même que la religion, qu’un moyen de défendre leurs intérêts de parti, souvent assez malpropres.
* * *
Autant une certaine centralisation, spécialement au point de vue des voies de communication, paraît naturelle, autant nous avons nous autres nationaux- socialistes le devoir de prendre position de la façon la plus ferme contre une pareille évolution de l’État actuel, parce que ces mesures n’ont d’autre but que de dissimuler et de rendre possible une politique extérieure catastrophique. C’est précisément parce que le Reich actuel n’a pas entrepris ce qu’on appelle l’étatisation des chemins de fer, des Postes, des finances, etc., pour des raisons supérieures de politique nationale, mais simplement pour disposer de ressources et de gages, afin de pouvoir pratiquer une politique d’exécution sans frein, que nous devons, nous les nationaux-socialistes, faire tout ce qui nous paraît propre à gêner et, si c’est possible, à arrêter une pareille politique. Pour cela il faut lutter contre la centralisation imposée actuellement aux institutions d’une importance vitale pour notre peuple, puisqu’elle n’est pratiquée que pour monnayer les milliards de tributs et les gages qu’exige, au profit de l’étranger, la politique suivie par notre gouvernement depuis la guerre.
C’est pour cette raison que le mouvement national- socialiste doit prendre position contre de pareilles tentatives.
Le second motif qui nous détermine à nous opposer à cette centralisation, c’est qu’elle pourrait fortifier à l’intérieur la situation d’un régime qui, par tous ses actes, a été une calamité pour la nation allemande. Le Reich démocratique et enjuivé que nous avons actuellement et qui est pour la nation allemande une véritable malédiction, cherche à rendre vaines les critiques que lui adressent des États particuliers, qui ne sont pas encore tous remplis de l’esprit de notre époque, en les réduisant à une complète insignifiance. En présence de cette situation nous avons, nous autres nationaux-socialistes, toute raison de chercher non seulement à fournir à cette opposition des États particuliers la base d’une puissance politique, qui promette le succès, mais aussi de faire de leur lutte contre la centralisation l’expression d’un intérêt général supérieur, national et allemand. Aussi tant que le Parti populaire bavarois défendra les « droits spéciaux » de l’État bavarois pour des raisons bassement intéressées et particularistes, nous aurons à tirer parti de cette situation spéciale pour abattre le régime démocratique actuel, issu de la révolution de novembre, et cela pour servir l’intérêt supérieur de la nation.
Le troisième motif qui nous porte à lutter contre la centralisation actuelle est la conviction où nous sommes que ce qu’on appelle l’étatisation au profit du Reich n’est réellement pas, pour une grande part, une unification ; elle n’est pas, en tous cas, une simplification ; il s’agit uniquement, le plus souvent, de soustraire aux droits de souveraineté des Pays des institutions dont les portes seront ainsi largement ouvertes aux convoitises des partis révolutionnaires. Jamais encore, au cours de l’histoire d’Allemagne, le favoritisme n’a été pratiqué d’une façon plus éhontée que par la république démocratique. La rage avec laquelle se poursuit la centralisation est, pour une bonne part, imputable aux partis qui promettaient autrefois de frayer la voie aux fonctionnaires capables et qui, pourtant, quand il s’agit aujourd’hui de pourvoir les différents emplois et fonctions, s’inquiètent exclusivement de savoir si les candidats appartiennent à leur parti. Ce sont particulièrement les Juifs qui, depuis que la république existe, se déversent en flots d’une incroyable abondance dans tous les offices économiques et organes administratifs, de sorte qu’ils sont devenus aujourd’hui un domaine juif.
C’est surtout cette troisième considération qui nous impose, pour des raisons de tactique, le devoir d’examiner scrupuleusement toute nouvelle mesure tendant à accentuer la centralisation et de prendre, au besoin, position contre elle. Le point de vue où nous nous placerons pour procéder à cet examen doit toujours être celui d’une politique nationale et d’inspiration élevée, et jamais celui d’un étroit particularisme.
Cette dernière remarque est nécessaire pour que les membres de notre parti ne croient pas que, nous autres nationaux-socialistes, nous refusions par principe au Reich d’incarner une souveraineté supérieure à celle des États particuliers. Il ne doit pas y avoir parmi nous le moindre doute sur ce droit. Comme, pour nous, l’État n’est en soi qu’une forme, tandis que sa substance, c’est-à-dire le contenu de cette forme, est la nation, le peuple, il est clair que tous les intérêts doivent être subordonnés aux intérêts souverains du peuple. Notamment, nous ne pouvons reconnaître à aucun État particulier, existant au sein de la nation et du Reich qui la représente, une puissance politique indépendante et les droits d’un État souverain. Il faut mettre un terme, et ce sera fait un jour, aux abus que commettent des États confédérés en entretenant des légations qui soi- disant les représentent à l’étranger ou les uns chez les autres. Tant que subsistera ce désordre, il ne faudra pas nous étonner si l’étranger continue à mettre en doute la solidité de l’armature du Reich et s’il agit en conséquence. Ces abus sont d’autant plus criants qu’on ne peut leur reconnaître aucune utilité qui compense leurs inconvénients. Si les intérêts d’un Allemand habitant l’étranger ne peuvent être protégés par l’ambassadeur du Reich, ils le seront encore moins par le ministre d’un petit État que son peu d’importance rend ridicule dans le cadre du monde moderne. On ne peut voir dans ces États confédérés que des défauts de notre armure facilitant les tentatives faites au dedans et au dehors du Reich pour amener sa dissolution, tentatives qu’un État continue à voir d’un bon œil. Nous ne pouvons pas non plus comprendre, nous autres nationaux-socialistes, que quelque famille noble atteinte de sénilité cherche, dans un poste de ministre plénipotentiaire, un nouveau sol nourricier pour un de ses rameaux déjà desséché. Notre représentation diplomatique à l’étranger était déjà si lamentable aux temps de l’ancien Reich qu’il est tout à fait superflu de compléter les expériences faites alors.
Il faut absolument que, à l’avenir, l’importance attribuée aux Pays se mesure aux efforts tentés par leurs gouvernements pour faire progresser la civilisation. Le monarque qui a le plus fait pour l’importance de la Bavière n’était pas quelque particulariste entêté et hostile au germanisme, mais bien plutôt Louis Ier qui unissait à son goût pour les arts, l’amour sincère de la grande Allemagne. En consacrant les ressources de l’État à faire parvenir la Bavière à un rang élevé parmi les peuples civilisés, plutôt qu’à augmenter sa puissance politique, il a obtenu des résultats meilleurs et plus durables qu’il ne lui aurait été possible de le faire par d’autres moyens. Munich était une ville princière provinciale sans grande importance, il en fit une grande métropole artistique allemande et créa un centre intellectuel dont l’attrait est assez puissant pour que les Franconiens, dont le caractère national est si différent de celui des Bavarois, restent encore aujourd’hui attachés à la Bavière. Si Munich était resté ce qu’il était autrefois, ce qui s’est passé en Saxe se serait répété en Bavière, mais avec cette différence que le Leipzig bavarois, c’est-à-dire Nuremberg, ne serait pas devenu une ville bavaroise, mais franconienne. Ce ne sont pas ceux qui crient : « À bas la Prusse ! » qui ont fait la grandeur de Munich ; celui qui donna de l’importance à cette ville fut le roi qui voulait faire cadeau à la nation allemande d’un joyau d’art qu’on se sentirait obligé de visiter et d’admirer, et qui le fut en effet. Et de ceci nous devons tirer un enseignement pour l’avenir. L’importance attribuée aux États particuliers ne saurait plus se mesurer désormais à leur puissance politique ; je la vois plutôt se manifester dans le rôle qu’ils joueront comme rameaux de la race ou en encourageant les progrès de la civilisation. Mais, même à cet égard, le temps fera son œuvre de nivellement. La commodité des communications modernes brasse tellement les hommes que les frontières qui séparent les rameaux d’une même race s’effacent lentement, mais continuellement, de sorte que les formes revêtues par la civilisation d’un peuple présentent peu à peu le même aspect sur toute l’étendue de son domaine.
L’armée doit être tout particulièrement et avec le plus grand soin préservée des influences particularistes. Le futur État national-socialiste ne doit plus retomber dans les fautes du passé ni la charger de besognes qui ne sont pas les siennes et auxquelles elle n’a pas le droit de se livrer. L’armée n’a pas pour rôle d’être une école où l’on maintient les particularités distinguant les uns des autres les différents rameaux d’une race ; bien au contraire, c’est une école où tous les Allemands doivent apprendre à se comprendre réciproquement et à s’accommoder les uns aux autres. Tout ce qui peut, dans la vie d’une nation, tendre à diviser, l’armée doit s’en servir pour unir. Elle doit élever la jeune recrue au-dessus de l’horizon de son petit pays et lui faire découvrir celui de la nation allemande. Le soldat doit être exercé à apercevoir, non pas les frontières de son pays natal, mais celles de sa patrie, car il aura un jour à les défendre. Aussi est-il absurde de laisser le jeune Allemand dans son pays natal ; il faut lui faire connaître l’Allemagne pendant qu’il fait son service militaire. Cela est d’autant plus nécessaire qu’aujourd’hui le jeune compagnon allemand ne fait plus, comme autrefois, le tour d’Allemagne qui élargissait son horizon. N’est-il pas absurde, si l’on se rend compte de cette nécessité, de laisser encore le jeune Bavarois servir à Munich, le Franconien à Nuremberg, le Badois à Karlsruhe, le Wurtembergeois à Stuttgart, etc., et ne serait-il pas plus raisonnable de montrer au jeune Bavarois tantôt le Rhin, tantôt la mer du Nord, au Hambourgeois les Alpes, au Prussien de l’Est le Massif Central allemand et ainsi de suite ? Le caractère propre à chaque région doit rester dans la troupe, mais non dans la garnison. Toute tentative de centralisation peut encourir notre désapprobation, mais jamais celle qui a l’armée pour objet. Au contraire, quand même nous serions opposés à tous les autres modes de centralisation, celui-ci ne pourrait que nous réjouir. Abstraction faite de cette considération que, étant donné l’effectif actuel de l’armée du Reich, il serait absurde de conserver des corps de troupe se recrutant dans des États particuliers, nous voyons dans la centralisation opérée au sein de l’armée du Reich un progrès auquel nous ne devrons pas renoncer dans l’avenir lorsqu’on rétablira l’armée nationale.
Du reste, une conception neuve et victorieuse doit rejeter tous les liens qui pourraient paralyser l’essor intellectuel qui la pousse en avant. Le national- socialisme doit revendiquer le droit d’imposer ses principes à toute la nation allemande sans tenir compte des frontières qui séparaient jusqu’à présent les États confédérés, et de faire l’éducation de la nation conformément à ses conceptions et à ses plans. Pas plus que les Églises ne se sentent liées et limitées par les frontières politiques, l’idée nationale-socialiste ne l’est par les divisions territoriales des États particuliers.
La doctrine nationale-socialiste n’est pas la servante des intérêts politiques des États confédérés ; elle doit être un jour reine et maîtresse de la nation allemande. Elle a à diriger et à réorganiser la vie d’un peuple ; elle doit donc réclamer, d’un ton impératif, de droit de passer par-dessus des frontières tracées par une évolution que nous n’acceptons plus.
Plus le triomphe de ses idées sera complet, plus la liberté individuelle dont elle gratifiera tout le pays sera grande.
Chapitre 11 – Propagande et organisation
L’année 1921 eut, pour moi et pour le mouvement, à plusieurs points de vue, une signification particulière.
Après mon entrée dans le parti ouvrier allemand, j’entrepris aussitôt la direction de la propagande. Je tenais alors cette branche pour de beaucoup la plus importante. Il s’agissait d’abord beaucoup moins de se casser la tête au sujet de questions d’organisation que de propager l’idée même chez un plus grand nombre d’hommes. La propagande devait précéder de beaucoup l’organisation et gagner d’abord à celle-ci le matériel humain à malaxer. Aussi suis-je l’ennemi d’une organisation trop rapide et trop pédante. De cela, il ne sort souvent qu’un mécanisme mort et rarement une organisation vivante. Car une organisation est redevable de son existence à une vie organique, à un développement organique. Des idées qui ont atteint un nombre déterminé d’hommes tendront toujours à un certain ordre, et, de cet aspect intérieur, il résulte une très grande valeur. Mais ici aussi il faut compter avec la faiblesse des hommes, qui incite l’individu isolé à se cabrer instinctivement au moins au début, contre une autorité. De même, quand une organisation se développe mécaniquement de haut en bas, le grand danger consiste en ceci : une personnalité qui s’est un jour fait connaître, pas encore exactement adaptée ni même suffisamment capable, essaiera, à l’intérieur du mouvement, d’empêcher par jalousie l’ascension d’éléments plus capables. Le dommage qui résultera d’une pareille éventualité peut, principalement dans le cas d’un mouvement jeune, devenir désastreux.
C’est pour cette raison qu’il est préférable de répandre par la propagande, pendant un certain temps, une idée d’abord d’un point central, et ensuite de rechercher soigneusement parmi le matériel humain qui a grossi peu à peu des « têtes de Führer » et de les éprouver. Il peut arriver, quelquefois, que des hommes, insignifiants en eux-mêmes, soient néanmoins considérés comme des Führer nés. Il serait d’ailleurs tout à fait faux de vouloir voir dans la richesse des connaissances théoriques des preuves caractéristiques d’aptitude à être un Führer.
Le contraire se produit très fréquemment.
Les grands théoriciens sont très rarement aussi de grands organisateurs, vu que la grandeur du théoricien et du fabricant de programme réside en première ligne dans la connaissance et l’établissement de lois justes au point de vue abstrait, alors que l’organisateur doit être en première ligne un psychologue, doit prendre l’homme comme il est, et, pour cela, le connaître. Il doit le surestimer aussi peu que le sous-estimer. Il doit, au contraire, essayer de tenir compte de la faiblesse et de la bestialité pour créer un organisme vivant, d’une vigueur inébranlable, parfaitement approprié à propager une idée et à lui ouvrir le chemin du succès.
Mais c’est encore plus rare qu’un grand théoricien soit un grand Führer. Tel sera beaucoup plus souvent l’agitateur, ce dont beaucoup de gens d’esprit scientifique ne veulent pas volontiers convenir et, cependant, c’est compréhensible. Un agitateur qui prouve la capacité de répandre une idée dans les masses, doit toujours être un psychologue, même s’il n’est qu’un démagogue. Il sera toujours un meilleur Führer que le théoricien méditant loin des hommes et loin du monde. Car conduire signifie pouvoir remuer les masses. Le don de former des idées n’a rien à voir avec la capacité d’un Führer. Il est tout à fait inutile de discuter pour savoir ce qui a une plus grande signification : de concevoir des idéals et des buts d’humanité, ou de les réaliser. Il en est de cela comme si souvent dans la vie : l’un serait complètement stupide sans l’autre. La plus belle conception théorique reste sans but et sans valeur si le Führer ne peut mettre les masses en mouvement vers elle. Et, inversement, que serait toute « génialité » et tout élan de Führer, si un théoricien intelligent ne déterminait ses buts pour la lutte humaine ? Mais la réunion du théoricien, de l’organisateur et du Führer en une seule personne est la plus rare qu’on puisse trouver sur cette terre : cette réunion produit le grand homme.
Comme je l’ai déjà fait remarquer, je me suis consacré à la propagande durant les premiers temps de mon activité dans le parti. Il lui fallait réussir à imprégner peu à peu un petit noyau d’hommes de la nouvelle doctrine, pour former le matériel qui, plus tard, pourrait former les premiers éléments d’une organisation. C’est ainsi que le but de la propagande dépassa généralement celui de l’organisation.
Si un mouvement a l’intention de bouleverser un monde et d’en construire un nouveau à sa place, une clarté intégrale doit régner au sein même de la direction d’après les principes suivants : chaque mouvement qui aura gagné du matériel humain devra d’abord le partager en deux groupes : les partisans et les membres.
Le devoir de la propagande est de recruter des partisans ; celui de l’organisation est de gagner des membres.
Le partisan d’un mouvement est celui qui se déclare d’accord sur ses buts ; le membre, celui qui combat pour lui.
Le partisan sera amené au mouvement par la propagande. Le membre sera contraint par l’organisation d’agir lui-même pour le recrutement de nouveaux partisans, du nombre desquels de nouveaux membres pourront ensuite se former. « Être partisan » exige seulement la reconnaissance passive d’une idée ;
« être membre » exige qu’on la représente activement et qu’on la défende ; sur dix partisans, on aura à peine deux membres. Être partisan implique un simple effort de connaissance ; pour être membre, il faut avoir le courage de représenter l’idée reconnue vraie et de la répandre largement.
En raison de sa forme passive, le simple effort de connaissance convient à la majorité des hommes, qui sont paresseux et lâches. Être membre exige une activité de pensée qui ne convient qu’à une minorité.
La propagande doit, à cause de cela, porter ses soins sans cesse sur cette vérité qu’une idée gagne des partisans, et qu’ensuite l’organisation doit être très soigneusement attentive à chercher des membres parmi les plus capables d’entre les partisans. À cause de cela, la propagande n’a pas besoin de se casser la tête au sujet de l’importance, en particulier, de chacun de ceux qu’elle a convertis, au sujet de leur capacité, de leur savoir, de leur intelligence ou de leur caractère, tandis que l’organisation doit extraire très soigneusement de ces éléments ceux qui rendront réellement possible la victoire du mouvement.
* * *
La propagande essaie de faire pénétrer une doctrine dans le peuple entier, l’organisation n’englobe dans son cadre que ceux qui, pour des raisons psychologiques, ne pourront nuire à l’expansion de l’idée.
* * *
La propagande inculque une idée à la masse, pour l’y préparer à l’heure de la victoire, tandis que l’organisation combat pour la victoire grâce à un faisceau permanent, organique et prêt au combat, de ceux de ses partisans qui paraissent capables et décidés à mener la bataille pour la victoire.
* * *
La victoire d’une idée sera d’autant plus facile que la propagande aura travaillé l’ensemble des hommes sur la plus grande échelle, et que l’organisation – qui doit pratiquement conduire le combat – sera plus exclusive, plus forte et plus solide.
Il s’ensuit que le nombre des partisans n’est jamais assez grand, tandis que le nombre des membres est plus facilement trop grand que trop petit.
* * *
Quand la propagande a rempli un peuple entier d’une idée, l’organisation peut en tirer les conséquences avec une simple poignée d’hommes. Propagande et organisation, donc partisans et membres, se trouvent d’après cela dans une position mutuelle définie. Mieux la propagande aura travaillé, plus les membres effectifs pourront être restreints ; plus le nombre des partisans sera grand, plus le nombre des membres pourra être petit, et, inversement : plus la propagande sera défectueuse, plus doit être importante l’organisation ; plus la troupe de partisans d’un mouvement reste faible, plus le nombre des membres doit être grand, s’il veut encore compter sur le succès.
* * *
Le premier devoir de la propagande est de gagner des hommes pour l’organisation ultérieure : le premier devoir de l’organisation est de gagner des hommes pour la continuation de la propagande. Le second devoir de la propagande est de désagréger l’état de choses actuel et de le faire pénétrer par la nouvelle doctrine, tandis que le devoir de l’organisation doit être le combat pour la puissance, pour faire définitivement triompher la doctrine.
* * *
Un succès décisif, dans une révolution, sera toujours atteint, si une nouvelle conception du monde est enseignée à tout le peuple, voire même imposée en cas de nécessité, et que, d’autre part, l’organisation centrale – donc le mouvement – englobe seulement le minimum d’hommes absolument indispensables pour occuper le centre nerveux de l’État.
Autrement dit :
Dans tout mouvement réellement grandiose, à allure de bouleversement mondial, la propagande doit d’abord répandre l’idée de ce mouvement. Infatigablement, elle devra chercher à rendre claires les nouvelles idées, à les inculquer à la foule, ou tout au moins à ébranler ses anciennes convictions. Vu qu’une telle propagande doit posséder une « colonne vertébrale », la doctrine devra être étayée sur une solide organisation. L’organisation choisit ses membres parmi ceux de ses partisans qui ont été gagnés par la propagande. Cette organisation croîtra d’autant plus vite que la propagande sera poussée plus intensément, et cette propagande pourra d’autant mieux travailler que l’organisation qui est derrière elle sera plus forte et plus puissante.
Le suprême devoir de l’organisation consiste à prendre soin que les désunions, en quelque sorte intérieures, parmi les membres du mouvement, ne conduisent pas à des ruptures, et, par suite, à l’affaiblissement du travail dans le mouvement ; ensuite que l’esprit d’attaque ne meure pas, mais se renouvelle et se fortifie de plus en plus. Le nombre des membres n’a pas besoin, d’après cela, de croître sans fin, au contraire : seule une élite restreinte peut être énergique et audacieuse ; un mouvement dont l’organisation s’accroîtrait sans fin, s’affaiblirait un jour, forcément, à cause de cela. Des organisations trop pléthoriques perdent peu à peu leur combativité et ne sont plus capables de soutenir avec résolution et esprit d’offensive la propagation de l’idée.
Plus une idée est riche et fertile en ferments révolutionnaires, plus ses propagateurs doivent être actifs, vu que la force subversive d’une telle doctrine risque d’en éloigner les petits bourgeois lâches. Ils pourront, dans leur for intérieur, se sentir des partisans, mais refuseront de le reconnaître ouvertement.
C’est pourquoi l’organisation d’une idée réellement révolutionnaire ne prend comme membres que les plus actifs partisans. C’est dans cette activité, cautionnée par un choix naturel, que réside la condition d’une propagande ultérieure du mouvement, aussi bien qu’un combat victorieux pour la réalisation de l’idée.
Le plus grand danger qui puisse menacer un mouvement est la croissance anormale du nombre de membres par suite d’un trop rapide succès. Un mouvement, tant qu’il a à combattre rudement, est évité par tous les êtres lâches et foncièrement égoïstes, mais ceux-ci cherchent vite à acquérir la qualité de membres, si le parti, par son développement, affirme son succès.
C’est à cela qu’il faut attribuer que beaucoup de mouvements victorieux restent soudain en arrière, avant le succès définitif, avant l’ultime achèvement de ses buts, et, pris d’une faiblesse interne, cessent le combat et s’étiolent. À la suite de sa première victoire, il s’est introduit dans son organisation tellement d’éléments mauvais, indignes et particulièrement lâches, que ces lâches-là ont finalement la majorité et étouffent les combatifs. Ils détournent le mouvement au service de leurs propres intérêts, l’abaissent au niveau de leur propre héroïsme mesquin et ne font rien pour achever la victoire de l’idée originelle. Le fanatisme s’amollit alors, la force combative est paralysée, ou, comme le monde bourgeois a coutume de dire très justement en pareil cas : « Ce parti a mis de l’eau dans son vin ». Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Aussi est-il indispensable qu’un mouvement, de par la nécessité de sa propre conservation, se ferme à la foule dès que le succès s’est rangé de son côté, et qu’à l’avenir il procède à l’accroissement de son organisation avec une précaution infinie et un examen approfondi. C’est seulement ainsi que le mouvement pourra conserver son noyau intact, frais et sain. Il faut prendre soin que ce soit exclusivement ce noyau qui conduise le mouvement, c’est-à-dire entreprenne, en tant que détenteur de la puissance, les actes indispensables pour la réalisation pratique de l’idée. Se basant sur les idées fondamentales et originelles du mouvement, l’organisation a le devoir, non seulement de consolider toutes les positions importantes, conquises dans le plan doctrinal, mais aussi de constituer un organisme central de direction. Et ceci jusqu’à ce que les principes actuels et les enseignements du parti soient devenus le fondement et l’essence même du nouvel État. C’est alors seulement que la constitution propre de cet État, issue de l’esprit du parti, pourra s’élaborer librement, au prix d’une lutte intestine. En effet il s’agit moins de points de vue purement humains que du libre jeu et de l’action de forces, sans doute prévisibles, mais d’un effet difficilement contrôlable pour l’avenir.
Tous les grands mouvements, qu’ils soient de nature religieux ou politique, ne doivent leurs puissants succès qu’à la connaissance et à l’emploi de ces principes. Tout succès durable n’est pas concevable sans l’observance de ces lois.
* * *
En tant que directeur de la propagande du parti, je me suis efforcé, non seulement de préparer le terrain pour le mouvement ultérieur, mais encore, avec une rigueur absolue, j’ai agi pour que l’organisation ne prenne que des éléments de valeur. Plus j’ai été dur et plus j’ai manié le fouet, plus ma propagande effrayait, écartait les faibles et les natures hésitantes, empêchait leur entrée dans le premier noyau de notre organisation. Ils sont peut-être restés des partisans et, dans ce cas, n’élèvent pas la voix, restant, au contraire, dans un silence anxieux. Combien de milliers ne m’ont-ils pas assuré autrefois qu’ils étaient complètement d’accord en tout, mais que, néanmoins, dans aucune circonstance, ils ne pouvaient être membres. Le mouvement était si violent, disaient-ils, qu’une coopération comme membres les exposerait à des conflits particuliers très aigus, même à des dangers, mais qu’on ne pouvait faire grief à un bourgeois honnête et paisible de se tenir pour le moment à l’écart, puisqu’il appartenait complètement de cœur à la cause.
Et cela était bien ainsi.
Si ces hommes qui, intérieurement, n’étaient pas partisans de moyens révolutionnaires extrêmes, étaient venus alors dans notre parti, comme membres, nous aurions pu nous considérer comme une pieuse congrégation, mais certainement pas comme un mouvement jeune et joyeux de combattre.
La forme vivante et combative que je donnai alors à notre propagande a fortifié et garanti la tendance extrémiste de notre mouvement, vu que, seuls, les hommes réellement extrémistes – à quelques exceptions près – étaient prêts à coopérer avec moi comme membres.
Ainsi conçue, ma propagande a eu un effet tel qu’en un court laps de temps, des centaines de milliers d’hommes nous donnaient raison intérieurement et souhaitaient notre victoire, s’ils étaient personnellement trop lâches pour faire des sacrifices à la cause et y participer.
Jusqu’au milieu de 1921, notre action, purement dirigée vers le recrutement, pouvait encore suffire et être utile au mouvement. Des événements particuliers à la fin de l’été de cette année-là firent apparaître opportun d’adapter l’organisation au succès patient de la propagande.
La tentative d’un groupe de racistes visionnaires, sous l’égide éminemment agissante du président du parti, alors en exercice, de s’emparer de la direction du mouvement, conduisit à l’effondrement de cette petite intrigue et me donna, à l’unanimité, dans une assemblée générale des membres, la direction d’ensemble du mouvement.
En même temps, fut décidée l’acceptation d’un nouveau statut qui délégua au premier président du mouvement la pleine responsabilité, qui abrogea les décisions du bureau et, à la place de celles-ci, introduisit un système de division du travail qui s’est montré, depuis, tout à fait efficace.
Depuis le 1er août 1921, j’ai entrepris cette réorganisation intérieure du mouvement et j’ai trouvé le concours d’une pléiade d’âmes d’élite ; j’estime nécessaire de les mentionner dans un chapitre spécial.
Pour donner, au point de vue de l’organisation, quelque valeur aux résultats de la propagande et les établir solidement, je dus faire table rase d’une série d’habitudes prises jusque-là et apporter, dès le début, des principes que ne possédait aucun des partis existants ou qu’aucun n’avait adoptés.
Dans les années 1919 et 1920, le mouvement avait eu pour direction un Comité choisi par les assemblées des membres. Le Comité comprenait un premier et un second trésorier, un premier et un second secrétaire et, comme têtes, un premier et un second président. À cela s’ajoutèrent encore un comité de membres, le chef de la propagande et différents assesseurs.
Ce Comité personnifiait proprement – si comique que cela put être – ce que le mouvement même voulait combattre de la façon la plus âpre, à savoir le parlementarisme. Car il s’agissait là-dedans d’un principe qui personnifiait tout à fait le système depuis le plus petit hameau jusqu’aux futurs arrondissements, provinces, États, jusqu’au gouvernement, système sous lequel nous souffrions tous.
Il était absolument indispensable de procéder à un changement, si on ne voulait pas que le mouvement, par suite des mauvaises bases d’organisation intérieure, se corrompît pour toujours et fût incapable d’accomplir un jour sa haute mission.
Les séances du Comité, qui étaient régies par un protocole, et dans lesquelles on votait à la majorité et prenait des décisions, représentaient en réalité un petit Parlement. La valeur personnelle et la responsabilité y manquaient. Il y régnait le même contresens et la même déraison que dans nos grands corps représentatifs de l’État. On nommait pour ce Comité des secrétaires, des hommes pour tenir la caisse, des hommes pour former les membres de l’organisation, des hommes pour la propagande et Dieu sait encore pour quoi, et ensuite tous devaient prendre position en commun pour chaque question particulière et décider par vote. Ainsi l’homme qui était chargé de la propagande votait sur un sujet concernant les finances ; le trésorier votait sur l’organisation ; l’organisateur votait sur un sujet ne concernant que les secrétaires, etc.
Pourquoi désignait-on un homme pour la propagande, puisque les caissiers, les scribes, les commissaires, etc., avaient à juger les questions la concernant ? Cela paraît à un cerveau sain aussi incompréhensible que si, dans une grande entreprise industrielle, les gérants avaient à décider sur la technique de la production, ou si, inversement, les ingénieurs avaient à juger des questions administratives.
Je ne me suis pas soumis à cette insanité, mais, après fort peu de temps, je me suis éloigné des séances. Je faisais ma propagande et cela suffisait. J’interdisais, en général, que le premier incapable venu essaie d’intervenir sur le terrain qui m’était propre. De même que moi, réciproquement, je me gardais d’intervenir dans les affaires des autres.
Lorsque l’acceptation des nouveaux statuts et mon appel au poste de premier président m’eurent, entre temps, donné l’autorité nécessaire et le droit correspondant, cette insanité cessa immédiatement. À la place des décisions du Comité, fut admis le principe de ma responsabilité absolue.
Le premier président est responsable pour la conduite d’ensemble du mouvement. Il répartit les forces du Comité qui sont sous sa direction, aussi bien que les collaborateurs indispensables pour le travail à fournir. Chacun de ces messieurs est responsable, irrévocablement, des tâches dont il a été chargé. Il n’est subordonné qu’au premier président, qui doit prendre soin de l’action commune de tous, relativement au choix des personnes et à l’élaboration des directives communes que le travail en commun nécessite.
Cette nécessité d’une responsabilité absolue est peu à peu devenue l’évidence même au sein du mouvement, du moins pour la conduite du parti. Dans les petits hameaux et peut-être aussi encore dans les cantons et les districts, il s’écoulera encore longtemps jusqu’à ce que ces principes s’imposent, vu que, naturellement, les « cœurs en peau de lapin » et les incapables s’en défendront toujours : pour eux, la responsabilité unique pour une entreprise sera toujours désagréable ; ils se sentent toujours plus libres et plus à leur aise si, pour chaque décision importante, ils sont couverts par la majorité d’un soi-disant comité. Mais il me parut indispensable de prendre position avec une violence extraordinaire contre une telle habitude, de ne faire aucune concession à la crainte des responsabilités, et de viser à une conception du devoir et du savoir d’un Führer, devant amener au poste de Führer exclusivement l’homme digne de l’occuper.
Mais un mouvement qui veut combattre la stupidité parlementaire doit d’abord être libéré de celle-ci. C’est seulement sur une telle base qu’il peut devenir fort pour lutter.
Un mouvement qui, à une époque de domination de la majorité, repose fondamentalement sur le principe de la pensée du Führer et de sa responsabilité, culbutera un jour avec une certitude mathématique la situation jusqu’alors existante et sera victorieux.
Cette idée amena à l’intérieur du mouvement une complète réorganisation. Et dans son achèvement logique, elle conduisit aussi à une séparation très nette de l’action économique du mouvement et de la conduite politique générale. La pensée de la responsabilité fut, par principe, également étendue à l’ensemble des actions du parti et les rendit efficaces en libérant de toute influence politique les questions économiques et inversement.
Lorsque, à l’automne 1919, j’entrai au parti alors composé de six hommes, celui-ci ne possédait ni permanence ni employé, ni formulaire, ni sceau, ni papier imprimé. Le siège du Comité n’était alors qu’une auberge dans la Herrengasse et, plus tard, un café Am Gasteig. C’était une situation impossible. Je me mis alors peu de temps après en campagne et explorai un nombre important de restaurants et d’auberges dans Munich, dans l’intention de louer une salle spéciale ou un local quelconque pour le parti. Dans l’ancienne brasserie Sternecker, im Tal (Rue de Munich), se trouvait une petite salle voûtée qui jadis avait servi de taverne aux conseillers du Saint-Empire en Bavière. Elle était sombre et obscure et, de ce fait, était aussi parfaitement adaptée à son ancienne destination qu’elle l’était peu au nouvel emploi qui lui était réservé. La petite ruelle, sur laquelle ouvrait son unique fenêtre, était si étroite que, même pendant les jours les plus lumineux de l’été, la chambre restait sombre et lugubre. Cela devint notre première permanence. Comme la location mensuelle ne s’élevait qu’à cinquante marks (c’était alors pour nous une somme fabuleuse), nous ne pouvions avoir de grandes exigences, nous ne pouvions même pas nous plaindre de ce qu’avant notre arrivée on eût enlevé rapidement les boiseries murales datant des conseillers, de sorte que le local finissait par donner plutôt l’impression d’un tombeau que d’un bureau.
Et cela était déjà cependant un immense progrès. Peu à peu nous acquîmes la lumière électrique, plus tard un téléphone : vint ensuite une table, avec quelques chaises empruntées, enfin une étagère, un peu plus tard encore, une armoire ; deux buffets, qui appartenaient à notre hôtelier, devaient servir pour conserver des tracts, des affiches, etc.
Le système pratiqué jusqu’alors, consistant à diriger le mouvement par une seule séance du Comité par semaine, ne pouvait durer. Il fallut un employé, payé par le parti, pour assurer l’exécution des affaires courantes.
Ce fut alors très difficile. Le mouvement avait encore si peu de membres que ce fut tout un art de découvrir parmi eux un homme approprié qui pût, avec des exigences personnelles minimes, satisfaire les exigences variées du mouvement.
Ce fut en un soldat, un de mes anciens camarades, Schüssler, qu’on trouva, après de longues recherches, le premier secrétaire du parti. Il vint d’abord chaque jour de 6 à 8 heures dans notre nouveau bureau, plus tard de 5 à 8, enfin chaque après-midi ; et, peu de temps après, il fut occupé à plein et accomplit alors son service depuis le matin jusque tard dans la nuit. Il était aussi appliqué que loyal et foncièrement honnête : il se donnait toute la peine possible et était fidèlement attaché au mouvement. Schüssler apportait avec lui une petite machine à écrire Adler qui était sa propriété. Ce fut le premier de ces instruments au service de notre mouvement. Elle fut plus tard acquise par le parti grâce aux cotisations. Un petit coffre-fort parut être indispensable pour mettre à l’abri des voleurs les dossiers et les livrets individuels des membres. Cette acquisition n’avait pas pour but d’y déposer les grosses sommes d’argent que nous aurions pu posséder. Au contraire, nous étions infiniment pauvres et j’ai souvent ajouté mes petites économies.
Un an et demi plus tard, la permanence devint trop petite et il en résulta un déménagement dans un nouveau local, Corneliusstrasse. C’était encore une auberge ; ici, nous ne possédions plus seulement une pièce, mais déjà trois, et une grande salle avec guichet. Cela nous paraissait déjà bien beau. Nous y restâmes jusqu’à novembre 1923.
En décembre 1920 se produisit l’acquisition du Völkischer Beobachter. Ce journal, qui, comme l’annonce déjà son nom, soutenait en général les desiderata racistes, fut transformé en organe du nouveau parti national-socialiste. Il parut d’abord deux fois par semaine, devint quotidien au commencement de 1923 et reçut, fin août 1923, son grand format.
Je dus alors, complètement novice dans le domaine journalistique, payer maintes fois pour mon apprentissage, ce qui me parut abominable.
En soi, un fait devait donner à réfléchir, c’est qu’il n’y avait qu’un seul journal raciste réellement important en face de l’immense presse juive. La cause en est, comme j’ai pu le constater moi-même un nombre incalculable de fois dans la pratique, que, pour une très grande part, il n’y a que peu de débouchés commerciaux pour les entreprises racistes. Elles étaient conduites beaucoup trop d’après ce point de vue que le sentiment devait avoir le pas sur l’action. Point de vue tout à fait faux, en ce sens que le sentiment ne doit rien avoir d’extérieur, mais, au contraire, doit trouver sa meilleure expression dans l’action. Celui qui peut accomplir des actions de valeur pour son peuple, montre par là un sentiment réellement plein de valeur, tandis que tel autre, qui se borne à simuler le sentiment, sans rendre en réalité des services utiles à son peuple, est un homme néfaste qui pervertit la communauté par ses sentiments néfastes.
Ainsi le Völkische Beobachter, comme déjà l’indique son nom, était un organe raciste, avec tous les avantages, et encore plus avec les défauts et les faiblesses inhérents aux institutions racistes. Autant son contenu était honnête, autant l’administration de l’entreprise était impossible commercialement. Sa rédaction croyait dur comme fer que des journaux racistes ne devaient recevoir que des oboles racistes, alors que le journal aurait dû, au contraire, se frayer un chemin par la concurrence avec les autres. C’est une inconvenance de vouloir couvrir les négligences ou les fautes de la conduite commerciale de l’entreprise par les oboles des patriotes bien pensants. Je me suis efforcé, en tous cas, de modifier cette situation dont j’avais reconnu tout de suite la gravité, et la chance m’aida en ce sens que je fis la connaissance de l’homme qui a rendu infiniment de services au mouvement depuis ce temps-là, non seulement comme directeur commercial du journal, mais aussi comme chef commercial du parti.
C’est en 1914, donc en campagne, que je connus – il était alors mon supérieur – le chef commercial actuel du parti, Max Amann. Dans les quatre années de guerre, j’eus l’occasion, presque constamment, d’observer les capacités extraordinaires, l’application et la conscience scrupuleuse de mon futur collaborateur.
Dans l’arrière-saison de l’été 1921, alors que le mouvement traversait une crise difficile et qu’un certain nombre d’employés ne me donnaient plus satisfaction, et que je faisais même avec l’un, en particulier, l’expérience la plus amère, je me tournai vers mon ancien camarade de régiment, que le hasard conduisit un jour à moi, en le priant de devenir le chef commercial du mouvement. Après de longues hésitations – Amann se trouvait alors dans une situation pleine d’avenir – il y consentit enfin, mais d’ailleurs sous la condition formelle qu’il ne ferait jamais le métier de gendarme vis-à-vis de comités quelconques et impuissants, mais, au contraire, reconnaîtrait exclusivement un maître unique. C’est le mérite ineffaçable de ce premier chef commercial du mouvement, homme de haute culture, d’avoir apporté dans les affaires du parti l’ordre et la netteté. Elles sont restées en exemple et leur qualité ne put jamais être égalée par aucune des ramifications du mouvement. Comme toujours dans la vie, une valeur supérieure éveille très fréquemment la jalousie et la haine. On devait aussi naturellement s’y attendre dans ce cas, et le subir patiemment.
Dès 1922, de rigides directives étaient en vigueur, aussi bien pour la constitution commerciale du mouvement que pour son organisation pure. Il existait déjà un répertoire central complet des dossiers englobant l’ensemble de tous les membres appartenant au mouvement. De même, on était parvenu à faire financer le mouvement. Les dépenses courantes devaient être couvertes par les recettes courantes, les recettes extraordinaires devaient être consacrées seulement aux dépenses extraordinaires. Malgré la difficulté des temps et à l’exception des petits comptes courants, le mouvement resta presque libre de dettes et même il réussit à réaliser un accroissement durable de son pécule. On travaillait comme dans une exploitation privée : le personnel employé avait à se signaler par ses actes et ne pouvait, en aucune façon, se targuer du titre de partisan. La réputation de chaque national-socialiste se prouvait d’abord par son empressement, par son application et son savoir-faire dans l’accomplissement de la tâche indiquée. Celui qui ne remplit pas son devoir, ne doit pas se vanter d’une réputation surfaite. Le nouveau chef commercial du parti affirma, malgré toutes les influences possibles, avec la dernière énergie, que les affaires du parti ne devaient pas être une sinécure pour des partisans ou des membres peu zélés. Un mouvement qui, sous une forme aussi aiguë, combat la corruption propre aux partis dans notre système administratif, doit être exempt de vices. Il se produisit encore le cas que, dans l’administration du journal, des employés qui appartenaient au « parti populaire bavarois » et avaient été engagés pour leur valeur professionnelle, se montrèrent exceptionnellement qualifiés. Le résultat de cet essai fut en général excellent. C’est précisément à cause de notre façon de reconnaître honnêtement et franchement le travail réel de chacun que le mouvement put gagner les cœurs de ces employés vite et profondément. Ils devinrent plus tard de bons nationaux-socialistes et le restèrent, non seulement de façade, mais ils le prouvèrent par le travail consciencieux, ordonné et loyal, qu’ils accomplirent dans le service du nouveau mouvement. Naturellement, un membre du parti bien qualifié était préféré à un autre aussi bien noté, mais n’appartenant pas au parti. Mais personne ne recevait un emploi par le seul motif qu’il appartenait au parti. Le vigoureux esprit de décision avec lequel le nouveau chef commercial appliqua ces principes et les fit triompher peu à peu, malgré toutes les résistances, fut plus tard pour le mouvement de la plus grande utilité. C’est seulement à cause de cela qu’il fut possible, dans les temps difficiles de l’inflation, alors que des dizaines de milliers d’entreprises s’effondraient et que des milliers de journaux devaient cesser de paraître, que la conduite commerciale du mouvement non seulement resta debout et put satisfaire à ses obligations, mais encore que le Völkische Beobachter se développa toujours davantage. Il était alors au nombre des grands journaux.
L’année 1921 fut encore importante par le fait que, grâce à ma situation de président du parti, je réussis à empêcher des critiques de détail et des interventions de tels ou tels membres du Comité au sujet de l’activité du parti. Et cela était important, parce que l’on ne pouvait pas garder pour faire du bon travail une tête réellement capable, si les incapables intervenaient constamment par leurs bavardages, prétendant tout mieux comprendre, alors qu’en réalité ils laissaient derrière eux un trouble immense. D’ailleurs, ces incapables se retirèrent, la plupart tout à fait modestement, pour porter sur un autre champ d’action leur agitation, leur contrôle et leurs idées. Il y avait des hommes, possédés d’une sorte de maladie de la critique et qui se trouvaient dans une sorte d’état d’enfantement de plans, de pensées, de projets et de méthodes prétendus supérieurs. Leur but le plus idéal et le plus élevé était surtout la formation d’un comité, qui aurait eu à flairer, sous prétexte de contrôle, le travail ordonné des autres. Combien il est blessant et peu national-socialiste de voir des hommes incompétents se mêler constamment aux gens du métier, beaucoup de ces « comitards » n’en avaient pas conscience. J’ai, en tous cas, considéré comme mon devoir de protéger contre de tels éléments toutes les forces du mouvement ordonnées et responsables, de leur procurer un soutien indispensable et toute latitude pour le travail et la marche en avant.
Le meilleur moyen pour rendre inoffensifs ces comités qui ne faisaient rien ou qui cuisinaient des projets pratiquement irréalisables, était d’ailleurs de leur procurer un travail réel quelconque. Ce fut risible de voir comment l’assemblée s’évanouit alors sans bruit et devint subitement introuvable. Cela me faisait penser à notre plus grande institution analogue, le Reichstag. Comme ils disparaîtraient sans bruit et vite, s’ils étaient chargés d’un travail réel au lieu de fabriquer des discours, d’un travail que chacun de ces hâbleurs aurait à exécuter sous sa responsabilité personnelle !
J’ai toujours posé en axiome que – aussi bien dans la vie privée que dans notre mouvement – on devait chercher aussi longtemps qu’il le fallait jusqu’à ce que l’on trouve des fonctionnaires, des gérants ou des directeurs visiblement capables et honnêtes. Alors on devait leur donner une liberté d’action totale et une autorité sans condition sur les subordonnés, en leur attribuant une responsabilité sans limite vis-à-vis de leurs supérieurs ; ainsi, personne ne peut recevoir une autorité sur les subordonnés sans être d’une compétence indiscutable. En deux ans, j’ai percé, mon opinion a triomphé et, aujourd’hui, elle paraît évidente à tous dans le mouvement, du moins en de qui concerne la direction suprême.
Le succès de cette attitude s’avéra le 9 novembre 1923. Lorsque j’étais entré dans le mouvement quatre années auparavant, il n’existait même pas de sceau. Le 9 novembre 1923, eut lieu la dissolution du parti et la confiscation de ses biens. Cela se chiffrait déjà à plus de 170 000 R. M. or, y compris tous les objets de valeur et le journal.
Chapitre 12 – La question corporative
La rapide croissance du mouvement nous obligea, dans le courant de l’année 1922, à prendre position sur une question qui n’est pas encore résolue définitivement aujourd’hui.
Dans notre tentative d’étudier les méthodes qui pourraient vite et facilement ouvrir au mouvement le chemin du cœur des masses, nous nous heurtions toujours à l’objection que le travailleur ne pourrait jamais nous appartenir complètement, tant que la représentation de ses intérêts, dans le domaine purement professionnel et économique, serait entre les mains d’hommes ayant d’autres idées politiques que nous.
Cette objection était sérieuse. L’ouvrier qui exerçait une profession, ne pouvait pas vivre sans être membre d’un syndicat. Non seulement sa valeur professionnelle était protégée dans ce cadre, mais son métier même n’avait une garantie de durée que par le syndicat. La majorité des ouvriers se trouvait dans des sociétés coopératives. Celles-ci avaient, en général, combattu pour les salaires et arrêté les barèmes de tarifs qui assuraient à l’ouvrier un certain revenu. Sans doute les résultats de ces combats profitèrent à tous les ouvriers de la profession, et des conflits de conscience durent se livrer particulièrement chez un homme honnête, quand il empochait le salaire acquis de haute lutte par les syndicats, quoiqu’il se fût tenu hors du combat.
Avec les entreprises bourgeoises normales, on pouvait difficilement traiter ce problème. Elles n’avaient aucune compréhension (ou ne voulaient en avoir aucune) pour le côté soit moral soit matériel de la question. Enfin, leurs intérêts économiques propres s’opposent, de prime abord, à toute organisation d’ensemble des forces ouvrières qui en dépendent, de telle sorte que, déjà pour cette raison, la plupart des bourgeois peuvent difficilement se former un jugement indépendant. Ici, il est nécessaire de s’adresser à des tiers, désintéressés dans la question et qui ne succomberont pas à la tentation de ne pas voir la forêt sous prétexte qu’ils ne voient que les arbres. Grâce à leur bonne volonté, ils saisiront beaucoup plus facilement une affaire qui concerne notre vie présente ou future.
Je me suis déjà expliqué dans le premier volume sur l’essence, le but et la nécessité des syndicats. Aussi longtemps que, soit par des mesures de protection d’État (qui cependant généralement sont infructueuses), soit par une nouvelle éducation commune, il ne se sera pas produit un changement dans la situation de l’ouvrier vis-à-vis de l’entrepreneur, il ne restera rien d’autre à l’ouvrier que de défendre ses intérêts en invoquant son droit égal de membre de la communauté économique. Cela cadre tout à fait avec l’esprit de solidarité et peut redresser des injustices sociales susceptibles de mettre en péril l’existence commune des citoyens. J’allais même plus loin dans mes déclarations, à savoir que ce droit de l’ouvrier doit être considéré comme naturel, aussi longtemps qu’il y aura des êtres humains assujettis à des patrons ne possédant aucun sentiment de leurs devoirs sociaux, ni même simplement d’humanité, et je conclus que, si une telle autoprotection est nécessaire, sa forme doit être celle d’un groupement des ouvriers sur la base corporative.
De cette conception générale, rien n’était changé en moi en 1922. Mais une formule claire et précise était encore à trouver. Il ne convenait pas de se déclarer satisfait simplement sur les connaissances acquises, mais il était nécessaire d’en extraire des conclusions pratiques.
Il s’agissait de répondre aux questions suivantes :
1° Les syndicats sont-ils nécessaires ?
2° Le parti nazi doit-il se déclarer corporatif ou faire entrer ses membres dans un cadre syndical quelconque ?
3° Quel serait le caractère d’un syndicat purement nazi ? Quels en seraient les devoirs et les buts ?
4° Comment le réaliserait-on ?
Je crois avoir répondu suffisamment à la première question. Telles que les choses se présentent aujourd’hui, on ne peut pas, selon ma conviction, se passer des syndicats. Au contraire, ils comptent parmi les institutions les plus importantes de la vie économique de la nation. Leur importance n’est pas seulement d’ordre social, mais national. Car un peuple dont les masses reçoivent satisfaction de leurs besoins vitaux, et en même temps aussi une sorte d’éducation grâce à une organisation syndicale correcte, acquerra à cause de cela, dans la lutte pour l’existence, un accroissement extraordinaire de sa force générale de résistance.
Les syndicats sont avant tout nécessaires comme pierres angulaires du futur parlement économique des chambres de commerce.
La seconde question est également facile à résoudre. Si le mouvement corporatif est important, il est clair que le nazisme doit prendre position à ce sujet d’une façon non seulement théorique, mais encore pratique. Mais « comment » ? Cela est plus difficile.
Le mouvement nazi, qui a pour but la création de l’État raciste nazi, doit se pénétrer de cette idée que toutes les institutions futures de cet État doivent croître des racines du mouvement lui-même. Ce serait une grande faute de croire que l’on peut entreprendre tout d’un coup, en partant de rien, ou seulement du simple pouvoir politique, une réorganisation définie ; il faut posséder une certaine réserve d’hommes déjà formés. Plus important que la forme extérieure mécaniquement très rapide à créer, l’esprit doit toujours animer cette forme. Par la force, on peut inculquer à un organisme social les principes d’un Führer, d’un dictateur. Mais ces principes ne seront réellement vivants que s’ils se forment peu à peu dans leurs plus petits détails ; ils doivent être étayés sur un matériel humain, sélectionné pendant plusieurs années, trempé par les dures réalités de la vie, et ainsi capable de réaliser la pensée du Führer.
On ne doit pas donc s’imaginer pouvoir tirer tout d’un coup à la lumière du jour, d’une serviette de notaire, des projets pour une nouvelle constitution de l’État, et les introduire par une parole impérative venue d’en haut. L’essayer, on le peut, seulement le résultat ne sera sûrement pas viable, ce sera la plupart du temps un enfant mort-né. Cela me rappelle la Constitution de Weimar et la tentative de faire cadeau au peuple allemand, en même temps que d’une nouvelle constitution, d’un nouveau drapeau, qui n’avait aucun rapport intime avec ce qu’avait vécu notre peuple dans le dernier demi-siècle.
Aussi l’État nazi doit-il se garder de telles expériences. Il peut croître par sa seule organisation interne depuis longtemps existante. Cette organisation doit, dans son essence même, être animée du vivant esprit du National-Socialisme, pour créer enfin un État National-Socialiste vivant.
Comme je l’ai déjà souligné, les cellules embryonnaires doivent reposer dans les Chambres administratives des différentes représentations professionnelles et donc, avant tout, dans la corporation. Si cette représentation professionnelle ultérieure et le parlement central économique doivent nous être offerts par une institution nazi, il y a aussi obligation que ces importantes cellules embryonnaires soient les véhicules d’un sentiment et d’une conception nazi. Les institutions du mouvement sont à transporter dans l’État, mais l’État ne peut pas tout d’un coup faire surgir de rien, comme par enchantement, les organisations correspondantes, si l’on ne veut pas que celles-ci restent des créations sans vie.
Déjà, à ce très haut point de vue, le mouvement nazi doit admettre la nécessité d’une manifestation propre corporative. Il le doit encore, parce qu’une éducation réellement nazi, aussi bien des patrons que des ouvriers, dans le sens d’une coopération réciproque dans le cadre commun d’une communauté populaire, ne résulte pas d’enseignements théoriques, d’appels ou d’exhortations, mais du combat de la vie quotidienne. C’est dans son sens et par lui que le mouvement doit éduquer les grands groupements économiques particuliers et à les rapprocher les uns des autres. Sans un tel travail préliminaire, l’espérance en la résurrection d’une future et véritable communauté populaire reste une pure illusion. Seul, le grand idéal, pour lequel combat le mouvement peut lentement former ce style général qui fera apparaître plus tard le nouvel état de choses comme reposant sur des bases solides et non pas tout en façade.
Ainsi le mouvement ne doit pas seulement se présenter à la pensée corporative en s’affirmant tel, mais encore il doit, en vue du futur État nazi, donner à un petit nombre de membres et de partisans l’éducation exigible dans ses manifestations pratiques.
La réponse à la troisième question s’impose maintenant.
La corporation nazi n’est pas un organe de lutte de classe, mais un organe de représentation professionnelle. L’État nazi ne connaît aucune « classe », mais, au point de vue politique seulement, des bourgeois avec des droits complètement égaux et, en conséquence, avec les mêmes devoirs généraux, et, à côté de cela, des ressortissants de l’État qui, au point de vue politique, ne possèdent absolument aucun droit.
La corporation au sens nazi n’a pas la mission, grâce au groupement de certains hommes, de les transformer peu à peu en une classe, pour accepter ensuite le combat contre d’autres formations, semblablement organisées à l’intérieur de la communauté populaire. Cette mission, nous ne pouvons pas l’attribuer principalement à la corporation, mais on la lui a accordée au moment où elle devint l’instrument de combat du marxisme. La corporation n’est pas en elle- même synonyme de « lutte des classes », mais c’est le marxisme qui a fait d’elle un instrument pour sa lutte de classes. Il créa l’arme économique que le monde juif international emploie pour la destruction des bases économiques des États nationaux libres et indépendants, pour l’anéantissement de leur industrie nationale et de leur commerce national, et grâce à cela, pour l’esclavage des peuples libres au service de la finance juive mondiale au-dessus des États.
La corporation nazi doit, à cause de cela, grâce à la concentration organisée de groupes déterminés de participants à la vie économique nationale, élever la sécurité de l’économie nationale même, renforcer sa force en écartant tout obstacle qui influerait d’une façon destructive sur le corps populaire national, renforcer aussi la force vive de la communauté populaire, afin que des obstacles ne portent pas préjudice à l’État et ne deviennent pas à la fin un malheur et une corruption pour l’économie elle-même.
Pour la corporation nazi, la grève n’est pas un moyen de destruction et d’ébranlement de la production nationale, mais un moyen de l’accroître et de l’écouler grâce à la lutte contre tous les obstacles qui, par suite de son caractère antisocial, interdisait l’essor économique des masses. Car le champ d’activité de chaque individu se tient toujours, dans un rapport de cause à effet, avec la situation générale sociale et juridique qu’il prend dans le processus économique. De l’examen de cette situation résulte son attitude en face de ce processus.
L’ouvrier nazi doit savoir que la prospérité de l’économie nationale signifie son propre bonheur matériel.
Le patron nazi doit savoir que le bonheur et la satisfaction de ses ouvriers sont la condition primordiale de l’existence et du développement de sa propre prospérité économique.
Les ouvriers et les patrons nazis sont tous deux des délégués et des mandataires de l’ensemble de la communauté populaire. La grande proportion de liberté personnelle qui leur est accordée dans leur action, doit être expliquée par ce fait que la capacité d’action d’un seul est beaucoup plus augmentée par une extension de liberté que par la contrainte d’en haut ; la sélection naturelle, qui doit pousser en avant le plus habile, le plus capable et le plus laborieux, ne doit pas être entravée.
Pour la corporation nazi, la grève est à cause de cela un moyen que l’on a la permission et l’obligation d’employer seulement lorsqu’il n’existe pas d’État raciste nazi. Celui-ci, à la vérité, à la place du combat colossal des deux grands groupements – patronat et prolétariat – qui, dans ses conséquences d’un amoindrissement de la production cause toujours des dommages à la communauté populaire, doit se charger de faire respecter le droit de tous. Aux chambres de commerce mêmes, il incombe le devoir de maintenir l’activité économique nationale et d’en écarter les défectuosités et les défauts.
Ce qui aujourd’hui pousse au combat des millions d’hommes doit, un jour, trouver sa solution dans les chambres professionnelles et dans le Parlement économique central. Avec eux, entrepreneurs et ouvriers ne doivent plus lutter les uns contre les autres dans la lutte des salaires et des tarifs – ce qui est très dommageable à l’existence économique de tous deux – mais ils doivent résoudre ce problème en commun pour le bien de la communauté populaire et de l’État, dont l’idée doit briller en lettres étincelantes au-dessus de tout.
Là encore, comme partout, doit régner le principe d’airain que la patrie vient d’abord, avant le parti.
Le devoir de la corporation nazi est l’éducation et la préparation en vue de ce but, qui se définit ainsi : travail en commun de tous en vue du maintien de la sécurité de notre peuple et de l’État, conformément, pour chaque individu, aux capacités et aux forces acquises à la naissance et perfectionnées par la communauté populaire.
À la quatrième question : Comment arriverons-nous à de telles corporations ? il paraissait jadis excessivement difficile de répondre.
Il est, en général, plus facile d’entreprendre des fondations dans un terrain neuf que sur un vieux terrain qui possède déjà des fondations. Dans un endroit où il n’existe aucun magasin d’une certaine spécialité, on peut facilement en édifier un. Cela est plus difficile s’il se trouve déjà une entreprise similaire et c’est même très difficile si, à côté de cela, les conditions sont telles qu’une seule entreprise peut prospérer. Car ici les fondateurs se trouvent devant le problème, non seulement d’introduire leur propre magasin nouveau, mais encore, pour pouvoir se maintenir, de devoir anéantir ce qui existe jusqu’ici à cet endroit.
Une corporation nazi n’a pas de sens à côté d’autres corporations. Car elles doivent aussi être intimement pénétrées de leur devoir mondial et aussi du devoir inné, issu du précédent, d’intolérance vis-à-vis des autres formations semblables ou pas du tout ennemies ; elles doivent affirmer leur personnalité. Il n’existe aucun arrangement ni aucun compromis pour de telles tendances, mais seulement le maintien du droit strict et exclusif.
Il y avait donc deux moyens d’aboutir :
1° On pouvait fonder une propre corporation et ensuite, peu à peu, entreprendre le combat contre les corporations marxistes internationales ; ou bien on pouvait :
2° Pénétrer dans les corporations marxistes et s’efforcer de les remplir du nouvel esprit, en vue de les transformer en instruments de notre nouvel idéal.
Le premier moyen était mauvais, car nos difficultés financières étaient en ce temps-là toujours encore très graves et nos ressources limitées. L’inflation, qui peu à peu se répandait toujours davantage, aggravait encore plus la situation : dans ces années-là, on pouvait à peine parler d’une utilité matérielle palpable de la corporation pour ses membres ; l’ouvrier n’avait aucune raison pour payer des cotisations dans une corporation. Même ceux qui étaient déjà d’opinion marxiste en étaient presque réduits à l’effondrement jusqu’à ce que, grâce à la géniale action de M. Cuno dans la Ruhr, les millions tout à coup tombassent dans leurs poches. Ce chancelier du Reich « national » doit être considéré comme le sauveur des corporations marxistes.
Nous ne devions pas compter alors sur de telles facilités financières ; et il ne pouvait être séduisant pour personne d’entrer dans une nouvelle corporation qui, par suite de sa faiblesse financière, ne pouvait pas lui offrir le moindre avantage. D’un autre côté, je dois me défendre absolument de n’avoir même pas créé, dans une telle nouvelle organisation, le plus petit fromage pour des embusqués plus ou moins intellectuels.
Surtout la question de personnes jouait là-dedans un rôle de toute première importance. Je n’avais pas alors un seul personnage à qui je puisse confier la solution de cette puissante entreprise. Celui qui aurait réellement détruit dans ce temps-là les corporations marxistes pour aider au triomphe de l’idée corporative nazi, à la place de cette institution de la lutte de classes, celui-là appartiendrait aux tout premiers grands hommes de notre peuple et son buste devrait être érigé à l’avenir pour les générations futures dans le Walhalla de Ratisbonne.
Mais je n’ai connu aucun cerveau qui eût été digne d’un tel piédestal.
Il serait tout à fait faux de nous rétorquer que les corporations internationales ne disposent seulement que de cerveaux moyens. Cela, en vérité, ne veut rien dire ; car lorsque celles-ci furent fondées, ce n’était pas difficile. Aujourd’hui, le mouvement nazi doit combattre contre une organisation monstre, déjà existante depuis longtemps, sur une base gigantesque et achevée dans ses plus petits détails. L’assaillant doit toujours être plus génial que le défenseur, s’il veut le vaincre. La forteresse marxiste corporative peut aujourd’hui être gérée par de simples bonzes ; elle ne sera emportée d’assaut que par l’énergie farouche et la capacité géniale d’un homme supérieur. Si un tel homme ne se trouve pas, il est vain de lutter avec le destin et encore plus insensé de vouloir bouleverser un état de choses sans être capable d’en reconstruire un meilleur.
Ici, il est intéressant de mettre en valeur cette idée que, dans la vie, il est souvent préférable de laisser de côté un projet plutôt que de l’entreprendre seulement à demi ou mal, faute de forces appropriées.
Une autre considération, qui n’est point démagogique, vient encore s’ajouter à cela. J’avais alors et je possède encore aujourd’hui la conviction bien arrêtée qu’il est dangereux d’entremêler à des choses économiques un grand combat politique. Cela s’applique particulièrement à notre peuple allemand. Car, dans ce cas, la lutte économique retirera immédiatement de l’énergie au combat politique. Aussitôt que les gens auront acquis la conviction que, grâce à l’épargne, ils pourront acquérir une toute petite maison, ils ne se consacreront plus qu’à ce but et il ne leur restera aucun loisir pour la lutte politique contre ceux qui, d’une façon ou de l’autre, songent à leur reprendre un jour les « sous » épargnés. Au lieu de lutter dans le combat politique pour leurs convictions et leurs idées, ils s’enfonceront complètement dans leur idée de « colonisation intérieure » et, la plupart du temps, s’assiéront entre deux chaises.
Le mouvement nazi est aujourd’hui au début de sa lutte. En grande partie, il doit d’abord former et achever l’élaboration de son idéal. Il doit lutter avec toute son énergie, pour la pénétration de son grand idéal. Le succès n’est imaginable que si sa force totale est mise sans hésitation au service de ce combat.
S’occuper de problèmes économiques, cela peut paralyser la force combative active ; nous l’avons précisément aujourd’hui sous les yeux dans un exemple classique :
La révolution de novembre 1918 ne fut pas faite par les corporations, et s’opéra malgré elles. Et la bourgeoisie allemande ne mène aucun combat politique pour l’avenir de l’Allemagne, parce qu’elle estime cet avenir suffisamment assuré dans le travail constructif économique.
Nous devrions être instruits par de telles expériences, car aussi chez nous cela ne se passerait pas autrement. Plus nous concentrerons la force totale de notre mouvement au combat politique, plus nous pourrons espérer le succès ; plus nous nous chargerons prématurément de problèmes corporatifs, de colonisation et autres similaires, moins le résultat utile pour notre cause sera appréciable. Car, si importants que soient ces problèmes, ils ne pourront être résolus qu’après notre conquête du pouvoir politique.
Jusque-là ces problèmes paralyseraient le mouvement et s’il s’en était occupé plus tôt, son idéal politique aurait rencontré encore plus d’obstacles. Il pourrait arriver facilement que les mouvements corporatifs déterminent le mouvement politique au lieu du contraire.
Un réel profit pour le mouvement, aussi bien que pour notre peuple, peut seulement se développer principalement d’un mouvement corporatif nazi, si celui-ci est déjà si fortement rempli de nos idées nazi, qu’il ne court plus le danger de tomber dans le sentier marxiste. Car une corporation nazi qui voit seulement sa mission en une concurrence de la corporation marxiste, serait plus nuisible que s’il n’y en avait pas. Elle doit proclamer la lutte contre la corporation marxiste, non seulement comme organisation, mais avant tout comme idée. Elle doit dénoncer en elle l’annonciatrice de la lutte des classes et de l’idée de classes et doit, à sa place, devenir la protectrice des intérêts professionnels de la bourgeoisie allemande.
Que tous ces points de vue aient parlé autrefois et parlent encore aujourd’hui contre la fondation de corporations propres du parti, cela me semble évident, à moins qu’une tête apparaisse soudain, qui soit appelée visiblement par le destin pour résoudre précisément cette question.
Il ne restait donc plus que deux autres moyens, ou bien recommander aux propres compagnons du parti de sortir des corporations, ou bien de rester dans celles existant jusqu’à présent, pour y agir d’une façon autant que possible destructive.
J’ai, en général, recommandé ce dernier moyen.
Particulièrement dans l’année 1922-1923, on pouvait le faire sans inconvénient, car le bénéfice financier que, au temps de l’inflation, la corporation pouvait empocher dans ses propres rangs, était nul par suite du nombre restreint de nos membres. J’ai déjà refusé autrefois de faire des expériences qui promettaient l’insuccès. J’aurais considéré comme un crime de prendre à un ouvrier une partie de son salaire réduit en faveur d’une institution que je ne jugeais pas utile à ses membres.
Si un nouveau parti politique disparaît de nouveau un jour, c’est à peine dommage, c’est presque toujours un profit et personne n’a le droit de s’en plaindre. Car ce que l’individu donne à un mouvement politique, il le donne à fonds perdu. Mais qui paye une cotisation dans une corporation a droit, en retour, à un salaire qu’on lui a garanti. Si on ne lui en tient pas compte, les fondateurs d’une telle corporation sont des menteurs, ou du moins des hommes écervelés qu’on devrait rendre responsables.
C’est d’après ce point de vue que nous avons agi aussi en l’année 1922. D’autres le comprenaient apparemment mieux et ils fondèrent des syndicats.
Ils nous faisaient grief de l’absence de ceux-ci, et voulaient y voir le signe le plus évident que nos vues étaient erronées autant qu’étroites. Mais ces créations ne tardèrent pas à disparaître elles aussi, et le résultat fut en dernière analyse le même que chez nous. Avec la seule différence que nous n’avions trompé ni les autres ni nous-mêmes.
Chapitre 13 – La politique allemande des alliances après la guerre
Un manque absolu de méthode avait caractérisé la direction des affaires étrangères du Reich, parce qu’on n’avait pas su dégager les principes directeurs sur lesquels devait s’appuyer une politique d’alliances répondant aux intérêts du pays ; la révolution, loin de corriger cette erreur, la porta à son comble. Car, si la confusion des idées en ce qui concernait la politique générale avait été avant la guerre la principale cause des fautes commises par le gouvernement dans la conduite de sa politique étrangère, celle-ci souffrit, après la guerre, de la duplicité de nos dirigeants. Il était naturel que les milieux qui voyaient réalisés, grâce à la révolution, leurs plans subversifs, n’eussent aucun intérêt à pratiquer une politique d’alliances dont le résultat eût été de remettre sur pied un État allemand indépendant. Une semblable évolution aurait été en contradiction avec les intentions secrètes des criminels de novembre ; elle aurait mis fin passagèrement, ou même définitivement, à l’internationalisation de l’économie et des forces productrices de l’Allemagne ; mais ce qui était surtout à craindre, c’était qu’un combat victorieusement mené pour rendre le Reich indépendant de l’étranger n’eût, sur la politique intérieure, une influence qui pouvait devenir un jour fatale à l’autorité des détenteurs actuels du pouvoir. Il n’est pas concevable, en effet, qu’une nation puisse se soulever contre l’oppression sans qu’on lui ait donné auparavant conscience d’elle-même et, inversement, tout grand succès remporté dans la politique étrangère influe fatalement sur le réveil du sentiment national. L’expérience prouve que tout combat mené pour la libération d’un peuple développe en lui le patriotisme et, par suite, le met mieux en garde contre les menées des éléments antinationaux qu’il renferme. Des situations et des personnages qu’on supporte en temps de paix, auxquels souvent on n’accorde même pas d’attention, se heurtent, dans les périodes où l’enthousiasme national remue une nation jusque dans ses profondeurs, à une opposition qui va jusqu’à la résistance ouverte et qui leur est souvent fatale. Qu’on se rappelle, par exemple, la peur qu’on a partout des espions lorsqu’éclate une guerre, peur qui se manifeste subitement à ce moment où les passions humaines sont portées à leur plus haut degré et qui provoque les persécutions les plus brutales, quoique souvent injustifiées ; et pourtant chacun devrait se dire que l’on court beaucoup plus le risque d’être espionné pendant les longues années du temps de paix, bien que, pour des raisons très naturelles, l’opinion publique n’y attache pas alors autant d’attention.
L’instinct subtil des parasites de l’État que le remous des événements de novembre avait fait monter à la surface, sentit immédiatement qu’une adroite politique d’alliances, qui soutiendrait un soulèvement populaire contre l’oppression et rallumerait ainsi les passions nationales, pourrait mettre un terme à leur criminelle existence.
On comprend maintenant pourquoi ceux qui, depuis 1918, occupaient les postes les plus importants dans le gouvernement, firent preuve d’une telle incapacité dans la politique étrangère et pourquoi les affaires de l’État furent presque toujours gérées d’une façon systématiquement contraire aux intérêts de la nation allemande. Car, ce qui pourrait paraître, au premier regard, l’effet du hasard, se découvre, quand on l’examine de plus près, n’être qu’une nouvelle et logique avance sur la voie dans laquelle la révolution de novembre 1918 s’était déjà ouvertement engagée.
Il est vrai qu’ici on doit faire une distinction entre les administrateurs responsables (ou, pour mieux dire,
« qui devraient l’être ») des affaires de notre État, entre la majeure partie de nos politicailleurs parlementaires, et, enfin, la grande foule moutonnière et stupide de notre peuple dont la patience égale la sottise.
Les premiers savent ce qu’ils veulent. Les autres marchent avec les premiers, soit qu’ils soient initiés, soit qu’ils soient trop lâches pour s’opposer résolument à la réalisation du plan qu’ils ont deviné et dont ils sentent le danger. Les derniers se soumettent par incompréhension et bêtise.
Tant que le Parti national-socialiste des travailleurs allemands n’a été qu’une petite association mal connue, les problèmes de politique étrangère ne pouvaient avoir, aux yeux de beaucoup de ses membres, qu’une importance secondaire. Notamment, parce que notre mouvement a toujours eu, et aura toujours, pour principe fondamental de proclamer que la liberté dont jouit un pays dans ses relations avec l’étranger n’est pas un don gratuit du ciel ou de puissances de la terre, mais ne peut jamais être que le fruit du développement de ses forces propres. Supprimer les causes de notre effondrement, anéantir ceux qui en tirent avantage, voilà ce qui, seul, nous mettra à même d’engager contre l’étranger la lutte pour notre indépendance.
On comprend maintenant pour quelles raisons notre jeune mouvement a, dans les premiers temps, accordé à son plan de réforme intérieure plus d’importance qu’aux questions de politique étrangère.
Mais lorsque cette petite société insignifiante eut agrandi et, finalement, fait éclater son premier cadre, et que la jeune organisation prit l’importance d’une grande association, elle se vit obligée de prendre position à l’égard des problèmes que posait le développement de la politique étrangère. Il lui fallait tracer les lignes directrices qui, non seulement ne seraient pas en contradiction avec les conceptions sur lesquelles reposait notre système philosophique, mais, au contraire, seraient comme une émanation de ces conceptions mêmes.
Précisément, parce que notre peuple manque d’éducation politique en ce qui touche nos relations avec l’étranger, notre jeune mouvement avait le devoir de fournir à tous les dirigeants, ainsi qu’aux masses populaires, un plan, tracé dans ses grandes lignes, qui leur servirait de guide pour étudier les questions de politique étrangère ; c’était là une des premières tâches à remplir pour rendre possible un jour la mise en pratique des mesures préparatoires en politique étrangère, qui permettraient à notre peuple de reconquérir son indépendance et au Reich de recouvrer une souveraineté effective.
Le principe fondamental et directeur que nous devons toujours avoir devant les yeux quand nous étudions cette question est celui-ci : la politique étrangère elle-même n’est que le moyen de parvenir à un but et ce but consiste exclusivement à travailler en faveur de notre peuple. Toute question de politique étrangère ne peut être considérée d’aucun autre point de vue que de celui-ci : Telle solution sera-t-elle avantageuse pour notre peuple, actuellement ou dans l’avenir, ou lui causera-t-elle quelque dommage ?
Voilà la seule opinion préconçue qui puisse entrer en ligne de compte lorsqu’on étudie une de ces questions. On doit éliminer impitoyablement toutes considérations de politique de partis, de religion, d’humanité, bref toutes les autres considérations quelles qu’elles soient.
* * *
Avant la guerre, la politique étrangère de l’Allemagne avait pour tâche d’assurer l’alimentation de notre peuple et de ses enfants en ce monde, en préparant les voies qui permettraient d’atteindre ce but et aussi de nous ménager des alliances apportant le complément de puissance nécessaire ; la tâche est restée la même, mais avec cette différence : avant la guerre il s’agissait de veiller à la conservation du peuple allemand en tenant compte de la puissance dont disposait alors un État fort et indépendant ; aujourd’hui, il s’agit d’abord de rendre à notre peuple la puissance que possède un État fort et libre ; la renaissance d’un tel État est la condition préalable et nécessaire qu’il faut remplir pour pouvoir pratiquer plus tard une politique étrangère efficace et capable de conserver, développer et nourrir notre peuple.
En d’autres termes : Le but que doit poursuivre actuellement la politique étrangère de l’Allemagne, sera de préparer les voies où s’engagera le peuple allemand pour reconquérir un jour son indépendance.
Pour ce faire, il ne faut jamais perdre de vue un principe fondamental : Il n’est pas absolument nécessaire, pour qu’on peuple puisse reconquérir son indépendance, que le territoire de son État forme un tout ; il suffit qu’il subsiste une dernière parcelle, si petite soit-elle, de ce peuple et de cet État qui, jouissant de la liberté nécessaire, puisse non seulement conserver le dépôt de la communauté spirituelle du peuple tout entier, mais encore préparer la lutte qui sera menée par les armes pour reconquérir la liberté.
Quand un peuple de cent millions d’hommes supporte en commun, pour conserver l’intégrité de son État, le joug de l’esclavage, cela est pire que si ce peuple et cet État avaient été démembrés, une de leurs parties restant encore en pleine liberté. En supposant naturellement que cette partie restât pénétrée de la sainte mission qui lui incomberait : non seulement proclamer, sans se lasser, que son peuple est indissolublement uni par son esprit et sa culture, mais aussi prendre les mesures nécessaires pour le préparer à l’emploi des armes dont il aura à se servir pour affranchir définitivement et réunir à nouveau les malheureuses parties de la nation et de l’État encore opprimées.
Il faut réfléchir en outre que, lorsqu’il est question de reconquérir des territoires perdus par un peuple et un État, il s’agit d’abord pour la mère-patrie de reconquérir sa puissance politique et son indépendance ; qu’en pareil cas, les intérêts des territoires perdus doivent être impitoyablement sacrifiés à la seule chose importante : reconquérir la liberté du territoire principal. Car ce ne sont pas les vœux des opprimés ou les protestations des nationaux qui délivreront les fragments d’un peuple ou les provinces d’un Reich, mais bien l’emploi de la force par les restes, demeurés plus ou moins indépendants, de ce qui fut autrefois la patrie commune.
Aussi, pour reconquérir les territoires perdus, la condition préalable à remplir est de donner, par un travail acharné, plus de force et de vigueur à ce qui reste de l’État, ainsi qu’à l’inébranlable résolution, sommeillant dans les cœurs, de consacrer, quand l’heure viendra, au service de la délivrance et de l’union de tout le peuple, la puissance récupérée par l’État. Donc, sacrifice provisoire des intérêts des territoires séparés de la patrie à ce qui a seul de l’importance : conquérir, au profit de ce qui reste de l’État, une puissance politique et une force telles qu’elles permettent de forcer la volonté des ennemis vainqueurs à venir à composition. Car les territoires opprimés ne sont pas réincorporés à la patrie commune par des protestations enflammées, mais par les coups victorieux qu’assène le glaive.
Forger ce glaive, telle est la tâche de la politique intérieure du gouvernement ; permettre au forgeron de travailler en toute sécurité et de recruter des compagnons d’armes, telle est celle de la politique étrangère.
* * *
Je me suis, dans la première partie de cet ouvrage, expliqué sur les insuffisances de la politique d’alliances pratiquée avant la guerre. Il y avait quatre moyens d’assurer pour l’avenir la conservation et l’alimentation de notre peuple ; on avait choisi le quatrième et le moins efficace. Au lieu de pratiquer une intelligente politique territoriale en Europe, on eut recours à une politique coloniale et commerciale. Cette politique était d’autant plus maladroite qu’on se figurait à tort pouvoir éviter ainsi l’obligation de s’expliquer les armes à la main. Le résultat de cette tentative pour s’asseoir sur toutes les chaises était facile à prévoir : on s’assit à côté et la guerre mondiale fut la note des frais qu’eut à acquitter finalement le Reich pour solder les dettes contractées par sa maladroite politique étrangère.
Le meilleur moyen aurait été dès alors le troisième : renforcer la puissance du Reich sur le continent en s’annexant de nouveaux territoires en Europe ; par là même, son extension par l’acquisition ultérieure de territoires coloniaux entrait tout naturellement dans le domaine des possibilités. Il est vrai que, pour pratiquer une telle politique, il lui fallait contracter une alliance avec l’Angleterre ou bien consacrer au développement de sa puissance militaire des ressources tellement démesurées qu’il aurait dû, pendant quarante ou cinquante ans, complètement rejeter au second plan toutes les dépenses de caractère culturel. Il aurait parfaitement pu prendre cette responsabilité. L’importance culturelle d’une nation est presque toujours fonction de son indépendance politique, celle- ci est donc la condition nécessaire pour que celle-là puisse exister ou même pour qu’elle puisse naître. Aussi n’y a-t-il pas de sacrifice qui soit trop lourd quand il s’agit d’assurer la liberté politique d’une nation. Ce que l’on déduit du budget des dépenses de caractère culturel, au profit d’un développement excessif des forces militaires de l’État, pourra être plus tard récupéré avec usure. On peut même dire que, après qu’un État a concentré tous ses efforts sur un seul point : maintenir son indépendance, il se produit d’ordinaire une certaine détente, une sorte de nouvel équilibre en vertu duquel les dons culturels du peuple jusque-là négligés s’épanouissent d’une façon surprenante. La floraison du siècle de Périclès succéda aux misères causées par les guerres contre les Perses, et la république romaine se consacra à la culture d’une civilisation supérieure quand elle fut libérée des inquiétudes que lui avaient inspirées les guerres puniques.
Il est vrai qu’on ne peut attendre d’une majorité de crétins et de propres-à-rien parlementaires l’esprit de décision nécessaire pour subordonner impitoyablement tous les autres intérêts d’un peuple à une seule tâche : préparer une future passe d’armes devant assurer plus tard l’existence de l’État. Tout sacrifier à la préparation de cette passe d’armes, le père d’un Frédéric le Grand en était capable, mais les pères de notre absurde parlementarisme démocratique de fabrication juive ne le peuvent pas.
C’est déjà pourquoi la préparation militaire, permettant la conquête en Europe de nouveaux territoires, ne fut, dans la période précédant la guerre, que très médiocre, de sorte qu’on ne pouvait que difficilement se passer du concours d’alliés judicieusement choisis.
Comme on ne voulait pas se donner la peine de préparer systématiquement la guerre, on renonça à acquérir des territoires en Europe et l’on sacrifia, en pratiquant, en échange, une politique coloniale et commerciale, l’alliance qu’on aurait, sans cela, pu conclure avec l’Angleterre, mais sans s’appuyer, comme il aurait été logique, sur la Russie ; de faux-pas en faux-pas, on aboutit à la guerre mondiale où l’Allemagne entra abandonnée de tous sauf des Habsbourg, ce fléau héréditaire.
* * *
Il faut dire, pour caractériser notre politique étrangère actuelle, qu’elle n’a pas de ligne de conduite visible ou même compréhensible. Si on s’était, avant la guerre, engagé à faux sur la quatrième voie, où l’on n’avait d’ailleurs fait que peu de progrès, il est impossible à l’œil le plus exercé de découvrir celle qu’on suit depuis la révolution. Plus encore qu’avant la guerre, tout système raisonné fait défaut, à moins qu’on ne donne ce nom aux tentatives faites pour enlever à notre peuple la dernière possibilité de relèvement.
Si l’on examine froidement la situation dans laquelle se trouvent aujourd’hui les peuples de l’Europe en ce qui concerne leur puissance respective, on arrive au résultat suivant :
Depuis trois cents ans, l’histoire de notre continent a été dominée par les visées politiques de l’Angleterre ; par l’équilibre des forces qu’elle obtenait, en opposant les unes aux autres les différentes puissances européennes, elle assurait indirectement ses derrières et pouvait, en toute sûreté, atteindre les buts poursuivis par la politique mondiale de la diplomatie britannique.
La tendance traditionnelle de cette diplomatie, qui n’a en Allemagne d’autre équivalent que les traditions de l’armée prussienne, était, depuis le règne de la reine Elisabeth, vouée à la poursuite systématique d’un seul but : empêcher par tous les moyens une grande puissance du continent de s’élever au-dessus du niveau moyen des grandes puissances et, si elle y parvenait, la briser par les armes. Les moyens de force que l’Angleterre avait coutume d’employer en pareil cas variaient suivant la situation donnée ou la tâche à accomplir ; mais la résolution et la force de volonté mises en œuvre étaient toujours les mêmes. Oui ! plus la position de l’Angleterre devint difficile au cours des temps, plus le gouvernement de l’empire britannique jugea nécessaire de maintenir un état de choses où les différents États européens, en rivalisant entre eux de puissance, se paralysaient réciproquement. Quand les colonies anglaises de l’Amérique du Nord se séparèrent de la mère-patrie, celle-ci dut redoubler d’efforts pour couvrir complètement ses derrières du côté de l’Europe. C’est ainsi que, lorsque l’Espagne et la Hollande eurent été anéanties comme grandes puissances maritimes, l’État anglais concentra toutes ses forces contre les visées dominatrices de la France, jusqu’à ce qu’enfin la chute de Napoléon Ier eut fait disparaître le danger que présentait pour l’Angleterre l’hégémonie d’une puissance militaire qu’elle redoutait particulièrement.
L’évolution qu’accomplit la politique britannique à l’égard de l’Allemagne fut très lente, non seulement parce que cette dernière, par suite du défaut d’unité nationale des peuples allemands, ne présentait pas de danger pour l’Angleterre, mais encore parce que l’opinion publique anglaise, tournée par une longue propagande vers le but défini qu’avait jusqu’alors poursuivi son État, ne pouvait être que peu à peu orientée dans un autre sens. Le froid calcul de l’homme d’État doit parfois, pour se réaliser, faire appel au sentiment, moteur qui est plus puissant quand il faut agir et qui résiste mieux à l’usure du temps. L’homme d’État peut, après avoir réalisé un de ses plans, tourner son activité d’esprit vers d’autres projets, mais il faut un lent travail de propagande pour rendre la sensibilité des masses accessible aux nouvelles vues du chef.
L’Angleterre avait arrêté sa nouvelle position dès 1870-1871. Malheureusement, l’Allemagne ne sut pas tirer parti des oscillations qu’éprouva parfois la politique anglaise, par suite de l’importance que prit l’Amérique au point de vue économique et de l’activité que déploya la Russie pour augmenter sa puissance, si bien que les tendances qui prévalaient déjà dans la politique de l’Angleterre s’en trouvèrent renforcées.
L’Angleterre voyait dans l’Allemagne une puissance dont l’importance au point de vue commercial et, par suite, dans la politique mondiale, fondée surtout sur sa gigantesque industrialisation, prenait des proportions si menaçantes que les forces des deux États se balançaient déjà dans les mêmes domaines. La conquête « économique et pacifique » du monde, qui était, aux yeux de ceux qui nous dirigeaient alors, le summum de la suprême sagesse, fut ce qui détermina la politique anglaise à organiser la résistance. Cette résistance se manifesta sous la forme d’une attaque de grande envergure et minutieusement préparée, méthode répondant parfaitement à l’esprit d’une politique qui ne visait pas à maintenir une paix mondiale douteuse, mais à consolider l’hégémonie britannique dans le monde. L’Angleterre prit comme alliés tous les États qui présentaient des garanties au point de vue militaire, parce que sa prudence traditionnelle appréciait à leur juste valeur les forces de son adversaire et qu’elle se rendait compte de l’état de faiblesse où elle se trouvait alors. On ne peut lui reprocher d’avoir agi « sans scrupules », car une aussi vaste préparation d’une guerre ne doit pas être jugée du point de vue héroïque, mais du point de vue de l’utilité. La diplomatie doit être pratiquée de telle sorte qu’un peuple ne soit pas conduit par son héroïsme à sa perte ; elle doit veiller efficacement à sa conservation. Pour parvenir à ce résultat, tout moyen est légitime et ne pas y avoir recours doit être considéré comme un criminel oubli du devoir.
La révolution allemande délivra la politique anglaise des inquiétudes que lui avait causées la menace d’une hégémonie germanique s’étendant sur le monde entier.
L’Angleterre n’avait donc plus d’intérêt à voir l’Allemagne complètement effacée de la carte d’Europe. Au contraire, l’épouvantable effondrement qui se produisit pendant les journées de novembre 1918, plaça la diplomatie anglaise en face d’une situation nouvelle qu’elle n’avait pas d’abord cru possible.
L’empire britannique avait lutté pendant quatre ans et demi les armes à la main pour anéantir la prétendue prépondérance d’une puissance continentale. Un écroulement subit semblait faire disparaître cette puissance de la surface du globe. L’Allemagne manifestait une telle absence de l’instinct de conservation le plus élémentaire que des événements qui s’étaient déroulés en moins de vingt-quatre heures, semblaient avoir bouleversé tout l’équilibre européen : l’Allemagne était anéantie et la France devenait la première puissance continentale de l’Europe.
La propagande intense qui avait, pendant la guerre, donné au peuple anglais la force de tenir, qui lui avait inspiré une haine démesurée à l’égard des Allemands, qui avait soulevé tous ses instincts primitifs et toutes ses passions, allait maintenant peser comme une masse de plomb sur les décisions des hommes d’État britanniques. Le but que l’Angleterre avait poursuivi en faisant la guerre était atteint, puisque l’Allemagne ne pouvait plus pratiquer de politique coloniale, économique et commerciale ; tout ce qui dépassait ce but lésait les intérêts anglais. La disparition de l’Allemagne comme grande puissance de l’Europe continentale ne pouvait que profiter aux ennemis de l’Angleterre. Pourtant la diplomatie anglaise ne put pas exécuter son changement de front pendant les journées de novembre 1918 et jusqu’à la fin de l’été de 1919, parce qu’elle avait, pendant cette longue guerre, fait appel aux sentiments des masses avec une insistance dont elle n’avait jamais encore donné d’exemple. Elle ne le pouvait pas, étant données les dispositions de son propre peuple, elle ne le pouvait pas non plus par suite de la disproportion des forces militaires en présence. La France s’était attribué la conduite des négociations et pouvait imposer sa loi à ses alliés. La seule puissance qui aurait pu, pendant ces mois de négociations et de marchandages, modifier cet état de choses, l’Allemagne elle-même, était en proie aux convulsions de la guerre civile et ne cessait de proclamer, par la bouche de ses prétendus hommes d’État, qu’elle était prête à accepter tout ce qu’on lui imposerait.
Quand, dans les relations internationales, un peuple cesse, par suite de son manque absolu d’instinct de conservation, de pouvoir être un allié « actif », il tombe au rang de peuple esclave et son pays éprouve le sort réservé à une colonie.
Pour éviter que la puissance de la France ne devienne trop prépondérante, l’Angleterre n’avait plus à sa disposition qu’une seule façon d’agir : s’associer à ses brigandages.
En fait, l’Angleterre n’a pas atteint le but qu’elle avait en vue en faisant la guerre. Celle-ci n’a pas écarté le danger que présentait pour l’équilibre des forces sur le continent la prédominance acquise par un État européen, elle ne l’a rendu que plus menaçant.
L’Allemagne, au point de vue militaire, était, en 1914, coincée entre deux pays dont l’un disposait de forces équivalentes et l’autre de forces très supérieures. À cela s’ajoutait la supériorité maritime de l’Angleterre. La France et la Russie, seules, étaient des obstacles suffisants pour empêcher tout accroissement excessif de la grandeur allemande. La situation géographique du Reich, extrêmement défavorable au point de vue militaire, pouvait être, en outre, considérée comme un coefficient de sécurité garantissant contre toute augmentation importante de la puissance de ce pays. La configuration des côtes était, au point de vue militaire, défavorable en cas de lutte contre l’Angleterre ; si la région maritime était peu étendue et resserrée, les frontières terrestres étaient, par contre, beaucoup trop vastes et ouvertes.
La situation de la France est aujourd’hui toute différente : comme puissance militaire, elle est la première et n’a pas sur le continent un seul rival sérieux ; elle est en sûreté au sud derrière les frontières qui la protègent contre l’Espagne et l’Italie ;
l’impuissance de notre patrie lui assure la sécurité du côté de l’Allemagne ; sur une longue étendue de ses côtes, elle est campée en face des centres vitaux de l’empire britannique. Non seulement ceux-ci présentent des buts faciles aux avions et aux canons à longue portée, mais les voies de communication du commerce anglais seraient exposées sans défense aux attaques des sous-marins. Une guerre sous-marine, s’appuyant sur la longue côte de l’Atlantique et sur les rivages étendus que la France possède le long de la Méditerranée en Europe et dans l’Afrique du nord, aurait des conséquences désastreuses pour l’Angleterre.
Ainsi le fruit qu’elle a tiré politiquement de la lutte menée contre l’accroissement de puissance de l’Allemagne a été d’établir l’hégémonie de la France sur le continent ; les résultats, au point de vue militaire, ont été les suivants : l’Angleterre a fortement établi la France comme première puissance sur terre et a dû reconnaître l’Union américaine pour son égale sur mer. Au point de vue économique, elle a cédé à ses anciens alliés des territoires où elle avait des intérêts de première importance.
De même que la politique traditionnelle de l’Angleterre vise à balkaniser l’Europe dans une certaine mesure, celle de la France en veut faire autant à l’égard de l’Allemagne.
Ce que souhaitera toujours l’Angleterre, c’est d’empêcher qu’une puissance continentale quelconque accroisse ses forces au point de pouvoir jouer un rôle important dans la politique mondiale ; elle veut donc maintenir un certain équilibre entre les forces dont disposent les États européens ; car c’est là une des conditions primordiales mises à l’hégémonie de l’Angleterre dans le monde entier.
Ce que souhaitera toujours la France, c’est d’empêcher que l’Allemagne ne forme une puissance homogène ; c’est le maintien d’une fédération de petits États allemands dont les forces s’équilibrent et qui ne soient pas soumis à une autorité centrale ; c’est enfin d’occuper la rive gauche du Rhin : toutes conditions nécessaires pour qu’elle puisse établir et assurer son hégémonie en Europe.
Le but dernier de la diplomatie française sera éternellement en opposition avec les tendances fondamentales de la diplomatie anglaise.
* * *
Quand on examine, en tenant compte des considérations que nous venons d’exposer, les possibilités d’alliances que l’époque actuelle offre à l’Allemagne, on est vite convaincu que tout ce que nous pouvons faire pratiquement, en fait d’alliance, est de nous rapprocher de l’Angleterre. Bien que les conséquences de la politique de guerre suivie par elle aient été, et soient restées, néfastes pour l’Allemagne, on ne doit pas se refuser à constater que l’Angleterre n’a plus aujourd’hui aucun intérêt pressant à ce que l’Allemagne soit anéantie et que, au contraire, l’objectif de la diplomatie anglaise doit être de plus en plus, à mesure que les années s’écoulent, de mettre un frein à l’instinct d’impérialisme démesuré dont est animée la France. Seulement, on ne fait pas une politique d’alliance en s’attardant aux froissements passés ; elle n’est féconde que si l’on profite des leçons données par l’histoire. L’expérience devrait nous avoir appris que les alliances nouées pour la poursuite de buts négatifs souffrent de faiblesse congénitale. Les destinées de deux peuples ne sont solidement soudées que lorsqu’ils ont en vue un succès commun, sous la forme d’acquisitions, de conquêtes communes, bref, d’un accroissement de puissance dont profitera chacun d’eux.
L’inexpérience de notre peuple en fait de politique étrangère transparaît de la façon la plus claire dans les nouvelles de presse quotidiennes, qui parlent de la sympathie plus ou moins grande que tel ou tel homme d’État étranger a manifesté pour l’Allemagne, et qui voient, dans les dispositions que l’on suppose à ces personnages à l’égard de notre peuple, la garantie particulière d’une politique favorable à nos intérêts. Raisonner ainsi, c’est commettre une incroyable absurdité, c’est spéculer sur la sottise sans pareille dont fait preuve le petit bourgeois allemand du type courant quand il parle politique. Il n’y a pas d’homme d’État anglais, américain ou italien, qui ait jamais pris position comme « germanophile ». Tout homme d’État anglais est naturellement en premier lieu Anglais, tout Américain est d’abord Américain et l’on ne trouvera pas d’Italien qui soit prêt à faire une autre politique qu’une politique italianophile. Celui donc qui prétend édifier des alliances sur les dispositions germanophiles des hommes d’État influents de telle ou telle nation étrangère, est un âne ou un menteur. La condition nécessaire pour que les destinées de deux peuples s’enchaînent l’une à l’autre n’est pas une estime ou une sympathie réciproque, mais bien la perspective des avantages que tirera de l’association chacun des contractants. C’est-à-dire qu’un homme d’État anglais, par exemple, pourra pratiquer une politique constamment anglophile et jamais germanophile, mais que des intérêts déterminés de cette politique anglophile pourront, pour les motifs les plus divers, concorder avec les intérêts germanophiles. Ce ne pourra naturellement être le cas que dans une certaine mesure et la situation pourra un jour se trouver complètement renversée ; mais l’art d’un homme d’État dirigeant consiste précisément à trouver, quand il s’agit, à une certaine époque, de réaliser une opération nécessaire, les partenaires qui doivent user des mêmes moyens pour défendre leurs propres intérêts.
L’application pratique de ce principe doit être déduite, pour le temps présent, de la réponse qu’on devra faire aux questions suivantes. Quels États n’ont actuellement aucun intérêt vital à ce qu’une Europe centrale allemande soit complètement mise hors de cause pour permettre à la France d’exercer, économiquement et militairement, une hégémonie incontestée ? Et quels sont les États qui, étant données leurs propres conditions d’existence et l’orientation traditionnelle de leur politique, verraient, dans le développement d’une telle situation, une menace pour leur propre avenir ?
Car il faut qu’on se rende enfin clairement compte de ce fait : l’ennemi mortel, l’ennemi impitoyable du peuple Allemand est et reste la France. Peu importe qui a gouverné ou gouvernera la France ; que ce soient les Bourbons ou les Jacobins, les Napoléons ou les démocrates bourgeois, les républicains cléricaux ou les bolchévistes rouges : le but final de leur politique étrangère sera toujours de s’emparer de la frontière du Rhin et de consolider la position de la France sur ce fleuve, en faisant tous leurs efforts pour que l’Allemagne reste désunie et morcelée.
L’Angleterre désire que l’Allemagne ne soit pas une puissance mondiale ; la France ne veut pas qu’il existe une puissance qui s’appelle l’Allemagne ; la différence est considérable ! Mais, aujourd’hui, nous ne luttons pas pour reconquérir la situation de puissance mondiale ; nous avons à combattre pour l’existence de notre patrie, pour l’unité de notre nation et pour le pain quotidien de nos enfants. Si, tirant la conclusion de ces prémisses, nous passons en revue les alliés que peut nous offrir l’Europe, il ne reste que deux États : l’Angleterre et l’Italie.
L’Angleterre ne désire pas avoir en face d’elle une France, dont le poing armé, que le reste de l’Europe n’est pas capable de repousser, pourrait défendre une politique de nature à contrarier un jour ou l’autre les intérêts anglais. L’Angleterre ne peut jamais désirer avoir affaire à une France que la possession des riches mines de fer et de charbon de l’Europe occidentale mettrait à même de jouer dans l’économie mondiale un rôle dangereux pour elle. Et l’Angleterre ne peut pas non plus souhaiter que la France jouisse dans la politique du continent, grâce au morcellement du reste de l’Europe, d’une situation si sûre qu’il lui soit possible, ou même qu’elle se voie contrainte, de reprendre avec plus d’activité et d’ambition la politique mondiale qui est une des traditions de la diplomatie française. Les bombes de Zeppelin d’autrefois pourraient se multiplier chaque nuit ; la suprématie militaire de la France pèse lourdement sur ce qui forme le cœur de l’empire mondial gouverné par la Grande- Bretagne.
L’Italie non plus ne peut pas désirer que la situation prépondérante, occupée par la France en Europe, soit encore renforcée. L’avenir de l’Italie dépend d’un développement territorial dont les éléments sont groupés autour du bassin méditerranéen. Ce qui a poussé l’Italie à la guerre, ce n’était certainement pas l’envie de travailler à la grandeur de la France, mais l’intention de porter le coup mortel au rival exécré qu’elle avait dans l’Adriatique. Toute augmentation nouvelle de la puissance française sur le continent est, pour l’avenir, un obstacle contre lequel l’Italie pourra se heurter ; aussi ne faut-il jamais se figurer que la parenté de race peut supprimer toute rivalité entre deux peuples.
L’examen le plus réaliste et le plus froid de la situation européenne montre que ces deux États : l’Angleterre et l’Italie, sont, en première ligne, ceux dont les intérêts particuliers les plus naturels ne sont pas, ou sont en dernière analyse le moins lésés, par les conditions nécessaires à l’existence d’une nation allemande, et que ces intérêts concordent même jusqu’à un certain point avec cette existence.
* * *
Nous devons, il est vrai, quand nous jugeons des possibilités de ces alliances, ne pas perdre de vue trois facteurs. Le premier nous concerne, les deux autres concernent les États en question.
Peut-on, en principe, contracter alliance avec l’Allemagne actuelle ? Une puissance qui cherche dans une alliance une aide pour exécuter un plan offensif, peut-elle s’allier à un État dont les gouvernements ont, depuis des années, donné l’image de la plus lamentable incapacité, de la lâcheté pacifiste et chez lequel la grande majorité de la nation, aveuglée par les doctrines démocratiques et marxistes, trahit son propre peuple et son propre pays de la façon la plus révoltante ? Est-ce qu’une puissance quelconque peut espérer actuellement établir des rapports avantageux pour elle avec un État, dans la conviction qu’elle pourra un jour combattre en commun avec lui pour défendre des intérêts communs, lorsque cet État n’a visiblement ni le courage ni l’envie de lever même un doigt pour défendre sa propre vie, sa simple existence ? Est-ce qu’une puissance quelconque, pour laquelle un traité d’alliance est, et doit être, quelque chose de plus qu’un contrat de garantie visant au maintien d’un état de lent dépérissement, comme le fut l’ancienne et désastreuse Triplice, contractera une alliance, valable pour la bonne et la mauvaise fortune, avec un État dont les manifestations les plus caractéristiques sont une servilité rampante à l’égard de l’étranger et, à l’intérieur, l’étouffement ignominieux des vertus nationales ; avec un État qui n’a plus, par la faute de toute sa conduite, rien de grand ; avec des gouvernements qui ne peuvent se vanter de jouir de la moindre estime auprès de leurs concitoyens, de sorte qu’il est impossible aux étrangers d’avoir une grande admiration pour eux ?
Non ! une puissance qui tient à sa réputation et qui cherche dans une alliance quelque chose de plus que des subsides pour des parlementaires affamés de butin, ne s’alliera pas avec l’Allemagne d’aujourd’hui, et même elle ne le peut pas. Notre incapacité actuelle à conclure des alliances est la raison profonde et dernière de la solidarité existant entre les brigands nos ennemis. Comme l’Allemagne ne se défend jamais que par quelques « protestations » enflammées de nos parlementaires d’élite, comme le reste du monde n’a pas de raison pour combattre pour notre défense, comme le bon Dieu a pour principe de ne pas affranchir les peuples sans courage, même les peuples qui n’ont aucun intérêt direct à notre complet anéantissement n’ont rien d’autre à faire que de prendre part aux raids de brigandage des Français, quand ce ne serait que pour empêcher, en s’associant et en participant au pillage, que la France ne continue seule à accroître ses forces.
En second lieu, il ne faut pas méconnaître les difficultés qu’on éprouverait dans les pays qui ont été jusqu’à présent nos ennemis, si l’on entreprenait de changer les dispositions dans lesquelles se trouvent à notre égard les couches profondes de peuples, qui ont subi l’influence d’une propagande atteignant les masses. On ne peut pas présenter pendant des années un peuple comme un ramassis de « Huns », de
« brigands », de « Vandales », etc., et puis, du jour au lendemain, découvrir qu’il est tout le contraire et recommander comme allié de demain l’ancien ennemi.
Il faut encore faire plus attention à un troisième fait dont l’importance est encore plus grande pour la tournure que prendront les futures alliances en Europe.
Si le maintien de l’Allemagne, dans son état actuel d’impuissance, n’a que très peu d’intérêt pour la politique anglaise, il en a un très grand pour la finance juive internationale. La politique anglaise officielle ou, pour mieux dire, traditionnelle et les puissances boursières soumises complètement à l’influence juive poursuivent des buts opposés ; c’est ce que prouvent, avec une particulière évidence, les positions différentes que prennent l’une et les autres sur les questions qui touchent à la politique étrangère de l’Angleterre. La finance juive désire, contrairement aux intérêts réels de l’État anglais, non seulement que l’Allemagne soit radicalement ruinée économiquement, mais encore qu’elle soit, politiquement, réduite complètement en esclavage. En effet, l’internationalisation de notre économie allemande, c’est-à-dire la prise de possession par la finance mondiale juive des forces productrices de l’Allemagne, ne peut être effectuée complètement que dans un État politiquement bolchévisé. Mais pour que les troupes marxistes qui mènent le combat au profit du capital juif international, puissent définitivement casser les reins à l’État national allemand, elles ont besoin d’un concours amical venu du dehors. Aussi les armées de la France doivent donner des coups de boutoir à l’État allemand jusqu’à ce que le Reich, ébranlé dans ses fondations, succombe aux attaques des troupes bolchévistes au service de la finance juive internationale.
C’est ainsi que le juif est celui qui pousse le plus ardemment aujourd’hui à la destruction radicale de l’Allemagne. Tout ce qui, dans le monde entier, s’imprime contre l’Allemagne est écrit par des Juifs, de même que, en temps de paix et pendant la guerre, la presse des boursiers juifs et des marxistes a attisé systématiquement la haine contre l’Allemagne jusqu’à ce que les États aient, les uns après les autres, renoncé à la neutralité et, sacrifiant les vrais intérêts des peuples, soient entrés dans la coalition mondiale qui nous faisait la guerre.
Le raisonnement que tiennent les Juifs est évident. La bolchévisation de l’Allemagne, c’est-à-dire la destruction radicale de la conscience nationale populaire allemande, rendant possible l’exploitation de la force productrice allemande soumise au joug de la finance juive internationale, n’est que le prélude de l’extension toujours plus grande que prendra la conquête du monde entier rêvée par les Juifs. Ainsi que le cas s’est si souvent produit dans l’histoire, l’Allemagne doit être le pivot sur lequel portera cette lutte gigantesque. Si notre peuple et notre État sont les victimes de ces tyrans des peuples que sont les Juifs altérés de sang et avides d’argent, toute la terre sera prise dans les tentacules de ces hydres ; mais si l’Allemagne échappe à leur enlacement, on pourra considérer que le plus grand danger qu’aient jamais couru tous les peuples ne menace plus le monde entier.
S’il est sûr que la juiverie a mis en œuvre toutes ses menées souterraines non seulement pour entretenir l’hostilité que les nations témoignent à l’Allemagne, mais aussi pour l’exacerber autant que possible, il est non moins sûr que cette activité ne concorde que très partiellement avec les vrais intérêts des peuples qu’elle empoisonne. En général, la juiverie n’emploie auprès de chacun des peuples visés par sa propagande que les arguments propres à avoir le plus d’effet sur l’esprit de la nation travaillée par ses émissaires et dont elle connaît parfaitement les façons de voir, ceux dont elle peut se promettre le plus de succès. Auprès de notre peuple dont le sang est extraordinairement adultéré, la juiverie se sert, pour mener le combat dont elle attend la puissance, des idées plus ou moins « cosmopolites », inspirées par l’idéologie pacifiste et qui sont nées dans son cerveau, bref elle se réclame des tendances internationales ; en France, elle tire parti du chauvinisme dont elle a reconnu l’existence et dont elle sait apprécier très exactement la puissance ; en Angleterre, elle met en jeu les intérêts économiques et les considérations de politique mondiale ; bref, elle tire toujours profit de ce qui caractérise essentiellement la tournure d’esprit d’un peuple donné. C’est seulement lorsqu’elle a, par ces divers moyens, conquis une influence décisive sur l’économie et sur la politique qu’elle se libère des liens qu’imposaient à sa propagande ces arguments fictifs et qu’elle dévoile en partie ses buts cachés, ce qu’elle veut et ce pourquoi elle combat. Elle n’en procède qu’avec plus de rapidité à son œuvre de destruction, jusqu’à ce qu’elle ait transformé successivement tous les États en un champ de ruines sur lequel doit régner l’autorité souveraine de l’empire juif éternel.
En Angleterre comme en Italie, le désaccord existant entre les conceptions d’une politique excellente enracinée dans le sol et les projets des financiers juifs internationaux est évident, et saute parfois brutalement aux yeux.
C’est uniquement en France que l’on remarque aujourd’hui un accord secret, plus parfait qu’il n’a jamais été, entre les intentions des boursiers, intentions dont les Juifs sont les représentants, et les vœux d’une politique nationale inspirée par le chauvinisme. Et c’est précisément cette identité de vues qui constitue un immense danger pour l’Allemagne. C’est pour cette raison que la France est, et reste, l’ennemi que nous avons le plus à craindre. Ce peuple, qui tombe de plus en plus au niveau des nègres, met sourdement en danger, par l’appui qu’il prête aux Juifs pour atteindre leur but de domination universelle, l’existence de la race blanche en Europe. Car la contamination provoquée par l’afflux de sang nègre sur le Rhin, au cœur de l’Europe, répond aussi bien à la soif de vengeance sadique et perverse de cet ennemi héréditaire de notre peuple qu’au froid calcul du Juif, qui y voit le moyen de commencer le métissage du continent européen en son centre et, en infectant la race blanche avec le sang d’une basse humanité, de poser les fondations de sa propre domination.
Le rôle que la France, aiguillonnée par sa soif de vengeance et systématiquement guidée par les Juifs, joue aujourd’hui en Europe, est un péché contre l’existence de l’humanité blanche et déchaînera un jour contre ce peuple tous les esprits vengeurs d’une génération qui aura reconnu dans la pollution des races le péché héréditaire de l’humanité.
En ce qui concerne l’Allemagne, le danger que la France constitue pour elle lui impose le devoir de rejeter au second plan toutes les raisons de sentiment et de tendre la main à celui qui, étant aussi menacé que nous, ne veut ni souffrir ni supporter les visées dominatrices de la France.
En Europe, il n’y a, pour tout l’avenir que nous pouvons embrasser du regard, que deux alliés possibles pour l’Allemagne : l’Angleterre et l’Italie.
* * *
Si l’on prend la peine de jeter aujourd’hui un regard en arrière sur la façon dont a été conduite la politique de l’Allemagne depuis la révolution, on ne peut faire autrement, en présence de la maladresse continuelle et incompréhensible de nos gouvernements, que de se prendre la tête entre les mains et de s’abandonner simplement au désespoir, ou bien, soulevé par une ardente indignation, de partir en guerre contre un pareil régime. Ses actes n’ont jamais rien eu d’inconscient, car, ce qui pourrait paraître inimaginable à tout cerveau capable de penser, nos borgnes intellectuels de novembre sont arrivés à le faire : ils ont recherché humblement la faveur de la France. Oui ! pendant toutes ces dernières années, on a, avec l’attendrissante niaiserie d’incorrigibles rêveurs, continuellement tenté de devenir bons amis avec la France, on faisait sans cesse des courbettes devant la « grande nation » et, dans chaque truc perfide du bourreau français, on croyait tout de suite voir les premiers symptômes d’un changement de dispositions. Ceux qui dirigeaient notre politique dans la coulisse n’ont naturellement jamais partagé cette opinion erronée et insane. Pour eux, la bonne entente avec la France était le moyen naturel de saboter toute politique d’alliances efficace. Ils n’avaient jamais eu de doute sur les buts poursuivis par la France et par ceux qui étaient derrière elle. Ce qui les forçait à agir comme s’ils avaient cru sincèrement que le destin de l’Allemagne pouvait éprouver un changement, c’est qu’ils se rendaient compte froidement qu’au cas contraire, notre peuple se serait vraisemblablement engagé sur une autre voie.
Il nous sera naturellement très difficile de faire entrer l’Angleterre comme alliée future dans les rangs de nos partisans. Notre presse juive a toujours su concentrer la haine de notre peuple sur l’Angleterre et plus d’un serin d’Allemand s’est pris, avec la meilleur volonté, aux gluaux tendus par le Juif : on a parlé à tort et à travers de la « renaissance » de la puissance maritime allemande, protesté contre le vol de nos colonies, demandé qu’elles soient reconquises ; tous ces propos fournissaient les matériaux que la canaille juive faisait parvenir à ses congénères anglais et dont s’alimentait une propagande efficace. Nos bourgeois niais qui se mêlent de politique commencent à comprendre vaguement que nous n’avons pas aujourd’hui à lutter pour que l’Allemagne devienne « forte sur mer », etc. Diriger les forces de la nation allemande vers cet objectif, avant d’avoir solidement assuré notre situation en Europe, était déjà une folie avant la guerre. Aujourd’hui, un pareil projet doit être mis au nombre de ces sottises qui, en politique, s’appellent des crimes.
Il y avait vraiment parfois de quoi désespérer quand on voyait avec quel art les Juifs qui tiraient les ficelles savaient amuser notre peuple de questions tout à fait secondaires, provoquaient des manifestations et des protestations, pendant qu’au même moment la France prélevait de nouveaux morceaux de chair sur le corps de notre peuple et minait systématiquement les bases de notre indépendance.
Je dois, à ce propos, parler particulièrement d’un dada que le Juif sut, pendant ces années-là, chevaucher avec une extraordinaire maîtrise : le Tyrol du Sud.
Parfaitement, le Tyrol du Sud. Si je m’occupe ici de cette question, je me réserve le droit d’y revenir encore, car il faudra régler le compte de cette bande de menteurs qui, spéculant sur le manque de mémoire et la sottise des masses de chez nous, se permet de feindre une indignation patriotique plus étrangère à ces imposteurs parlementaires que ne l’est à une pie la notion du respect dû à la propriété d’autrui.
J’insiste sur ce point que j’ai personnellement fait partie des gens qui, lorsque le sort du Tyrol du Sud se décidait – c’est-à-dire depuis août 1914 jusqu’à novembre 1918 – se sont placés là où cette contrée pouvait, elle aussi, être efficacement défendue : dans les rangs de l’armée. J’ai, pendant ces années-là, combattu dans la mesure de mes forces, non pas pour empêcher que le Tyrol du Sud ne fût perdu, mais afin que la patrie le conservât au même titre que n’importe quel autre pays allemand.
Ceux qui n’ont pas pris alors part au combat, ce furent les escarpes parlementaires, toute cette canaille faisant une politique de parti. Au contraire, pendant que nous combattions avec la conviction que, seule, une issue victorieuse de la guerre permettrait au peuple allemand de conserver aussi le Tyrol du Sud, ces traîtres compromettaient la victoire par leurs clabauderies et leurs appels à la révolte, si bien qu’enfin Siegfried succomba, poignardé dans le dos pendant qu’il combattait. Car ce n’étaient naturellement pas les discours incendiaires et hypocrites prononcés par d’élégants parlementaires sur la place de l’Hôtel-de- Ville à Vienne ou devant la Feldherrnhalle à Munich, qui pouvaient assurer à l’Allemagne la possession du Tyrol du Sud, mais seulement les bataillons combattant au front. Ceux qui ont provoqué sa rupture ont trahi le Tyrol, aussi bien que tous les autres territoires allemands.
Ceux qui se figurent que la question du Tyrol du Sud pourra être résolue par des protestations, des déclarations, des défilés pacifiques d’associations, etc., sont ou de parfaites canailles ou des petits bourgeois allemands.
Il faut pourtant arriver à se rendre compte que nous ne pourrons rentrer en possession des territoires perdus ni par des invocations solennelles adressées au Tout-Puissant, ni par les espoirs pieux qu’on fonde sur une Société des Nations, mais seulement par la force des armes.
Toute la question est donc de savoir quels sont ceux qui sont prêts à récupérer les armes à la main les territoires perdus.
En ce qui me concerne, je puis assurer en toute sincérité que je me sentirais encore assez de courage pour prendre part à la reprise du Tyrol du Sud, en me mettant à la tête d’un bataillon de choc, composé de bavards du Parlement et d’autres chefs de partis, ainsi que de quelques conseillers auliques. Le diable sait si je serais heureux de voir quelques shrapnells éclater subitement au-dessus d’une manifestation protestataire d’un genre aussi « enflammé ». Je crois qu’un renard s’introduisant dans un poulailler ne provoquerait pas de caquètements plus éperdus et que la fuite des volailles pour se mettre en sûreté ne serait pas plus rapide que la déroute d’une aussi superbe « réunion de protestation ».
Mais ce qu’il y a de plus méprisable dans cette affaire, c’est que ces messieurs ne croient pas eux- mêmes que les moyens qu’ils emploient puissent donner de résultat. Ils savent très bien, personnellement, combien leurs parades de foire sont inefficaces et inoffensives. Mais ils agissent ainsi parce qu’il est
naturellement plus facile aujourd’hui de bavarder au sujet de la récupération du Tyrol du Sud qu’il ne l’était autrefois de combattre pour le conserver. Chacun fait ce qu’il peut ; alors nous avons versé notre sang, aujourd’hui ces messieurs aiguisent leurs becs.
Le plus délicieux, c’est de voir comme les milieux légitimistes viennois se dressent sur leurs ergots en réclamant aujourd’hui le Tyrol du Sud. Il y a sept ans, leur auguste et illustre dynastie a, par un parjure et une trahison dignes des pires coquins, aidé la coalition mondiale à s’emparer du Tyrol du Sud comme prix de sa victoire. À cette époque, ces milieux ont soutenu la politique de leur dynastie traîtresse et ils se souciaient comme un poisson d’une pomme du Tyrol du Sud ou de toute autre chose. Naturellement, il est plus simple aujourd’hui de recommencer à combattre pour ce territoire, puisque ce combat n’est livré qu’avec des armes « spirituelles », et il est, en tous cas, plus facile de s’enrouer à discourir dans une « réunion de protestation », en manifestant la noble indignation qui remplit votre cœur, et d’attraper la crampe des écrivains en barbouillant un article de journal que d’avoir, pendant l’occupation de la Ruhr, fait, par exemple, sauter des ponts.
La raison pour laquelle certains milieux ont fait, ces dernières années, de la question du Tyrol du Sud, le pivot des rapports germano-italiens, est évidente. Juifs et partisans des Habsbourg ont le plus grand intérêt à contrarier la politique d’alliances de l’Allemagne, car elle pourrait amener un jour la résurrection d’une patrie allemande indépendante. Ce n’est pas par amour du Tyrol qu’on joue cette comédie, qui ne lui est d’aucun secours et lui porte même préjudice, mais par crainte de l’entente qui pourrait s’établir entre l’Allemagne et l’Italie.
C’est simplement par un effet du goût pour le mensonge et la calomnie qui règne dans ces milieux, qu’ils ont l’impudence de présenter les choses de telle façon qu’ils nous accusent d’avoir « trahi » le Tyrol.
Il faut le dire à ces messieurs avec toute la clarté nécessaire : le Tyrol a été trahi, premièrement par tout Allemand qui, ayant tous ses membres, n’a pas, pendant les années 1914-1918, servi quelque part au front et ne s’est pas rendu utile à sa patrie ;
Secondement, par tout homme qui, pendant ces années-là, n’a pas contribué à fortifier dans notre peuple une capacité de résistance lui permettant de continuer la guerre et de soutenir la lutte jusqu’au bout ;
Troisièmement, par tout homme qui a pris part à la révolution de novembre, soit directement par ses actes, soit indirectement par sa lâche complaisance, et qui a ainsi brisé l’arme qui, seule, pouvait sauver le Tyrol du Sud ;
Et quatrièmement, par tous les partis et les membres de ces partis qui ont apposé leur signature au bas des honteux traités de Versailles et de Saint-Germain.
Mais oui ! voilà comment sont les choses, courageux seigneurs, qui ne protestez que par vos discours !
Aujourd’hui, je ne me laisse guider que par une simple considération : on ne récupère pas des territoires perdus avec la langue bien affilée de parlementaires braillards, mais on doit les reconquérir avec une épée bien affilée, c’est-à-dire au prix de combats sanglants.
Or, je n’hésite pas à déclarer que, le sort ayant prononcé, non seulement je ne crois pas possible de reconquérir le Tyrol du Sud par une guerre, mais encore déconseillerais personnellement de le tenter, dans la conviction que cette question ne peut éveiller chez tous les Allemands l’enthousiasme patriotique enflammé qui est la condition de la victoire. Je crois, au contraire, que, si notre sang doit un jour couler, ce serait un crime de le répandre pour libérer deux cent mille Allemands, tandis que, près de nous, plus de sept millions d’autres Allemands languissent sous la domination étrangère (occupation de la Rhénanie) et qu’une artère vitale du peuple allemand (le Rhin) traverse un pays où des hordes nègres prennent leurs ébats.
Si la nation allemande veut mettre fin à un état de choses qui menace de la faire disparaître du sol de l’Europe, elle ne doit pas retomber dans l’erreur commise avant la guerre et se faire un ennemi du monde entier ; elle doit distinguer quel est son plus dangereux ennemi pour lui porter des coups en concentrant toutes ses forces sur lui. Et si cette victoire a pour condition des sacrifices faits sur d’autres points, les futures générations de notre peuple nous les pardonneront. Elles sauront d’autant mieux apprécier notre affreuse détresse, nos profonds soucis et la pénible décision prise alors, que le résultat de nos efforts sera plus éclatant.
Nous devons aujourd’hui nous laisser guider par cette idée maîtresse qu’un État ne peut récupérer les territoires qu’il a perdus que lorsqu’il a d’abord reconquis son indépendance politique et la puissance de la mère-patrie.
Rendre possibles et assurer cette indépendance et cette puissance par une sage politique d’alliances, telle est la première tâche que doit remplir, en ce qui concerne la politique étrangère, un gouvernement énergique.
Mais nous autres nationaux-socialistes devons particulièrement nous garder de nous mettre à la remorque de nos patriotes en paroles, qui sont conduits par les Juifs. Quel malheur ce serait, si notre mouvement, lui aussi, au lieu de préparer la lutte avec l’épée, s’exerçait à faire des protestations.
L’idée fantasque d’une alliance chevaleresque avec le cadavre qu’on appelait l’État des Habsbourg a entraîné la ruine de l’Allemagne. Écouter l’imagination et le sentiment, quand on étudie les possibilités qui s’offrent actuellement à notre politique étrangère, c’est là le meilleur moyen d’empêcher à jamais notre relèvement.
* * *
Il est nécessaire de réfuter maintenant les objections que pourraient soulever les trois questions déjà posées, c’est-à-dire de savoir :
Primo, si l’on pourra s’allier à l’Allemagne actuelle dont la faiblesse est visible à tous les yeux ;
Secondo, si les nations ennemies semblent capables d’opérer une telle conversion ;
Tertio, si l’influence de la juiverie étant donnée, cette influence ne serait pas plus forte que l’intérêt bien entendu et la bonne volonté des autres peuples et ne viendrait pas contrarier et rendre vains tous les projets d’alliances.
Je crois avoir déjà traité suffisamment l’un des deux aspects du premier point. Il va de soi que personne ne voudra s’allier avec l’Allemagne actuelle. Il n’y a pas une puissance au monde qui ose enchaîner son sort à celui d’un État dont les gouvernements ne peuvent inspirer la moindre confiance. Quant à la tentative faite par beaucoup de nos concitoyens qui prétendent trouver, dans le lamentable état moral dont souffre actuellement notre peuple, l’explication de la conduite du gouvernement, ou même son excuse, elle doit être repoussée de la façon la plus décisive.
Il est sûr que le manque de caractère dont témoigne notre peuple depuis six ans est profondément triste ; son indifférence à l’égard des plus graves intérêts de la nation est vraiment désespérante et sa lâcheté crie parfois vengeance au ciel. Seulement, nous ne devons jamais oublier que le peuple en question a, il y a quelques années, donné au monde le plus admirable exemple des plus hautes vertus humaines. Depuis les journées d’août 1914 jusqu’à la fin de cette gigantesque lutte des nations, pas un peuple de la terre n’a témoigné plus de viril courage, de constance opiniâtre et d’abnégation que notre peuple allemand devenu aujourd’hui si pitoyable. Personne ne voudra prétendre que le rôle honteux, joué actuellement par notre peuple, est l’expression des caractères spécifiques de son être intime. Ce que nous voyons autour de nous, ce que nous éprouvons en nous, ce sont les épouvantables conséquences du parjure commis le 9 novembre 1918 ; elles ont porté un trouble profond dans notre intelligence et notre raison. Il est plus vrai que jamais le mot du poète suivant lequel le mal ne peut engendrer à son tour que le mal. Pourtant, même en ce moment, les bonnes qualités fondamentales de notre peuple n’ont pas complètement disparu ; elles sommeillent encore dans les profondeurs de la conscience et l’on a pu voir parfois, comme des éclairs silencieux sillonnant un ciel drapé de noir, rayonner des vertus dont la future Allemagne se souviendra un jour comme des premiers symptômes d’une convalescence à son début. Plus d’une fois se sont trouvés des milliers et des milliers de jeunes Allemands, qui étaient résolus à sacrifier volontairement et joyeusement, comme en 1914, leurs tendres années sur l’autel de leur chère patrie. Des millions d’hommes ont recommencé à travailler avec la même application et le même zèle que s’il n’y avait jamais eu de ruines causées par la révolution. Le forgeron se retrouve devant son enclume, le paysan marche derrière sa charrue et le savant est assis dans son cabinet : tous font leur devoir avec les mêmes efforts et le même dévouement.
L’oppression dont nous font souffrir nos ennemis, on ne la prend plus, comme autrefois, avec des éclats de rire, mais on en ressent amertume et colère. Il n’est pas douteux que les dispositions ont beaucoup changé.
Si cette évolution des esprits ne se manifeste pas encore sous la forme d’une résurrection de l’idée de puissance politique et d’instinct de conservation, la faute en est à ceux qui, depuis 1918, gouvernent notre peuple pour sa perte, moins par un décret du ciel que de leur propre autorité.
Certes, quand on plaint aujourd’hui notre nation, on devrait pourtant se demander : Qu’a-t-on fait pour la corriger ? Est-ce que le peu d’appui que le peuple a donné aux décisions de nos gouvernements – qui d’ailleurs existaient à peine – est un signe de la faible vitalité de notre nation, ou n’est-ce pas plutôt la preuve que la méthode employée pour conserver ce bien précieux a complètement échoué ? Qu’ont fait nos gouvernements pour que renaisse dans ce peuple un esprit de fierté nationale, de virilité hautaine et de haine, fille de la colère ?
Lorsqu’en 1919, le traité de paix fut imposé au peuple allemand, on aurait eu le droit d’espérer que cet instrument d’une oppression sans limites aurait éveillé chez notre peuple allemand un violent désir de liberté.
Les traités de paix dont les exigences frappent les peuples comme des coups de fouet agissent souvent comme les premiers roulements de tambour annonçant le prochain soulèvement.
Quel parti n’aurait-on pas pu tirer du traité de paix de Versailles !
Cet instrument d’exactions sans mesure et d’un honteux avilissement aurait pu, dans les mains d’un gouvernement voulant s’en servir, être le moyen de porter les passions nationales à leur plus haut degré. Si une propagande de grand style avait su se servir des cruautés commises avec un plaisir sadique, elle aurait transformé l’indifférence de tout un peuple en indignation révoltée et cette indignation se serait élevée jusqu’à la fureur !
Comme il était facile de graver ces faits en traits de feu dans le cerveau et dans le cœur de notre peuple pour qu’enfin la honte éprouvée en commun et la haine commune deviennent, chez soixante millions d’hommes et de femmes, un torrent de flammes, une fournaise où se serait trempée une volonté d’acier et d’où serait sorti le cri :
Nous voulons retrouver des armes !
Certes, voilà à quoi peut servir un pareil traité de paix. L’oppression sans mesure qu’il faisait peser sur nous, l’impudence de ses exigences fournissaient les armes les plus efficaces à une propagande visant à faire sortir de leur engourdissement les esprits vitaux de notre nation.
Mais alors il faut que tout imprimé, depuis l’alphabet dans lequel l’enfant apprend à lire jusqu’au dernier journal, que tout théâtre et tout cinéma, toute colonne d’affiches et toute palissade libre soient mis au service de cette unique et grande mission, jusqu’à ce que l’invocation pusillanime que nos associations de patriotes adressent aujourd’hui au ciel : « Seigneur, rends-nous libres », se transforme dans le cerveau du plus petit enfant en cette ardente prière : « Dieu Tout- Puissant, bénis un jour nos armes ; sois aussi juste que tu le fus toujours ; décide maintenant si nous méritons la liberté ! Seigneur, bénis notre combat ! »
On a laissé passer toutes les occasions favorables et l’on n’a rien fait.
Qui s’étonnera donc si notre peuple n’est pas ce qu’il devrait et pourrait être ? Si le reste du monde ne voit en nous que le bas valet, le chien soumis qui lèche avec reconnaissance la main qui vient de le battre ?
Il est sûr que notre capacité à conclure des alliances est compromise actuellement par la faute de notre peuple, mais elle l’est encore plus par celle de nos gouvernements. Si, après huit ans de l’oppression la plus effrénée, notre peuple manifeste si peu sa volonté d’être libre, la faute en est à la perversité de nos gouvernements.
Pour que notre peuple puisse pratiquer une active politique d’alliances, il est nécessaire qu’il remonte dans l’estime des autres peuples et cette réhabilitation dépend de l’existence, en Allemagne, d’une autorité gouvernementale qui ne soit pas la servante très humble des États étrangers, le chef de corvée mettant à leur service nos propres forces ; il faut un gouvernement qui soit le héraut de la conscience nationale.
Quand notre peuple aura un gouvernement qui verra là sa mission, il ne se passera pas six ans avant qu’une direction hardie donnée à la politique étrangère du Reich ne trouve à s’appuyer sur la volonté aussi hardie d’un peuple altéré de liberté.
* * *
La seconde objection, celle qui fait remarquer combien il est difficile de transformer des peuples ennemis en alliés cordiaux, peut être ainsi réfutée :
La psychose germanophobe générale que la propagande de guerre a développée artificiellement dans les autres pays existera fatalement tant que le Reich n’aura pas, par la renaissance chez le peuple allemand de la conscience nationale, recouvré les traits caractéristiques d’un État qui joue sa partie sur l’échiquier européen et avec lequel il est possible de jouer. C’est seulement lorsque notre gouvernement et notre peuple auront donné l’impression qu’on peut, en toute sécurité, conclure une alliance avec eux, que l’une ou l’autre puissance sera, si ses intérêts sont parallèles aux nôtres, amenée à modifier son opinion publique par l’effet d’une propagande contraire. Mais un pareil résultat exige naturellement des années d’un travail persévérant et habile. C’est précisément parce qu’un long temps est nécessaire pour changer l’orientation de l’opinion chez un autre peuple, qu’il ne faut tenter l’entreprise qu’après mûre réflexion, c’est-à-dire quand on sera absolument convaincu que ce travail vaut la peine de le poursuivre et qu’il portera des fruits dans l’avenir. On ne devra pas, en se fiant aux vaines hâbleries d’un Ministre des affaires étrangères, plus ou moins intelligent, entreprendre de changer les dispositions morales d’une nation, sans avoir la garantie tangible que les dispositions nouvelles auront une réelle valeur. Sinon on porterait la plus complète confusion dans l’opinion publique. Ce qui garantit de la façon la plus sûre qu’il sera possible plus tard de conclure une alliance avec un autre État, ce ne sont pas les propos ampoulés de quelques ministres isolés, mais la stabilité manifeste de tendances gouvernementales bien définies et qui semblent favorables, et aussi une opinion publique orientée dans le même sens. La confiance qu’on pourra avoir dans la réalisation de ces deux postulats sera d’autant plus fondée que l’autorité gouvernementale s’emploiera avec plus d’activité à préparer et à développer par sa propagande le revirement de l’opinion publique et que, inversement, les tendances de cette dernière se reflèteront plus manifestement dans celles du gouvernement.
Un peuple – qui est dans notre situation – ne sera tenu pour capable de conclure des alliances que lorsque le gouvernement et l’opinion publique proclameront et manifesteront par leurs actes la volonté fanatique de combattre pour reconquérir leur liberté. Telle est la condition préalable à remplir avant d’entreprendre de modifier l’opinion publique dans d’autres États qui seraient disposés, pour défendre leurs intérêts les plus personnels, à suivre la même route que le partenaire dont le concours leur semblerait utile, bref à conclure une alliance.
Mais il y a encore un point à considérer : Changer les dispositions morales bien arrêtées d’un peuple étant une pénible tâche dont beaucoup ne comprendront pas d’abord le but, c’est à la fois un crime et une sottise que de fournir, par les fautes qu’on peut commettre, des armes dont se serviront les adversaires pour contre- attaquer.
Il faut qu’on comprenne qu’il se passera nécessairement un temps assez long avant qu’un peuple ait complètement compris les intentions secrètes de son gouvernement, parce que celui-ci ne peut donner d’éclaircissements sur les buts finaux du travail de préparation politique auquel il se livre et doit compter ou bien sur la confiance aveugle des masses ou bien sur l’intuition des classes dirigeantes intellectuellement plus développées. Mais, comme cette clairvoyance, ce tact politique et la faculté de divination n’existent pas chez beaucoup de gens et que des raisons politiques ne permettent pas de donner des explications, une partie des guides intellectuels de la nation se tournera toujours contre les nouvelles tendances dans lesquelles on verra simplement des expériences, faute d’en pénétrer le sens. C’est ainsi qu’elles soulèveront l’opposition des éléments conservateurs de l’État auxquels elles sembleront inquiétantes.
Aussi est-ce un devoir pressant d’enlever, aux mains des gens qui gêneraient les travaux d’approche devant amener deux peuples à se comprendre réciproquement, le plus grand nombre possible des armes qui pourraient leur servir, particulièrement quand il s’agit, comme dans notre cas, des bavardages prétentieux et fantaisistes des associations patriotiques et des petits bourgeois qui font de la politique à une table de café. Car il suffit de réfléchir un peu pour reconnaître que les cris qu’on pousse pour réclamer une nouvelle flotte de guerre, la récupération de nos colonies, etc., ne sont en réalité que de sots bavardages, qui ne contiennent aucune idée pratiquement réalisable. On ne peut pas considérer comme avantageuse pour l’Allemagne la façon dont la politique anglaise tire parti des épanchements absurdes de ces champions de la protestation dont les uns sont inoffensifs, les autres détraqués, mais qui tous travaillent sourdement pour nos ennemis mortels. On s’épuise en démonstrations des plus nuisibles contre Dieu et le monde entier, et on oublie le principe fondamental, qui est la condition de tout succès : « Ce que tu fais, fais-le complètement. En hurlant contre cinq ou dix États, on néglige de concentrer toutes nos forces morales et physiques pour frapper au cœur notre plus infâme ennemi et l’on sacrifie la possibilité de nous renforcer par des alliances avant d’entreprendre ce règlement de compte.
Ici encore, le mouvement national-socialiste a une mission à remplir. Il doit enseigner à notre peuple à ne pas arrêter son regard sur les petites choses et à ne considérer que les plus importantes, à ne pas disperser ses efforts sur des objets secondaires, et à ne pas oublier que ce pour quoi nous avons aujourd’hui à lutter, c’est l’existence même de notre peuple et que le seul ennemi que doivent viser nos coups est et reste la puissance qui nous ravit cette existence.
Il se peut que nous ayons à nous imposer de durs sacrifices. Mais ce n’est pas une raison pour refuser d’écouter la raison et pour nous disputer avec le monde entier, en poussant des cris insensés, au lieu de concentrer nos forces contre notre plus dangereux ennemi.
D’ailleurs le peuple allemand n’a pas moralement le droit d’accuser l’attitude qu’observe le reste du monde à son égard, tant qu’il n’aura pas demandé des comptes aux criminels qui ont vendu et trahi leur propre pays. Ce n’est pas faire preuve d’une conviction respectable que de lancer de loin des injures et des protestations contre l’Angleterre, l’Italie, etc., et de laisser se promener librement parmi nous les canailles qui, en se mettant à la solde de la propagande de guerre de nos ennemis, nous ont arraché nos armes, brisé moralement les reins et ont vendu pour trente deniers le Reich réduit à l’impuissance.
L’ennemi ne fait que ce qui était à prévoir. Son attitude et ses actes devraient nous servir de leçon.
Si l’on n’est pas capable de s’élever à la hauteur de ce point de vue on doit se rendre compte qu’il n’y a plus qu’à désespérer, du moment qu’il faut renoncer à pratiquer à l’avenir toute politique d’alliances. Car, si nous ne voulons pas nous allier à l’Angleterre, parce qu’elle nous a volé nos colonies, ni avec l’Italie, parce qu’elle occupe le Tyrol du Sud, ni avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, parce qu’elles sont la Pologne et la Tchécoslovaquie, il ne nous restera plus d’autre allié possible en Europe que la France, qui, soit dit en passant, nous a volé l’Alsace et la Lorraine.
Il est douteux que cette façon d’agir soit très favorable aux intérêts du peuple allemand. En tous cas, on peut toujours se demander si une pareille opinion est défendue par un imbécile ou par un habile charlatan.
Quand il s’agit des chefs, je penche toujours pour la seconde hypothèse.
Un changement des dispositions morales de quelques peuples, qui ont été jusqu’à présent nos ennemis et dont les vrais intérêts concorderont dans l’avenir avec les nôtres, peut, autant que le jugement humain est capable de décider, très bien se produire, si la force intérieure de notre État et notre volonté manifeste de défendre notre existence font de nous des alliés dont le concours a quelque valeur et si, en outre, nos propres maladresses ou même des actes criminels ne fournissent plus des aliments à la propagande des adversaires de ces projets d’alliances avec d’anciens ennemis.
* * *
C’est à la troisième objection qu’il est le plus difficile de répondre.
Peut-on penser que les représentants des véritables intérêts des nations avec lesquelles une alliance est possible, pourront en venir à leurs fins contre la volonté du Juif, cet ennemi mortel des États populaires et nationaux indépendants ?
Par exemple, la politique anglaise traditionnelle est- elle ou non de force à vaincre l’influence funeste de la juiverie ?
Il est, nous venons de le dire, très difficile de répondre à cette question. Elle dépend de trop de facteurs pour qu’on puisse porter sur elle un jugement définitif. En tous cas, une chose est sûre : dans un seul État, le pouvoir exécutif peut être considéré comme si solidement établi et si absolument mis au service des intérêts du pays, qu’on ne peut plus dire que les forces de la juiverie internationale soient capables de contrarier efficacement la politique jugée nécessaire par le gouvernement.
Le combat que l’Italie fasciste mène, peut-être au fond sans en avoir conscience (mais, pour ma part, je ne le crois pas), contre les trois principales armes des Juifs est la meilleure preuve qu’on peut, même par des procédés indirects, briser les crochets venimeux de cette puissance qui s’élève au-dessus des États. L’interdiction des sociétés secrètes maçonniques, les poursuites dirigées contre la presse internationale, ainsi que la suppression définitive du marxisme international et, inversement, la consolidation progressive de la conception fasciste de l’État mettront, à mesure que les années s’écouleront, le gouvernement italien de plus en plus à même de défendre les intérêts du peuple italien, sans s’inquiéter des sifflements de l’hydre juive qui menace le monde entier.
Les choses se présentent moins bien en Angleterre. Dans ce pays de la « plus libre démocratie », le Juif exerce une dictature presque absolue par le détour de l’opinion publique. Et, pourtant, il se livre aussi dans ce pays un combat ininterrompu entre les représentants des intérêts de l’État anglais et les champions de la dictature mondiale exercée par les Juifs.
La violence avec laquelle se heurtant souvent ces deux courants contraires s’est manifestée pour la première fois de la façon la plus claire après la guerre, dans les positions différentes qu’ont prises le gouvernement anglais, d’une part, et la presse, de l’autre, en face du problème japonais.
Sitôt la guerre finie, l’ancienne hostilité réciproque qui sépare l’Amérique et le Japon a recommencé à se manifester. Naturellement, les grandes puissances européennes ne pouvaient pas se cantonner dans l’indifférence en présence de ce nouveau danger de guerre. Toute la parenté de race n’empêche pas l’Angleterre d’éprouver un certain sentiment d’envie et d’inquiétude au spectacle des progrès que font les États- Unis dans toutes les branches de l’économie et de la politique internationales. Cette ancienne colonie, cet enfant de la métropole semble donner naissance à un nouveau maître du monde. On comprend qu’aujourd’hui l’Angleterre, inquiète et soucieuse, passe en revue ses anciennes alliances et que la politique anglaise voie arriver avec angoisse le moment où l’on ne dira plus :
« L’Angleterre règne sur les mers », mais : « Les mers des États-Unis ».
Le gigantesque État de l’Amérique du Nord, avec les énormes richesses qu’il tire d’une terre vierge, est moins vulnérable que le Reich encerclé d’ennemis. Si les dés devaient être jetés pour la partie décisive, l’Angleterre serait perdue au cas où elle serait réduite à ses seules forces. C’est pourquoi elle saisit avidement le poing jaune et se cramponne à une alliance qui est peut- être impardonnable au point de vue de la race, mais qui, au point de vue politique, est le seul moyen que l’Angleterre ait à sa disposition pour renforcer sa situation dans le monde en face des ambitions du continent américain.
Tandis que le gouvernement anglais ne se décidait pas à relâcher le lien qui l’unissait à son partenaire asiatique, malgré la lutte qu’il menait en commun avec le continent américain sur les champs de bataille de l’Europe, toute la presse juive attaqua par derrière cette alliance.
Comment est-il possible que les organes juifs aient été jusqu’en 1918, les fidèles valets d’armes de l’Angleterre en lutte contre le Reich allemand et que, tout d’un coup, ils commettent la félonie de suivre leur propre chemin ?
L’anéantissement de l’Allemagne était conforme aux intérêts, non pas de l’Angleterre, mais surtout des Juifs, de même qu’aujourd’hui l’anéantissement du Japon servirait moins les intérêts de l’État anglais que les vastes projets des chefs qui espèrent faire régner la domination juive sur le monde entier. Pendant que l’Angleterre fait tous ses efforts pour conserver sa position dans ce monde, le Juif prépare l’attaque qui lui permettra de conquérir ce même monde.
Il constate que les États européens sont déjà dans sa main des instruments passifs, qu’il les domine par le détour de ce qu’on appelle la démocratie occidentale ou bien directement par le bolchévisme russe. Mais il ne lui suffit pas de tenir l’Ancien Monde dans ses rets ; le même sort menace le Nouveau Monde. Les Juifs sont les maîtres des puissances financières des États-Unis. Chaque année, les forces productrices d’un peuple de cent vingt millions d’âmes passent un peu plus sous leur contrôle ; ils sont très peu nombreux ceux qui, à la grande colère des Juifs, restent encore absolument indépendants.
Avec une perfide habileté, ils pétrissent l’opinion publique et en font l’instrument de leur grandeur future.
Les meilleurs cerveaux de la juiverie croient déjà voir approcher le moment où sera réalisé le mot d’ordre donné par l’Ancien Testament et suivant lequel Israël dévorera les autres peuples.
S’il restait encore, au milieu du grand troupeau des pays dénationalisés et devenus colonies juives, un seul État indépendant, toute l’entreprise pourrait échouer à la dernière heure. Car un monde bolchévisé ne peut subsister que s’il embrasse tout le globe.
S’il reste un seul État possédant encore son énergie et sa grandeur nationales, l’empire mondial que veulent édifier les satrapes juifs sera vaincu, comme toute tyrannie ici-bas, par la force de l’idée nationale.
Or, le Juif sait trop bien que, s’il a pu, en s’adaptant pendant mille ans aux circonstances extérieures, saper par la base les peuples d’Europe et en faire des métis qui n’appartiennent plus à aucune espèce définie, il n’est pas à même de faire subir le même sort à un État national asiatique tel que le Japon. Il peut aujourd’hui singer l’Anglais, l’Américain et le Français, mais il ne peut combler le gouffre qui le sépare d’un jaune d’Asie. C’est pourquoi il tente de briser l’État national japonais avec l’aide d’autres États de même sorte, pour se débarrasser d’un adversaire dangereux, afin que ce qui subsistera d’autorité gouvernementale devienne, dans ses mains, un pouvoir régnant despotiquement sur des êtres sans défense.
Il redoute la présence d’un État national japonais dans son royaume juif de mille ans et désire que la ruine de cet État précède l’établissement de sa propre dictature.
Voilà pourquoi il ameute aujourd’hui les peuples contre le Japon, comme il le faisait précédemment contre l’Allemagne. Et il pourra arriver qu’au moment où la diplomatie anglaise continuera à se reposer sur l’alliance avec le Japon, la presse juive de langue anglaise prêchera la lutte contre cet allié et préparera contre lui une guerre d’extermination, au nom des principes démocratiques et en poussant le cri de ralliement : « À bas le militarisme et l’impérialisme japonais ! »
Voilà d’où vient l’insubordination du Juif en Angleterre.
C’est donc dans ce pays que commencera la lutte contre le danger que les Juifs font courir au monde entier.
Ici encore, le mouvement national-socialiste aura à remplir une de ses tâches les plus importantes :
Il doit ouvrir les yeux de notre peuple sur ce que sont les nations étrangères et de cesser de lui rappeler quel est le véritable ennemi du monde actuel. Au lieu de prêcher la haine des peuples aryens, dont presque tout peut nous séparer, mais auxquels nous unissent la communauté du sang et les grandes lignes d’une civilisation identique, il dénoncera à la colère de tous l’ennemi malfaisant de l’humanité, dans lequel il montrera le véritable auteur de tous nos maux.
Mais il doit veiller à ce qu’au moins notre pays sache quel est son plus mortel ennemi et faire en sorte que le combat, mené par nous contre lui, soit comme une étoile annonciatrice des temps nouveaux qui montrera aux autres peuples la voie où ils doivent s’engager pour le salut d’une humanité aryenne militante.
Pour le reste, que la raison soit notre guide et la volonté notre force ! Que le devoir sacré qui dicte nos actes nous donne la persévérance et que notre foi reste pour nous la protectrice et la maîtresse suprême !
Chapitre 14 – Orientation vers l’Est ou politique de l’Est
Deux raisons m’incitent à examiner d’une façon particulièrement attentive les relations entre l’Allemagne et la Russie :
1° Il s’agit d’abord là des circonstances les plus décisives peut-être de la politique étrangère allemande en général.
2° Cette question est aussi la pierre de touche de la clairvoyance et de la justesse de l’action du jeune parti national-socialiste.
Je dois avouer que le deuxième point surtout m’emplit souvent d’un amer souci. Notre jeune mouvement tire moins ses effectifs du camp des indifférents que de celui des doctrines souvent extrémistes ; il n’est que trop naturel que pèsent sur ces hommes, pour la compréhension de la politique étrangère, les partis pris et le faible entendement des cercles politiques ou doctrinaux auxquels ils appartenaient précédemment. Et ceci ne s’applique pas seulement aux hommes qui nous viennent de la gauche. Au contraire. Quelque nuisible que puisse être l’enseignement qu’ils ont reçu sur de tels problèmes, il n’est pas rare qu’il ait été, tout au moins en partie, contrebalancé par un reste de sain instinct naturel. Il suffit alors de substituer une influence meilleure à celle qui s’exerçait précédemment et l’on reconnaît souvent comme les plus utiles alliés les tendances saines et le vigoureux instinct de conservation qu’ils ont su garder.
Il est beaucoup plus difficile, par contre, d’amener à des conceptions politiques nettes un homme dont l’éducation correspondante n’a pas été moins folle et moins illogique, mais qui, par-dessus le marché, a sacrifié sur l’autel de l’objectivité le dernier vestige de son instinct naturel. Ce sont précisément ceux qui appartiennent à nos milieux dits éclairés qu’il est le plus difficile d’amener à prendre fait et cause d’une façon claire et logique pour leurs intérêts et les intérêts de leur peuple, à l’extérieur. Non seulement pèse sur eux le fardeau accablant des conceptions et des préventions les plus extravagantes, mais ils ont, au-delà de toute limite, perdu toute propension à suivre l’instinct de conservation. Le mouvement national-socialiste doit aussi soutenir de pénibles luttes avec ces hommes, luttes pénibles parce que, malgré leur impuissance malheureusement complète, ces gens sont souvent possédés d’une extraordinaire présomption qui les incite à regarder les autres de haut, contre toute justice, et même s’ils ont affaire à meilleurs qu’eux.
Ces arrogants personnages, qui connaissent tout mieux que les autres, sont absolument incapables de rien examiner ou peser de sang-froid, condition essentielle cependant en politique extérieure pour tenter ou réaliser quoi que ce soit.
Comme ces milieux commencent justement à faire dévier notre politique extérieure de la façon la plus désastreuse, en la détournant de toute défense effective des intérêts racistes de notre peuple pour la mettre au service de leur fantasque idéologie, je me sens obligé de traiter d’une façon toute particulière, devant mes partisans, la question la plus importante de notre politique extérieure, à savoir notre attitude à l’égard de la Russie ; je le ferai aussi complètement que l’exige la compréhension universelle, pour autant que le cadre de cet ouvrage le permet. À ce propos, je ferai encore l’observation générale préalable suivante :
Si nous devons entendre par politique extérieure la réglementation des rapports d’un peuple avec le reste du monde, cette réglementation sera conditionnée par des faits tout à fait précis. Nationaux-socialistes, nous pouvons encore énoncer, au sujet de la politique extérieure d’un État raciste, le principe suivant :
La politique extérieure de l’État raciste doit assurer
les moyens d’existence sur cette planète de la race que groupe l’État, en établissant un rapport sain, viable et conforme aux lois naturelles entre le nombre et l’accroissement de la population d’une part, l’étendue et la valeur du territoire d’autre part.
De plus, on ne doit considérer comme rapport sain que la situation dans laquelle l’alimentation d’un peuple est assurée par les seules ressources de son propre territoire. Tout autre régime, durerait-il des siècles et des millénaires, n’en est pas moins malsain et, tôt ou tard, arrive à causer un préjudice, sinon la ruine, du peuple considéré.
Seul, un espace suffisant sur cette terre assure à un peuple la liberté de l’existence.
De plus, on ne peut juger de l’étendue nécessaire d’un territoire de peuplement d’après les seules exigences du temps présent, ni même d’après l’importance de la production agricole, rapportée au chiffre de la population. Car, ainsi que je l’ai déjà exposé dans le premier volume, dans le chapitre : « La politique allemande d’alliances avant la guerre », à l’importance de l’étendue territoriale d’un État comme source directe de son alimentation s’ajoute l’importance au point de vue militaire et politique. Quand un peuple voit sa subsistance garantie par l’étendue de son territoire actuel, il est néanmoins nécessaire encore de penser assurer la sécurité de celui- ci. Celle-ci résulte de la puissance politique d’ensemble de l’État, puissance qui est directement fonction de la valeur militaire de sa situation géographique.
Le peuple allemand ne saurait envisager son avenir qu’en tant que puissance mondiale. Durant près de deux mille ans, la gestion des intérêts de notre peuple, comme nous devons appeler notre plus ou moins heureuse activité politique extérieure, faisait partie intégrante de l’histoire mondiale. Nous-mêmes en avons été témoins : car la gigantesque lutte des peuples de 1914 à 1918 n’était autre chose que la lutte du peuple allemand pour son existence sur le globe terrestre ; nous qualifions nous-mêmes cet événement de guerre mondiale.
Le peuple allemand s’engagea dans ce combat comme une soi-disant puissance mondiale. Je dis « soi- disant », car, en réalité, il n’en était pas une. Si, en 1914, il y avait eu un rapport différent entre la superficie de son territoire et le chiffre de sa population, l’Allemagne aurait réellement été une puissance mondiale et la guerre, abstraction faite des autres facteurs, aurait pu avoir une issue favorable.
Ce n’est point ma tâche, ni même mon intention, d’indiquer ce qui se serait produit si sans le mais qui intervint.
Toutefois, je considère comme absolument nécessaire d’exposer la situation sans fard et en toute simplicité et d’insister sur les inquiétants points faibles pour répandre, tout au moins dans le parti national- socialiste, une vue plus claire des nécessités.
Aujourd’hui, l’Allemagne n’est pas une puissance mondiale. Même si notre impuissance militaire momentanée venait à cesser, nous ne pourrions plus prétendre à ce titre. Quelle peut être sur notre planète l’importance d’une création aussi lamentable, en ce qui touche le rapport du chiffre de sa population à la surface de son territoire, que l’actuel Reich allemand ? À une époque où peu à peu chaque fraction de cette terre est attribuée à quelque État – et quelques-uns embrassent presque des continents – on ne saurait parler de puissance mondiale, quand il s’agit d’une formation politique dont la métropole est limitée à une ridicule surface d’à peine cinq cent mille kilomètres carrés.
Si nous ne considérons que le point de vue purement territorial, la superficie du territoire allemand disparaît entièrement en regard de ce que l’on appelle les puissances mondiales. Et l’on ne doit pas présenter l’Angleterre comme preuve du contraire, car la métropole anglaise n’est, à vrai dire, que la grande capitale de l’empire mondial anglais, qui s’étend presque sur le quart de la surface du globe.
Nous devons encore considérer en première ligne comme États géants les États-Unis, puis la Russie et la Chine. Il s’agit là de formations territoriales qui, pour partie, ont une surface plus de dix fois supérieure à celle de l’empire allemand actuel. La France même doit être comptée au nombre de ces États. Non seulement du fait qu’elle complète son armée, dans une proportion toujours croissante, grâce aux ressources des populations de couleur de son gigantesque empire, mais aussi du fait que son envahissement par les nègres fait des progrès si rapides que l’on peut vraiment parler de la naissance d’un État africain sur le sol de l’Europe. La politique coloniale de la France d’aujourd’hui n’est pas à comparer avec celle de l’Allemagne de jadis. Si l’évolution de la France se prolongeait encore trois cents ans dans son style actuel, les derniers restes du sang franc disparaîtraient dans l’État mulâtre africano- européen qui est en train de se constituer : un immense territoire de peuplement autonome s’étendant du Rhin au Congo, rempli de la race inférieure qui se forme lentement sous l’influence d’un métissage prolongé. C’est là ce qui distingue la politique coloniale française de l’ancienne politique coloniale allemande.
Cette dernière était toute en demi-mesures, comme tout ce que nous faisions. Elle n’a ni agrandi les territoires de peuplement de la race allemande, ni entrepris la tentative – encore que criminelle – de
renforcer la puissance du Reich par un recours au sang noir. Les Ascaris de l’Afrique orientale allemande furent un timide essai dans cette voie. En réalité, ils servirent seulement à la défense de la colonie même. L’idée de transporter des troupes noires sur un théâtre européen d’opérations, abstraction faite de son impossibilité manifeste durant la guerre mondiale, n’a jamais existé, même comme un projet appelé à se réaliser en cas de circonstances favorables ; au contraire, chez les Français, elle a de tous temps été considérée comme une des raisons profondes de leur activité coloniale.
Ainsi nous voyons aujourd’hui sur la terre un certain nombre de puissances qui non seulement, pour certaines, l’emportent de loin par le chiffre de leur population sur notre peuple allemand, mais qui trouvent surtout dans leur étendue territoriale la principale raison de leur prépondérance.
Jamais encore la comparaison entre l’empire allemand et les autres puissances mondiales, au point de vue de la surface du territoire et du chiffre de la population, ne nous a été aussi défavorable qu’aujourd’hui, à moins de revenir de deux mille ans en arrière, au commencement de notre histoire. Alors, tout jeune peuple, nous faisions notre entrée impétueuse dans un monde de grands États qui menaçaient ruine, et nous contribuâmes à abattre le dernier de ces géants : Rome. Aujourd’hui, nous nous trouvons dans un monde de grands et puissants États en cours de formation, et, au milieu d’eux, notre propre empire déchoit chaque jour jusqu’à perdre toute importance.
Il faut que nous gardions devant les yeux, avec calme et sang-froid, cette amère vérité. Il est nécessaire que nous suivions et que nous comparions, sous le rapport du chiffre de la population et de l’étendue territoriale, l’empire allemand et les autres États à travers les siècles. Je sais qu’alors chacun en arrivera avec consternation au résultat que j’ai déjà exprimé au début des présentes considérations : l’Allemagne n’est plus une puissance mondiale, peu importe à cela que sa situation militaire soit forte ou faible.
Nous ne pouvons plus être comparés à aucun autre grand État du globe ; et ceci n’est dû qu’à une conduite franchement néfaste de notre politique extérieure, grâce à son manque complet d’un attachement – je pourrais presque dire testamentaire – à un but déterminé ; grâce, enfin, à la perte de tout instinct sain et de tout sentiment de la conservation.
Si le mouvement national-socialiste veut réellement obtenir devant l’histoire la consécration d’une grande mission en faveur de notre peuple, il doit, pleinement et douloureusement conscient de la véritable situation du peuple allemand sur cette terre, entreprendre avec courage et clairvoyance la lutte contre l’inconscience et l’incapacité qui ont guidé jusqu’à présent la politique extérieure du peuple allemand. Il doit alors, sans égards pour « traditions » et « préjugés », trouver le courage de rassembler notre peuple et sa puissance, pour le lancer sur la voie qui le sortira de son étroit habitat actuel et le mènera vers de nouveaux territoires, le libérant ainsi à jamais du danger de disparaître de cette terre ou de devenir l’esclave des autres.
Le mouvement national-socialiste doit s’efforcer de faire disparaître le désaccord entre le chiffre de notre population et la superficie de notre territoire – celle-ci étant considérée tant comme source de la subsistance que comme point d’appui de la puissance politique – de supprimer aussi le désaccord existant entre notre passé historique et notre impuissance actuelle à laquelle il n’est point d’issue. Il doit avoir conscience de ce que, gardiens de la plus haute humanité sur cette terre, nous avons aussi les plus hautes obligations ; et il pourra d’autant mieux y satisfaire qu’il aura davantage le souci de faire prendre conscience de sa race au peuple allemand, et que, outre l’élevage des chiens, des chevaux et des chats, il prendra aussi pitié de son propre sang.
* * *
Quand je qualifie d’incapable et d’aveugle la politique extérieure allemande suivie jusqu’ici, la preuve en est fournie par la carence effective de cette politique. Si notre peuple s’était amoindri intellectuellement ou était devenu lâche, les résultats de sa lutte sur la terre n’auraient pas été pires que ceux que nous avons aujourd’hui sous les yeux. Même l’évolution des dernières dix années avant la guerre ne doit pas nous abuser là-dessus ; car on ne peut pas mesurer la force d’un empire en elle-même, mais seulement par voie de comparaison avec d’autres États. Or, une pareille comparaison fournit précisément la preuve que l’accroissement de puissance des autres États était plus régulier et aboutissait aussi à des résultats plus considérables ; dans ces conditions, l’Allemagne, malgré son ascension apparente, s’éloignait en réalité de plus en plus des autres puissances et restait loin en arrière ; bref, la différence s’augmentait à notre désavantage. Et même en ce qui concerne le chiffre de la population, nous perdions de plus en plus. Notre peuple n’est assurément surpassé en héroïsme par aucun autre ici-bas, et tout compte fait, pour maintenir son existence, il a, plus qu’aucun peuple de cette terre, payé de son sang : si ces sacrifices ont été vains, c’est qu’ils furent mal utilisés. Lorsque, dans le même ordre d’idées, nous examinons à fond l’histoire de l’Allemagne depuis plus de mille ans, quand nous faisons défiler sous nos yeux toutes ses guerres et ses combats sans nombre et lorsque nous analysons les résultats définitifs tels qu’ils apparaissent maintenant, nous devons reconnaître que, de cette mer de sang, trois faits seuls surgissent, que nous pouvons considérer comme fruits durables d’une action clairvoyante en politique extérieure et politique tout court :
1° La colonisation de la marche de l’Est effectuée principalement par les Baïouvares.
2° La conquête et la pénétration du territoire à l’est de l’Elbe, et
3° L’organisation réalisée par les Hohenzollern de l’État brandebourgeois prussien, modèle et noyau de cristallisation d’un nouvel empire.
Ces faits sont pleins de féconds enseignements pour l’avenir !
Les deux premiers grands succès de notre politique extérieure sont restés les plus durables. Sans eux, notre peuple ne jouerait plus aucun rôle. Ils furent la première tentative, mais malheureusement la seule réussie, de mettre en harmonie le nombre croissant de la population et le territoire. Et l’on doit considérer comme véritablement désastreux que nos historiographes allemands n’aient jamais su apprécier à leur juste valeur ces deux puissantes réalisations, d’une importance sans égale pour la postérité, alors qu’elles glorifient tout ce qu’il est possible, et portent aux nues un héroïsme fantasque, et d’innombrables guerres et combats aventureux, demeurés pour la plupart sans importance pour l’avenir de la Nation.
Le troisième grand succès de notre activité politique réside dans la formation de l’État prussien et dans la genèse subséquente d’une conception particulière de l’État, ainsi que du sentiment de conservation et d’autodéfense de l’armée allemande sous une forme organisée et adaptée aux circonstances actuelles.
De cette forme et de cette conception de l’État provient la transformation du sentiment de la défense individuelle en celui de l’obligation de défendre la nation. L’importance de ce fait ne saurait être surestimée. Le peuple allemand, déchiré par l’excès d’individualisme, fruit de la diversité des races qu’il enferme, recouvra, grâce à la discipline de l’armée prussienne, une partie au moins des facultés d’organisation qui, depuis longtemps, lui étaient devenues étrangères. Ce qui existe originellement chez les autres peuples dans leur instinct de solidarité grégaire, fut rendu, en partie au moins, à notre communauté nationale par la voie artificielle de l’instruction militaire. Aussi la suppression du service militaire obligatoire – qui, pour des douzaines d’autres peuples, n’aurait absolument aucune importance – est- elle pour nous lourde de conséquences. Encore dix générations d’Allemands sans le correctif d’une instruction militaire, abandonnées à l’influence défavorable de la diversité des races et, par suite, des conceptions philosophiques, et notre peuple aurait réellement perdu le dernier reste d’une existence indépendante sur cette planète. L’esprit allemand ne pourrait plus apporter son tribut à la civilisation que par des individus isolés au sein de nations étrangères, sans qu’on en reconnaisse seulement la provenance. Il ne serait plus qu’un engrais de civilisation, jusqu’à ce qu’enfin le dernier reste de sang aryen nordique dépérisse et s’éteigne en nous.
Il est remarquable que l’importance de ces succès politiques réels, que notre peuple remporta au cours de plus de mille ans de combats, est beaucoup mieux comprise et appréciée par nos adversaires que par nous- mêmes. Nous bourdonnons aujourd’hui encore de cet héroïsme qui a ravi à notre peuple des millions de ses plus nobles fils et qui, en dernière analyse, demeura cependant complètement stérile.
Il est de la plus haute importance pour notre conduite présente et future de distinguer entre les succès politiques véritables qu’a remportés notre peuple et les circonstances où le sang national fut risqué sans profit.
Nous autres nationaux-socialistes ne devons, en aucun cas, nous associer au patriotisme déplacé et bruyant de notre monde bourgeois d’aujourd’hui. Il y a, en particulier, un danger mortel à considérer que la dernière évolution avant la guerre ait tant soit peu engagé notre propre avenir.
De toute l’histoire du dix-neuvième siècle, il ne peut découler pour nous une seule obligation véritable. Nous devons, contrairement à l’attitude des représentants de l’époque actuelle, nous faire à nouveau les champions de cette conception supérieure de la politique extérieure, c’est-à-dire mettre en accord le territoire et le nombre de la population. Oui ! tout ce que nous pouvons apprendre dans le passé, c’est à fixer à notre action politique un double objectif : le territoire, but de notre politique extérieure, et une nouvelle doctrine philosophique, but de notre politique intérieure.
* * *
Je prendrai encore brièvement position sur la question de savoir dans quelle mesure la revendication de territoires est légitimée moralement. Ceci est indispensable ; malheureusement, en effet, même dans les milieux soi-disant racistes, il apparaît toutes sortes de bavards onctueux qui s’efforcent de désigner au peuple allemand, comme but de son action politique extérieure, la réparation de l’injustice de 1918, et cependant, par là-dessus, ils se croient obligés d’assurer le monde entier de la fraternité et de la sympathie racistes.
Je dirais plutôt ceci : la prétention de rétablir les frontières de 1914 est une insanité politique par ses proportions et ses conséquences, qui la révèlent comme un véritable crime. Soit dit sans compter que les frontières du Reich, en 1914, étaient rien moins que logiques. En réalité, elles ne groupaient pas tous les hommes de nationalité allemande et elles n’étaient pas non plus rationnelles au point de vue stratégique. Elles n’étaient pas le résultat d’une action politique réfléchie, mais bien des frontières provisoires, au cours d’une lutte nullement close ; elles étaient même, en partie, le résultat des jeux du hasard ! On aurait pu à aussi bon droit, et bien souvent à meilleur droit, choisir une autre année marquante de l’histoire allemande, pour donner comme but à une action politique extérieure le rétablissement de la situation existant alors. Les revendications ci-dessus répondent d’ailleurs entièrement à l’esprit de notre monde bourgeois qui, ici encore, ne possède pas la moindre idée politique portant sur l’avenir, mais qui se confine au contraire dans le passé et le plus récent : les regards qu’il jette en arrière ne s’étendent pas au-delà de son propre temps. Son inertie le lie à une situation donnée et le fait résister à toute modification de celle-ci, sans toutefois que cette activité défensive s’élève jamais au-dessus de la simple ténacité. Il est donc parfaitement compréhensible que l’horizon politique de ces gens ne s’étende pas plus loin que 1914. Mais, en proclamant que le rétablissement des frontières d’alors est le but de leur activité politique, ils resserrent à nouveau l’alliance prête à se rompre de nos adversaires. C’est ainsi seulement qu’on peut s’expliquer que, huit ans après une guerre mondiale à laquelle participaient des États aux buts très souvent hétérogènes, la coalition des vainqueurs du moment garde encore quelque unité.
Tous ces États ont, en leur temps, profité de l’effondrement de l’Allemagne. La crainte de notre puissance fit reculer ensemble l’avidité et l’envie de chacune de ces grandes puissances. Elles voyaient dans le partage, aussi étendu que possible de notre Reich, la meilleure protection contre un relèvement futur. Leur conscience inquiète et la crainte qu’elles ont de la force de notre peuple sont le ciment le plus durable qui, aujourd’hui encore, tient unis les membres de cette ligue.
Et nous ne leur donnons pas le change. Quand notre monde bourgeois donne à l’Allemagne comme programme politique le rétablissement des frontières de 1914, il fait reculer par crainte chacun des partenaires qui voulait s’échapper de la ligue de nos ennemis ; tous doivent, en effet, redouter d’être attaqués isolément et de perdre la protection des autres alliés. Chaque État se sent visé et menacé par ce mot d’ordre. Ce dernier est donc doublement déraisonnable :
1° Parce que les moyens font défaut pour le faire passer des fumées des soirées de réunion dans la réalité, et
2° Parce que, même si on l’obtenait vraiment, ce résultat serait encore tellement misérable que, vrai Dieu ! il ne vaudrait pas la peine de mettre de nouveau en jeu le sang de notre peuple.
Car il ne saurait faire question pour personne que même le rétablissement des frontières de 1914 ne puisse être atteint sans verser de sang. Seuls, des esprits puérils et naïfs peuvent se bercer de l’idée d’amener une révision du traité de Versailles par l’humilité et par les supplications ; abstraction faite de ce qu’une pareille tentative exigerait un tempérament à la Talleyrand, qui n’existe pas chez nous. Une moitié de nos hommes politiques se compose d’éléments très roués, mais qui, par ailleurs, manquent entièrement de caractère et sont, en somme, hostiles à notre peuple ; en ce qui concerne l’autre moitié, elle est faite de débonnaires imbéciles, inoffensifs et serviables. Et les temps sont changés depuis le congrès de Vienne : ce ne sont plus les princes et les maîtresses des princes qui marchandent les frontières des États, mais c’est maintenant l’inexorable Juif cosmopolite qui combat pour la domination des autres peuples. Aucun d’eux ne peut écarter cette main de sa gorge autrement que par le glaive. Seule, la force rassemblée et concentrée d’une passion nationale, peut, d’un sursaut, braver les menées internationales qui tendent à réduire les peuples en esclavage. Mais un tel geste ne saurait aller sans effusion de sang.
Si, toutefois, l’on professe la conviction que, d’une façon ou d’une autre, l’avenir de l’Allemagne exige l’enjeu suprême en dehors de toute considération de finasserie politique, l’enjeu même exige que l’on mène le combat pour un but digne de lui.
Les frontières de l’année 1914 sont sans aucune valeur pour l’avenir de la nation allemande. Elles ne constituaient ni la sauvegarde du passé, ni une force pour l’avenir. Par elles, le peuple allemand ne pourra ni garder son unité intérieure, ni assurer sa subsistance ; considérées du point de vue militaire, ces frontières n’apparaissent ni bien choisies ni même seulement rassurantes ; et enfin elles ne peuvent améliorer la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement par rapport aux autres puissances mondiales, ou pour mieux dire par rapport aux vraies puissances mondiales. La distance à l’Angleterre ne sera pas diminuée ; on n’arrivera pas à la grandeur des États-Unis ; la France même n’éprouverait pas une diminution substantielle de son importance dans la politique mondiale.
Une seule chose serait sûre : même avec une issue favorable à une pareille tentative de rétablir les frontières de 1914, on aboutirait à une nouvelle saignée du corps de notre peuple, telle que l’on ne pourrait plus consentir aucun nouveau sacrifice de sang pour assurer d’une façon effective la vie et l’avenir de notre nation. Au contraire, dans l’ivresse d’un pareil succès, si dénué de portée qu’il soit, on renoncerait d’autant plus volontiers à s’imposer de nouveaux buts que « l’honneur national » aurait reçu réparation et que quelques nouvelles portes se seraient ouvertes, au moins pour un certain temps, au développement commercial.
Par contre, nous autres nationaux-socialistes nous devons nous en tenir d’une façon inébranlable au but de notre politique extérieure : assurer au peuple allemand le territoire qui lui revient en ce monde. Et cette action est la seule qui devant Dieu et notre postérité allemande, justifie de faire couler le sang : devant Dieu, pour autant que nous avons été mis sur cette terre pour y gagner notre pain quotidien au prix d’un perpétuel combat, en créatures à qui rien n’a été donné sans contrepartie, et qui ne devront leur situation de maîtres de la terre qu’à l’intelligence et au courage avec lesquels ils sauront la conquérir et la conserver ; devant notre postérité allemande, pour autant que l’on ne versera pas le sang d’un seul citoyen allemand sans donner à l’Allemagne future des milliers de nouveaux citoyens. Le territoire sur lequel les vigoureux enfants des générations de paysans allemands pourront un jour se multiplier, justifiera le sacrifice de nos propres enfants et absoudra les hommes d’État responsables, même persécutés par leur génération, du sang versé et du sacrifice imposé à notre peuple.
À ce propos, je dois m’élever avec la plus grande énergie contre ceux des mauvais écrivains racistes qui prétendent voir, dans une pareille conquête de territoire, « une atteinte aux droits sacrés de l’humanité » et s’en autorisent pour diriger contre elle leurs griffonnages. On ne sait jamais qui peut se cacher derrière de pareils individus. Mais il n’est que trop certain que le trouble qu’ils peuvent susciter fait le jeu des ennemis de notre peuple. Par une pareille attitude, ces criminels contribuent à saper et à faire disparaître chez lui la volonté de défendre ses exigences vitales par la seule méthode qui réponde à ce but. Car aucun peuple ne possède ici-bas un seul mètre carré de territoire en vertu d’une volonté ou d’un droit supérieurs. Les frontières de l’Allemagne sont des limites fortuites et momentanées au cours de l’éternelle lutte politique ; il en est de même des frontières délimitant l’habitat des autres peuples. Et tout comme la configuration de notre surface terrestre ne peut apparaître immuable comme le granit qu’à un étourdi imbécile – alors qu’en réalité chaque instant ne nous montre de sa constante évolution qu’une apparente immobilité, fruit du travail incessant des forces de la nature, détruite ou changée demain par des forces plus puissantes – il en est de même dans la vie des peuples, des frontières qui les séparent.
Les limites des États sont le fait des hommes et sont changées par eux.
Le fait qu’un peuple a réussi à acquérir un territoire excessif ne confère nullement l’obligation supérieure de l’admettre pour toujours. Il démontre tout au plus la force du conquérant et la faiblesse du patient. Et c’est dans cette seule force que réside le droit. Si aujourd’hui le peuple allemand, parqué sur un territoire impossible, marche vers un avenir déplorable, ceci n’est pas un arrêt du destin et le fait de s’insurger ne constitue pas davantage une violation de ce destin. Pas plus que quelque puissance supérieure n’aurait promis à un autre peuple plus de territoire qu’au peuple allemand, ou pas plus qu’elle se trouverait au contraire offensée par cette injuste répartition du sol ; pas plus que nos ancêtres n’ont reçu en don du ciel le sol où nous vivons aujourd’hui : ils ont dû le conquérir en combattant au péril de leur vie. De même, dans l’avenir, ce n’est pas la grâce « raciste » qui donnera à notre peuple le sol, et avec lui les moyens d’existence, mais seule la puissance du glaive victorieux pourra l’obtenir.
Autant nous sommes tous aujourd’hui convaincus de la nécessité d’un règlement de comptes avec la France, autant demeurerait-il inefficace pour nous dans son ensemble, si nos buts de politique extérieure se bornaient à cela. On ne saurait l’interpréter que comme une couverture de nos arrières pour l’extension en Europe de notre habitat. Car nous ne saurions résoudre cette question par l’acquisition de colonies, mais exclusivement par l’acquisition d’un territoire de peuplement qui accroisse la superficie même de notre mère-patrie. En outre, non seulement on assurera par là l’intime solidarité des nouveaux colons avec la métropole, mais on procurera à l’ensemble du territoire total les avantages qui résident dans sa grandeur unifiée.
Le mouvement raciste n’a pas à se faire l’avocat des autres peuples, mais à combattre pour le sien. Sinon il serait superflu, et au surplus on n’y aurait aucun droit, de dauber sur le passé. Car on agirait alors comme lui. L’ancienne politique allemande a été, du point de vue dynastique, tenue pour une injustice : la politique future ne doit pas s’inspirer davantage d’une niaise sentimentalité « raciste » cosmopolite. En particulier, nous ne sommes pas les gendarmes des « pauvres petits peuples » bien connus, mais les soldats de notre propre peuple.
Cependant nous autres nationaux-socialistes nous ne devons pas nous arrêter là : le droit au sol et à la terre peut devenir un devoir, lorsqu’un grand peuple paraît voué à la ruine, à défaut d’extension. Et tout particulièrement quand il ne s’agit pas d’un quelconque petit peuple nègre, mais de l’Allemagne, mère de toute vie, mère de toute la civilisation actuelle. L’Allemagne sera une puissance mondiale, ou bien elle ne sera pas. Mais, pour devenir une puissance mondiale, elle a besoin de cette grandeur territoriale qui lui donnera, dans le présent, l’importance nécessaire et qui donnera à ses citoyens les moyens d’exister.
* * *
Aussi, nous autres nationaux-socialistes, biffons- nous délibérément l’orientation de la politique extérieure d’avant-guerre. Nous commençons là où l’on avait fini il y a six cents ans. Nous arrêtons l’éternelle marche des Germains vers le sud et vers l’ouest de l’Europe, et nous jetons nos regards sur l’Est.
Nous mettons terme à la politique coloniale et commerciale d’avant-guerre et nous inaugurons la politique territoriale de l’avenir.
Mais si nous parlons aujourd’hui de nouvelles terres en Europe, nous ne saurions penser d’abord qu’à la Russie et aux pays limitrophes qui en dépendent.
Le destin même semble vouloir nous le montrer du doigt : en livrant la Russie au bolchévisme, il a ravi au peuple russe cette couche d’intellectuels, qui fonda et assuma jusqu’à ce jour son existence comme État. Car l’organisation de l’État russe ne fut point le résultat des aptitudes politiques du slavisme en Russie, mais bien plutôt un exemple remarquable de l’action, créatrice d’États, de l’élément germanique. au milieu d’une race de moindre valeur. Bien des États puissants de cette terre ont été ainsi créés. Des peuples inférieurs, ayant à leur tête des organisateurs et des maîtres de race germanique, se sont souvent enflés jusqu’à devenir, à un moment donné, des États puissants, et ils le sont restés aussi longtemps que se conserva inaltéré le noyau de la race créatrice d’État. Ainsi, depuis des siècles, la Russie vivait aux dépens du noyau germanique de ses couches supérieures dirigeantes qu’on peut considérer actuellement comme extirpé et anéanti. Le Juif a pris sa place. Et tout comme le Russe est incapable de secouer le joug des Juifs par ses propres moyens, de même le Juif ne saurait, à la longue, maintenir le puissant État. Lui-même n’est pas un élément organisateur, il n’est qu’un ferment de décomposition. L’État gigantesque de l’Est est mûr pour l’effondrement. Et la fin de la domination juive en Russie sera aussi la fin de la Russie en tant qu’État. Nous avons été élus par le destin pour assister à une catastrophe, qui sera la preuve la plus solide de la justesse des théories racistes au sujet des races humaines.
Et notre tâche, la mission du mouvement national- socialiste, consiste à amener notre propre peuple à ces conceptions politiques, qui lui feront voir son avenir non dans les enivrantes impressions d’une nouvelle campagne d’Alexandre, mais dans le travail laborieux de la charrue allemande à laquelle le glaive n’a qu’à donner la terre.
* * *
Que les Juifs annoncent la résistance la plus active à cette politique, cela va de soi. Ils sentent mieux que quiconque la signification d’une telle conduite pour leur propre avenir. Et ce fait même aurait dû démontrer à tous les hommes de convictions vraiment nationales le bien-fondé de cette nouvelle orientation. Hélas ! ce qui arrive est juste le contraire. Non seulement dans les milieux nationaux-allemands, mais aussi même dans ceux des « racistes », on professe une hostilité acharnée contre l’idée d’une telle politique de l’Est ; on se réfère, comme presque toujours en pareil cas, à quelque autorité établie. On évoque l’esprit de Bismarck, pour couvrir une politique aussi insensée que suprêmement nuisible au peuple allemand. Bismarck même aurait jadis toujours attaché une grande importance, à de bonnes relations avec la Russie. Dans une certaine mesure, c’est juste. Mais, en même temps, on oublie complètement qu’il attachait une aussi grande importance aux bonnes relations avec l’Italie, et que ce même M. de Bismarck s’allia jadis avec l’Italie pour pouvoir d’autant mieux mater l’Autriche. Pourquoi ne continue-t-on pas cette politique-là, elle aussi ? « Parce que l’Italie d’aujourd’hui n’est pas l’Italie d’alors », dira-t-on. Bien. Mais alors, Messeigneurs, permettez- moi d’objecter que la Russie d’aujourd’hui n’est pas non plus la Russie d’alors. Il n’est jamais venu l’idée à Bismarck de fixer une politique une fois pour toutes et par principe. Il était bien trop le maître de l’heure, pour s’embarrasser d’une entrave pareille. La question donc ne doit pas être : que fit alors Bismarck ? mais plutôt : qu’aurait-il fait aujourd’hui ? Et il est plus facile de répondre à cette question. Jamais, dans sa sagesse politique, il ne se serait allié à un État voué à la ruine.
Au reste, Bismarck n’envisagea de son temps qu’avec des sentiments très mélangés la politique coloniale et commerciale allemande, et encore parce qu’il lui importait d’abord d’assurer les meilleures chances à la consolidation et au raffermissement intérieurs de l’État qu’il avait créé. Ce fut aussi la seule raison pour laquelle il fut satisfait d’avoir le dos couvert par la Russie, ce qui lui laissait les mains libres à l’Ouest. Mais ce qui fut alors utile à l’Allemagne, lui serait nuisible aujourd’hui.
Dès 1920-1921, quand le jeune mouvement national-socialiste commença lentement à se profiler sur l’horizon politique, et quand on commença à le considérer, çà et là, comme le mouvement de libération de la nation allemande, on approcha de différents côtés notre parti pour essayer d’établir un certain lien entre lui et les mouvements de libération d’autres pays. C’était sous les auspices de la « ligue des nations opprimées » aux innombrables protagonistes. Il s’agissait là, en majeure partie, de représentants de quelques États balkaniques, et de ceux de l’Égypte et de l’Inde, qui me firent toujours l’impression de bavards prétentieux, mais sans aucun fond véritable. Il se trouva cependant beaucoup d’Allemands, surtout dans le camp national, qui se laissèrent éblouir par ces orientaux soufflés et qui crurent voir sans plus, dans un quelconque étudiant hindou ou égyptien venu on ne sait d’où, le « représentant » de l’Inde ou de l’Égypte. Les gens ne se rendaient point compte qu’il s’agissait ici, pour la plupart, d’hommes qui n’avaient rien derrière eux et que surtout nul n’avait autorisés à conclure un traité quelconque avec qui que ce soit, et que le résultat pratique de toutes les relations avec ces éléments était nul, s’il ne fallait pas encore porter au compte « pertes et profits » le temps perdu ! Je me suis toujours défendu contre ces tentatives, non seulement parce que j’avais mieux à faire qu’à gaspiller des semaines en des
« pourparlers » aussi stériles, mais je considérais aussi que, même s’il s’était agi de représentants autorisés de ces nations, le tout eût été inutile et même nuisible.
Il était déjà assez fâcheux, dès le temps de paix, que la politique allemande, faute d’envisager une activité offensive personnelle, aboutît à l’alliance défensive avec de vieux États pensionnés par l’histoire mondiale. L’alliance avec l’Autriche, aussi bien que l’alliance avec la Turquie, n’avait rien de réjouissant. Tandis que les plus grandes puissances militaires et industrielles de la terre s’unissaient en une active alliance offensive, on assemblait quelques vieux organismes d’États impuissants et on s’efforçait, avec ce bric-à-brac voué à la ruine, de faire front contre une agissante coalition mondiale. L’Allemagne expia amèrement l’erreur de cette politique extérieure. Mais cette expiation ne paraît pas avoir été encore assez amère pour préserver nos éternels rêveurs d’une prompte rechute. Car la tentative de désarmer les vainqueurs tout-puissants par une « Ligue des nations opprimées » n’est pas seulement ridicule, elle est funeste. Tentative funeste, parce que, de nouveau et toujours, elle détourne notre peuple des possibilités réelles et le fait s’abandonner à des espérances et à des illusions aussi chimériques que stériles. L’Allemand de nos jours ressemble vraiment à l’homme en train de se noyer qui s’accroche à tout brin de paille. Et il peut s’agir là de gens par ailleurs très cultivés. Aussitôt que se laisse entrevoir le feu follet de l’espérance la plus invraisemblable, ces gens de trotter et de poursuivre ce fantôme. Que ce soit une Ligue des nations opprimées ou une Société des nations, ou toute autre imagination chimérique, elle trouvera néanmoins des milliers de dévots.
Je me souviens encore des espérances puériles et incompréhensibles qui prirent corps subitement dans les milieux racistes, en 1920-1921, touchant une catastrophe imminente pour l’Angleterre dans l’Inde.
De quelconques prestidigitateurs asiatiques – ou, peut- être, je veux bien l’admettre, de véritables « champions de la liberté » indiens – qui circulaient alors à travers l’Europe, avaient réussi à suggérer à des gens tout à fait raisonnables sous d’autres rapports, l’idée fixe que le grand Empire britannique menaçait ruine justement dans l’Inde qui en constitue la pierre angulaire. Que, seul, leur propre désir, dans ce cas aussi (Proverbe allemand : Der Wunsch ist Vater des Gedankens, le désir est père de l’idée), fut le père de toutes ces idées, naturellement ils n’en avaient pas conscience, pas plus que de l’absurdité de leurs espoirs. Car, escomptant que l’effondrement de la domination anglaise dans l’Inde serait la fin de l’Empire britannique et de la puissance anglaise, ils admettaient par là-même que l’Inde avait pour l’Angleterre une importance capitale.
Mais ce problème vital n’était probablement pas un profond secret connu des seuls prophètes « racistes » allemands ; on pouvait le croire connu aussi des guides de l’histoire anglaise. Il est déjà vraiment par trop puéril d’admettre que l’Angleterre ne sait pas apprécier à sa juste valeur l’importance de l’Inde pour l’union mondiale britannique. Et c’est un signe fâcheux qu’on n’a rien appris de la guerre mondiale, et aussi qu’on méconnaît et ignore complètement la résolution anglo-saxonne, quand on s’imagine que l’Angleterre pourrait laisser partir l’Inde sans recourir aux moyens ultimes. C’est aussi une preuve d’un manque complet de connaissance chez l’Allemand touchant la manière britannique de pénétrer et gérer cet empire. L’Angleterre ne perdra l’Inde que si elle est elle-même dévolue dans son mécanisme administratif à la décomposition raciale (éventualité complètement exclue de nos jours dans l’Inde) ou bien si elle y est forcée par le glaive d’un ennemi puissant. Des rebelles indiens n’y réussiront jamais. À quel point il est difficile de dompter l’Angleterre, nous autres Allemands, nous l’avons suffisamment appris ! Sans compter que moi, Germain, je préfère encore, malgré tout, voir l’Inde sous la domination anglaise que sous n’importe quelle autre.
Les espérances suscitées par le mythe d’une insurrection en Égypte sont aussi piteuses. La « guerre sainte » peut donner un agréable frisson à ceux qui, chez nous, jouent à l’idiot, se figurant que d’autres sont prêts à verser leur sang pour nous – car cette lâche spéculation, à parler franchement, fut toujours la source inavouée de pareils espoirs – ; en réalité, cette guerre trouverait une fin infernale sous le tir fauchant des compagnies de mitrailleurs anglais, et la grêle des bombes brisantes.
C’est qu’il est impossible de lancer une coalition d’invalides à l’assaut d’un puissant État, résolu à verser au besoin la dernière goutte de son sang pour défendre son existence. En raciste qui se base sur la race pour estimer la valeur du matériel humain, je n’ai pas le droit de lier le sort de mon peuple à celui des soi-disant « nations opprimées », connaissant déjà leur infériorité raciale.
Nous devons aujourd’hui adopter exactement la même attitude vis-à-vis de la Russie. La Russie actuelle, dépouillée de sa classe dirigeante germanique – indépendamment des intentions secrètes de ses nouveaux maîtres – ne peut être un allié dans la lutte pour la libération de la nation allemande. Au point de vue purement militaire, les conditions seraient directement catastrophiques au cas d’une guerre Allemagne-Russie contre l’Europe occidentale et probablement contre tout le reste du monde. La lutte se déroulerait non pas sur le territoire russe, mais sur le territoire allemand, sans que l’Allemagne puisse recevoir de la Russie un secours tant soit peu efficace. Les moyens militaires du Reich allemand actuel sont si piteux et si insuffisants pour une guerre, que toute protection des frontières contre l’Europe occidentale, y compris l’Angleterre, serait impossible, et que la région industrielle allemande serait justement livrée sans défense aux attaques concentrées de nos ennemis. En outre, entre l’Allemagne et la Russie, se trouve l’État polonais qui est complètement aux mains de la France. Dans le cas d’une guerre Allemagne-Russie contre l’Ouest de l’Europe, la Russie devrait abattre la Pologne avant de pouvoir faire parvenir son premier soldat sur un front allemand. Et il s’agirait alors moins de soldats que de moyens techniques. À ce point de vue, on verrait se répéter, sous une forme plus affreuse encore, la situation de la guerre mondiale. Notre industrie fut alors saignée au profit de nos glorieux alliés, et l’Allemagne dut mener presque seule la guerre technique ; de même la Russie serait un facteur technique presque négligeable dans la guerre que nous envisageons. Nous ne pourrions opposer presque rien à la motorisation générale du monde, qui doit se manifester d’une manière écrasante et décisive dans la prochaine guerre. Car l’Allemagne même n’est pas seulement demeurée honteusement en retard dans ce domaine essentiel, elle devrait encore, avec ses moyens minimes, soutenir la Russie qui ne possède même pas actuellement une seule fabrique capable de construire une automobile qui marche. Dans ces conditions, une telle lutte prendrait de nouveau le caractère d’une tuerie. La jeunesse allemande verserait son sang plus encore que naguère, parce que, comme toujours, tout le poids de la guerre pèserait sur nous et le résultat en serait l’inévitable défaite.
Mais, en admettant même le cas où un miracle aurait lieu et où une telle lutte ne finirait pas par la destruction totale de l’Allemagne : en dernière analyse, le peuple allemand, vidé de son sang, resterait entouré comme auparavant de grandes puissances militaires, et sa véritable situation ne serait améliorée en aucune façon.
Que l’on n’objecte pas maintenant qu’il n’y a pas lieu de penser tout de suite à une guerre, dans le cas d’une alliance avec la Russie, ou que, le cas échéant, l’on pourrait se préparer à fond pour cette éventualité. Non. Une alliance dont les buts n’englobent pas aussi la perspective d’une guerre, est dénuée de sens et de valeur. On ne s’allie qu’en vue d’un combat. Et même si le règlement de comptes se trouve encore dans le lointain au moment où l’on conclut l’alliance, l’on n’en agit pas moins au fond prévoyant que l’on sera entraîné à une guerre.
Qu’on ne s’imagine pas d’ailleurs qu’une autre puissance quelconque puisse se tromper sur une pareille alliance. Ou bien une coalition germano-russe demeurera sur le papier et alors elle n’a pour nous ni but ni valeur, ou bien elle ne restera pas lettre morte, et, dans ce cas, le reste du monde sera averti. Quelle naïveté de penser qu’en pareilles circonstances, l’Angleterre et la France attendraient quelque dix ans jusqu’à ce que l’alliance germano-russe ait achevé sa préparation technique à la guerre. Non, l’orage éclaterait au-dessus de l’Allemagne avec une rapidité foudroyante.
Le fait même de conclure une alliance avec la Russie indique donc déjà l’imminence de la guerre. Et le résultat en serait la fin de l’Allemagne.
Mais il faut ajouter encore ceci :
1° Ceux qui, actuellement, détiennent le pouvoir en Russie, ne pensent pas du tout à conclure une alliance honnête, ni surtout à l’observer.
Il ne faut jamais oublier que les gouvernants de la Russie actuelle ne sont que de vulgaires criminels tout souillés de sang ; il s’agit là d’une lie de l’humanité, qui, à la faveur d’une heure tragique, assaillit un grand État, abattit et extermina par millions, avec une sauvagerie sanguinaire, les intellectuels de ses classes dirigeantes et qui exerce depuis bientôt dix ans la plus cruelle tyrannie de tous les temps. Il ne faut pas oublier non plus que ces gouvernants appartiennent à un peuple qui unit, à un rare degré, une cruauté bestiale avec un art incroyable du mensonge et qui, maintenant plus que jamais, se croit prédestiné pour imposer son oppression sanglante au monde entier. Il ne faut pas oublier que le Juif international, qui exerce actuellement une domination absolue sur la Russie, voit dans l’Allemagne non pas un allié, mais un État voué au même sort. On ne traite pas avec un partenaire dont le seul intérêt est la destruction de l’autre partie. On ne traite surtout pas avec des individus pour qui aucun accord ne serait sacré, car, dans ce monde, ils sont non pas les représentants de l’honneur et de la vérité, mais bien ceux du mensonge, de la duperie, du vol, du brigandage, du pillage. L’homme qui croit pouvoir se lier par traités à des parasites ressemble à l’arbre qui essaierait de conclure à son profit un compromis avec le gui.
2° Le danger auquel la Russie a succombé menacera toujours l’Allemagne. Seul, un bourgeois naïf peut s’imaginer que le bolchévisme est conjuré. Dans son esprit superficiel, il ne soupçonne nullement qu’il s’agit ici d’une manifestation instinctive : l’aspiration du peuple juif à la domination universelle, tendance aussi naturelle que celle qui pousse l’Anglo-Saxon à s’assurer le pouvoir sur cette terre. Et le Juif agit tout comme l’Anglo-Saxon, qui avance dans cette voie à sa manière et mène la lutte avec les armes qui lui sont propres. Le Juif aussi suit sa voie, cette voie qui le conduit à se glisser dans les peuples et à les vider de leur substance ; et il combat avec ses armes, qui sont le mensonge et la calomnie, l’empoisonnement et la décomposition, accentuant la lutte jusqu’à l’extermination sanglante de l’adversaire détesté. Nous devons voir dans le bolchévisme russe la tentative des Juifs au vingtième siècle, pour conquérir la domination mondiale ; à d’autres époques, ils ont pareillement essayé d’atteindre le même but avec des moyens, autres que les moyens actuels, qui leur étaient cependant intérieurement apparentés. Cette tendance est trop profondément ancrée dans tout leur être. Les autres peuples ne renoncent pas d’eux-mêmes à suivre l’instinct qui les fait développer leur genre et leur puissance : ils y sont forcés par des circonstances extérieures ou bien cela constitue chez eux un signe de sénilité ; le Juif non plus n’interrompt pas sa marche vers la dictature mondiale par un renoncement volontaire ou bien en refoulant en lui-même son éternelle aspiration. Lui aussi ne saurait être forcé à rebrousser chemin que par des forces extérieures à lui- même, car son instinct de domination mondiale ne s’éteindra qu’avec lui. Mais l’impuissance des peuples, leur mort de vieillesse ne surviennent que lorsqu’ils ont renoncé à la pureté de leur sang. Et le Juif sait le préserver mieux que tout autre peuple au monde. Il poursuivra donc toujours son chemin fatal, jusqu’à ce que s’oppose à lui une autre force qui, en une lutte titanesque, renvoie à Lucifer celui qui monte à l’assaut du ciel.
L’Allemagne est aujourd’hui le prochain objectif important du bolchévisme. Il faut toute la force d’une grande idée, toute la conscience d’une mission à remplir, pour arracher encore une fois notre peuple à l’étreinte de cette hydre, pour arrêter les progrès de la contamination de notre sang, pour que les forces libérées de la nation puissent entrer en jeu pour assurer la sécurité de notre peuple et rendre impossible, jusque dans le plus lointain avenir, le retour des récentes catastrophes. Mais si on poursuit ce but, c’est folie que de s’allier avec une puissance soumise à l’ennemi mortel de notre race. Comment veut-on libérer le peuple allemand de cette étreinte empoisonnée, si on s’y engage aussi ? Comment expliquer à l’ouvrier allemand que le bolchévisme est un crime damnable contre l’humanité, quand on s’allie soi-même avec les organisations de cette engeance infernale, et, somme toute, qu’on les reconnaît ? De quel droit condamner alors dans la masse un individu pour ses sympathies à l’égard de certaines conceptions, quand les propres chefs de l’État prennent comme alliés les champions de ces mêmes idées.
La lutte contre la bolchévisation mondiale juive exige une attitude nette vis-à-vis de la Russie soviétique. On ne peut pas chasser le diable par Belzébuth.
Les milieux racistes aujourd’hui, pleins d’engouement pour une alliance avec la Russie, n’ont qu’à jeter un coup d’œil en Allemagne et se rendre compte de l’appui qu’ils ont trouvé à leurs débuts. Les racistes pensent-ils maintenant qu’une action, qui est prônée et appelée par la presse internationale marxiste, peut être salutaire pour le peuple allemand ? Depuis quand est-ce un écuyer juif qui tend son armure au raciste ?
On pouvait faire à l’ancien Reich allemand un reproche capital au sujet de sa politique d’alliances : c’est qu’il compromettait ses rapports avec tous, par sa perpétuelle politique de balance, ayant la faiblesse maladive de vouloir sauvegarder à tout prix la paix mondiale. La seule chose qu’on ne peut lui reprocher, c’est de n’avoir pas su conserver de bonnes relations avec la Russie.
J’accorde que, dès l’avant-guerre, j’aurais considéré comme plus rationnel que l’Allemagne, renonçant à sa politique coloniale insensée, ainsi qu’à sa marine marchande et à sa flotte, se fût alliée avec l’Angleterre contre la Russie ; elle eût remplacé une politique mondiale vacillante par une politique européenne résolue d’acquisitions territoriales sur le continent.
Je n’oublie pas les constantes et impudentes menaces que la Russie panslaviste d’alors osait proférer contre l’Allemagne ; je n’oublie pas les constantes manœuvres de mobilisation dont le seul but était de brusquer l’Allemagne ; je ne puis oublier l’état de l’opinion publique en Russie, qui déjà, avant la guerre, se surpassait en attaques haineuses contre notre peuple et notre empire ; je ne puis oublier l’engouement de la grande presse russe à l’égard de la France, et son attitude si différente envers nous. Néanmoins, malgré tout cela, avant-guerre il a existé encore une seconde voie : on aurait pu s’appuyer sur la Russie et se tourner contre l’Angleterre.
Aujourd’hui, les circonstances sont tout autres. Si, avant-guerre, refoulant toutes sortes de sentiments, on pouvait faire route avec la Russie, aujourd’hui cela n’est plus possible. L’aiguille a avancé à l’horloge de l’histoire et l’heure va sonner où notre destin doit se décider. La consolidation, dont s’occupent actuellement tous les grands États mondiaux, est pour nous un dernier avertissement d’avoir à rentrer en nous-mêmes, de ramener notre peuple du monde des rêves dans la dure réalité, et de lui montrer la voie vers l’avenir qui peut seule conduire le vieux Reich à une floraison nouvelle.
Si le mouvement national-socialiste, devant cette grande tâche capitale, se débarrasse de toute illusion et ne se guide plus que sur la raison, la catastrophe de 1918 peut encore devenir un bienfait immense pour l’avenir de notre peuple. Cet effondrement peut l’amener, en effet, à une orientation toute nouvelle de sa politique étrangère ; plus encore, raffermi à l’intérieur par des théories morales nouvelles, il peut arriver aussi, à l’extérieur, à fixer définitivement sa politique. Il peut acquérir finalement ce que possède l’Angleterre, ce que posséda la Russie elle-même, ce qui enfin fait toujours prendre à la France les mêmes décisions conformes, en dernière analyse, à ses intérêts, à savoir : un testament politique.
Le testament politique de la nation allemande pour son attitude à l’extérieur doit être à jamais le suivant :
Ne permettez jamais que se forment en Europe deux puissances continentales. Dans toute tentative d’organiser aux frontières de l’Allemagne une deuxième puissance militaire – ne fût-ce que sous la forme d’un État susceptible d’acquérir une telle puissance – voyez une attaque contre l’Allemagne. Considérez que c’est non seulement votre droit, mais votre devoir d’empêcher, par tous les moyens et au besoin par les armes, la constitution d’un tel État. S’il existe déjà, détruisez-le. Veillez que la source de la puissance de notre pays ne soit pas dans des colonies, mais en Europe, dans le sol de la patrie. Ne tenez jamais le Reich comme garanti tant qu’il n’aura pu donner, pour des siècles, à chaque rejeton de notre peuple, sa parcelle du sol. N’oubliez jamais que le droit le plus sacré en ce monde est le droit à la terre que l’on veut cultiver soi-même, et que le plus saint des sacrifices est celui du sang versé pour elle.
* * *
Je ne voudrais pas en finir avec ces considérations, sans indiquer encore une fois l’unique possibilité d’alliance qui, en ce moment, existe pour nous en Europe. Dans le chapitre précédent sur les alliances allemandes, j’ai déjà désigné l’Angleterre et l’Italie comme les deux seuls États dont nous aurions tout intérêt à nous rapprocher étroitement, même au prix de grands efforts. Je veux maintenant marquer encore ici l’importance militaire d’une telle alliance.
La conclusion de cette alliance entraînerait au point de vue militaire, dans l’ensemble et dans le détail, les conséquences exactement opposées de celles qu’aurait l’alliance avec la Russie. C’est d’abord le fait capital que d’aucune façon un rapprochement de l’Angleterre et de l’Italie ne comporte fatalement un danger de guerre. La seule puissance dont il faut considérer qu’elle prendrait position contre l’alliance, à savoir la France, ne serait pas, dans le cas considéré, en mesure de le faire. L’alliance donnerait par contre à l’Allemagne la possibilité de prendre en toute tranquillité les mesures préparatoires requises, dans le cadre d’une telle coalition, en vue d’un règlement de comptes avec la France. Car l’essentiel, dans une semblable alliance, c’est que non seulement l’Allemagne ne sera pas exposée subitement, dès sa conclusion, à une invasion ennemie, mais encore que s’écroulera d’elle-même la ligue de nos ennemis, cette « Entente » qui nous fut si démesurément funeste ; ainsi l’ennemi mortel de notre pays, la France, tombera dans l’isolement. Et quand il ne s’agirait là tout d’abord que d’un succès moral, cela suffirait à donner à l’Allemagne une liberté d’allures dont nous n’avons aujourd’hui aucune idée. Car c’est la nouvelle alliance européenne anglo-germano-italienne qui aurait en mains l’initiative politique, et non plus la France.
La portée de ce succès serait d’ailleurs plus grande encore, l’Allemagne étant affranchie d’un seul coup de sa situation stratégique défavorable. D’une part, le plus puissant des flanquements, de l’autre l’assurance complète de notre ravitaillement en vivres et en matières premières : telle serait la bienfaisante action du nouvel arrangement des puissances.
Mais plus important encore peut-être serait le fait que la nouvelle ligue engloberait des États qui se compléteraient mutuellement au point de vue technique. Pour la première fois, les alliés de l’Allemagne ne seraient pas des sangsues vivant sur notre propre économie ; ils seraient, au contraire, capables d’apporter leur part pour enrichir et compléter notre équipement technique, et ils ne manqueraient pas non plus de le faire.
Qu’on n’oublie pas que, dans l’un et l’autre cas, il s’agirait d’alliés sans aucune comparaison avec la Turquie ou la Russie actuelle. La plus grande puissance mondiale et un jeune État national florissant offriraient d’autres ressources, pour une guerre européenne, que les cadavres d’État pourris avec lesquels l’Allemagne s’était alliée dans la dernière guerre.
Certes – j’insistais là-dessus dans le chapitre précédent – de grosses difficultés s’opposent à une pareille alliance. Mais la constitution de l’Entente fut- elle œuvre moins ardue ? Ce que put faire le roi Edouard VII – et presque pour partie contre ses intérêts naturels – nous devons y réussir et nous y réussirons, si la conviction de la nécessité de cette évolution nous inspire au point de déterminer notre conduite, après nous avoir fait habilement triompher de nous-mêmes. Et ceci sera possible dès le moment où, avertis par la misère, au lieu de la politique sans but du siècle passé, nous poursuivrons consciemment un objectif unique, auquel nous nous attacherons. Ce n’est pas dans une orientation à l’Ouest ou une orientation à l’Est, que se trouve l’avenir de notre politique extérieure, mais bien dans une politique de l’Est, au sens d’acquisition de la glèbe nécessaire à notre peuple allemand. Mais comme il faut en avoir la force, et que l’ennemi mortel de notre peuple, la France, nous étrangle impitoyablement, et nous épuise, il faut prendre sur nous de faire tous les sacrifices susceptibles de contribuer à annihiler les tendances de la France à l’hégémonie. Toute puissance est aujourd’hui notre allié naturel, qui considère avec nous, comme insupportable, la passion d’hégémonie de la France sur le continent. Aucune démarche vis-à-vis d’une de ces puissances ne doit nous paraître trop dure, aucun renoncement ne doit nous paraître impossible, si nous avons finalement la possibilité d’abattre l’ennemi qui nous hait si rageusement. Et nous pourrons laisser le temps guérir tranquillement nos blessures légères, quand les plus graves seront cautérisées et fermées.
Naturellement, nous sommes aujourd’hui en butte, à l’intérieur, aux aboiements haineux des ennemis de notre peuple. Nous autres, nationaux-socialistes, ne nous laissons pas égarer ! Ne cessons pas de proclamer ce qui, d’après notre plus intime conviction, est absolument nécessaire ! Il nous faut, aujourd’hui, nous raidir contre le courant de l’opinion publique, fourvoyée par la malignité juive qui s’est servi de l’esprit chimérique de nos compatriotes ; les flots briseront plus d’une fois avec rage et fureur autour de nous, mais on remarque moins celui qui se laisse emporter que celui qui veut nager contre le courant. Aujourd’hui, nous sommes un simple épi, dans quelques années le destin peut faire de nous une digue sur laquelle se brisera tout le flot, qui devra refluer dans un nouveau lit.
Il faut donc que soit établi et reconnu, aux yeux du reste du monde, que le parti national-socialiste est précisément le champion d’une conception politique bien déterminée. Nous devons porter sur notre visière le signe distinctif de ce que le ciel même attend de nous.
Nous savons nous-mêmes la nécessité inéluctable qui détermine notre politique extérieure ; dans cette connaissance, nous devons puiser la capacité de résistance dont nous aurons plus d’une fois besoin, lorsque, sous les lance-flammes de nos adversaires acharnés, l’angoisse gagnera l’un ou l’autre et lorsqu’une voix insinuante lui soufflera, pour ne pas avoir tout et tous contre lui, de faire une concession dans quelque domaine et de hurler avec les loups.
Chapitre 15 – Le droit de légitime défense
Autant que la sagesse humaine est capable de prévoir l’avenir, la politique qui fut pratiquée après l’armistice, en novembre 1918, devait nous réduire peu à peu à un complet asservissement. L’histoire prouve par maint exemple que les peuples qui ont mis bas les armes, sans y être absolument contraints, aiment mieux, par la suite, accepter les pires humiliations et les pires exactions que tenter de changer leur sort par un nouvel appel à la force.
Ce choix est très humain. Autant que possible, un vainqueur avisé n’imposera ses exigences aux vaincus que par étapes successives. Et il a le droit d’escompter, avec un peuple ayant perdu toute force de caractère – comme c’est toujours le cas de celui qui se soumet volontairement – que le vaincu ne trouve plus dans aucun des actes d’oppression, pris à part, une raison suffisante de reprendre les armes. Plus nombreuses sont les exactions ainsi acceptées passivement, et moins la résistance paraît justifiée aux yeux des autres hommes, quand le peuple vaincu finit par se révolter contre le dernier acte d’oppression d’une longue série, surtout quand ce peuple a déjà supporté patiemment et en silence tant de maux beaucoup plus pénibles.
La ruine de Carthage est un effrayant exemple de cette lente agonie d’un peuple consommée par sa propre faute.
Clausewitz, dans ses Trois actes de foi, a mis cette idée en évidence d’une façon incomparable, et il lui a donné sa forme définitive en disant « que la tache faite à l’honneur par une lâche soumission ne peut jamais plus s’effacer ; que cette goutte de poison, entrée dans le sang d’un peuple, se transmet à ses descendants pour paralyser et miner les forces des générations futures » ; que, par contre, « même la perte de la liberté à la suite d’un sanglant et glorieux combat garantit la résurrection du peuple un moment asservi, et qu’elle est le vivant noyau dont, un jour, un nouvel arbre poussera de solides racines ».
Naturellement, une nation qui a perdu tout sentiment de l’honneur et toute force de caractère ne se souciera pas de cette doctrine. Quiconque la prend à cœur ne tombera jamais très bas ; mais, si on l’oublie ou n’y veut plus penser, on perd toute force et tout courage. Aussi n’y a-t-il pas lieu de s’attendre à ce que les responsables d’une soumission pusillanime rentrent subitement en eux-mêmes et, se laissant guider par la raison et toute l’expérience humaine, modifient dès lors leur conduite. Ce sont ceux-là, tout au contraire, qui rejetteront bien loin une telle théorie et alors le peuple finira par s’habituer à son joug d’esclave, si les meilleurs éléments de la masse ne se font jour pour arracher le pouvoir des mains d’un gouvernement infâme et corrupteur. Dans le premier des cas, les gouvernants n’ont guère l’habitude de se sentir si mauvais que cela, parce que les vainqueurs sont souvent assez rusés pour leur confier la surveillance des esclaves ; et ces êtres sans caractère exercent la plupart du temps cet office aux dépens de leur propre peuple, avec une rigueur plus impitoyable que ne le ferait n’importe quelle brute étrangère placée par l’ennemi lui-même dans le pays vaincu.
Le cours qu’ont pris les événements depuis 1918 prouve que l’espoir d’obtenir, par une soumission volontaire, la grâce des vainqueurs a exercé en Allemagne la plus funeste influence sur les jugements politiques et sur l’attitude des masses. J’insiste sur l’importance de l’expression les masses, parce que je ne puis me convaincre que toute la conduite des chefs de notre peuple doive être attribuée à la même erreur funeste. Comme la direction de nos affaires a été prise par les Juifs depuis la fin de la guerre, et de la façon la plus ostensible, on ne peut vraiment pas admettre que notre malheur soit dû simplement à un défaut d’intelligence de notre situation ; on doit être convaincu, au contraire, que l’on mène sciemment notre peuple à sa perte. Considérée de ce point de vue, la conduite de notre politique étrangère n’est pas aussi insensée qu’elle le paraît ; elle est dictée par une logique subtile et d’une froideur glacée, mise au service du plan juif de conquête du monde et du combat livré pour réaliser cet idéal.
On comprend ainsi pourquoi, alors que, de 1806 à 1813, sept ans avaient suffi à la Prusse terrassée pour recouvrer sa force vitale et la résolution de se battre, le même laps de temps s’est écoulé de nos jours sans qu’on en tire profit, et a même affaibli encore notre État.
Le traité de Locarno a été signé sept ans après le mois de novembre 1918.
Le début de ce chapitre explique ce qui s’est passé : du moment qu’on avait signé le honteux armistice, on ne pouvait plus trouver l’énergie et le courage d’opposer subitement une résistance aux mesures que notre adversaire prit ensuite pour accentuer notre oppression. Il avait été trop avisé pour trop exiger d’un seul coup. Il limita ses exactions de telle sorte qu’elles fussent toujours à sa propre estime – et à celle du gouvernement allemand – assez tolérables pour qu’on n’eût pas à craindre une révolte du sentiment populaire. Plus nous souscrivions à ces décisions arbitraires qui achevaient de nous étrangler, et moins nous paraissions fondés à faire à l’improviste, en présence d’une nouvelle exaction ou d’une nouvelle humiliation, le geste à quoi tant d’autres n’avaient pu nous décider, c’est-à-dire résister. C’était là la « goutte de poison » dont parle Clausewitz : le manque de caractère qui s’est manifesté une fois s’aggravera fatalement toujours et pèsera peu à peu, comme un funeste héritage, sur toutes les décisions ultérieures. C’est un poids de plomb qu’à la longue un peuple n’est presque plus capable de secouer de ses épaules et qui finit par l’abaisser au niveau d’une race d’esclaves.
C’est ainsi qu’alternaient en Allemagne les édits qui achevaient de nous désarmer et de nous asservir, qui nous rendaient politiquement sans défense et nous exploitaient économiquement, jusqu’à créer cet état d’esprit qui nous fit considérer le plan Dawes comme un bonheur et le traité de Locarno comme un succès. On peut dire, il est vrai, qu’à un point de vue plus élevé nous eûmes, au milieu de ces afflictions, un bonheur : c’est qu’on peut bien égarer les hommes, mais le ciel ne se laisse pas suborner. Il nous refusa ses faveurs : la détresse et l’inquiétude n’ont cessé depuis d’accompagner notre peuple et la misère a été son unique et fidèle alliée. Le sort n’a pas, même en cette occurrence, fait d’exception en notre faveur ; il ne nous a donné que ce que nous méritions. Nous ne savons plus le prix à l’honneur, il nous fait apprécier la liberté de pouvoir gagner son pain. Les hommes ont déjà appris à réclamer leur pain ; un jour viendra où ils prieront le ciel de leur rendre la liberté.
Si pénible et manifeste que fût l’effondrement de notre peuple pendant les années qui ont suivi 1918, on n’en a pas moins persécuté résolument et avec la plus grande violence, à cette même époque, quiconque se permettait de prédire ce qui est arrivé par la suite. Le gouvernement que subissait notre peuple était aussi infatué que lamentablement incapable ; il l’était surtout quand il s’agissait pour lui de se débarrasser de conseillers que leurs avertissements lui rendaient odieux. Il pouvait arriver alors (et cela arrive du reste encore aujourd’hui) que les plus épais cerveaux du Parlement, de vulgaires selliers et gantiers – la profession elle-même n’ayant du reste aucune importance ici – se trouvaient subitement élevés au rang d’hommes d’État et, du haut de ce piédestal, faisaient la leçon aux humbles mortels. Il importait et il importe encore peu qu’un pareil « homme d’État » se révèle le plus souvent, après avoir exercé six mois ses talents, comme un charlatan sans cervelle, que le monde entier assaille de railleries et de sarcasmes, qui ne sait jamais ce qu’il doit faire et donne les preuves les plus évidentes de sa complète incapacité ! Non cela n’a aucune importance, au contraire : moins la politique pratiquée par les hommes d’État de la république parlementaire a des résultats effectifs, plus furieusement ils persécutent, en revanche, ceux qui attendent d’eux de tels résultats, qui ont l’audace d’établir que la politique suivie jusqu’à présent n’a connu que des échecs, et de prédire qu’il en sera de même à l’avenir. Si l’on arrive enfin à mettre au pied du mur un de ces honorables parlementaires, et si cet artiste en politique ne peut plus nier l’échec subi et la nullité des résultats obtenus, il trouve à cette faillite des milliers d’excuses, sans reconnaître, en aucune façon, qu’il est lui-même la cause de tout le mal.
* * *
Tout le monde aurait dû comprendre, au moins à partir de l’hiver de 1922-1923, que la France poursuivait, avec une inflexible logique, même après la conclusion de la paix, les objectifs qu’elle avait au début de la guerre. Car personne ne croira que la France, dans la lutte la plus décisive de son histoire, ait mis en jeu pendant quatre ans et demi le sang de son peuple dont elle n’était point riche, simplement pour recevoir des réparations, contrepartie des dommages subis. L’Alsace-Lorraine même ne suffirait pas à expliquer l’énergie avec laquelle la France conduisit la guerre, s’il ne s’était agi d’une partie d’un vaste programme d’avenir de la politique étrangère française : démembrer l’Allemagne en une macédoine de petits États. C’est pour atteindre ce but que la France chauvine a combattu, tout en faisant, il est vrai, de son peuple un mercenaire au service du Juif international.
Ce but de guerre français aurait été atteint par la guerre même, si, comme on l’espérait d’abord à Paris, la lutte avait eu le sol allemand pour théâtre. On se figurait que les sanglantes batailles de la guerre mondiale seraient livrées non pas sur la Somme, en Flandre, en Artois, ou devant Varsovie, Nijni- Novgorod, Kowno, Riga et partout ailleurs, mais en Allemagne, sur la Ruhr et sur le Rhin, sur l’Elbe, devant Hanovre, Leipzig, Nuremberg, etc. ; et l’on accordera que, dans ce cas, il eût été possible de démembrer l’Allemagne. Il est très douteux que notre jeune État fédératif ait pu supporter quatre ans et demi durant une telle épreuve d’endurance, aussi bien que le fit une France fortement centralisée depuis des siècles, et où tous les yeux étaient tournés vers Paris, centre incontesté. Tout le mérite que cette gigantesque lutte des peuples se soit déroulée hors des frontières de notre patrie revient à notre ancienne armée, et à elle seule ; mais c’est aussi là un grand bonheur pour l’avenir de l’Allemagne. J’ai la conviction inébranlable, et cela me serre souvent le cœur, que dans le cas contraire il n’y aurait plus aujourd’hui depuis longtemps de Reich allemand, mais seulement des « États allemands ». C’est aussi la seule raison qui permette de dire que le sang de nos amis et de nos frères, tombés sur le champ de bataille, n’a pas coulé complètement en vain.
Ainsi les choses prirent une tout autre tournure que celle escomptée par la France. L’Allemagne s’effondra bien en novembre 1918 avec la rapidité de l’éclair. Mais, lorsque la catastrophe frappa notre pays, les armées du généralissime occupaient encore une grande partie des pays ennemis. Le premier souci des Français ne fut pas alors de dissocier l’Allemagne, mais de faire sortir nos armées le plus vite possible de France et de Belgique. Le gouvernement de Paris, pour mettre fin à la guerre mondiale, dut d’abord désarmer les armées allemandes et les repousser, autant que faire se pouvait, en Allemagne ; c’est seulement après qu’on put s’occuper d’atteindre le but primitif, le but essentiel de la guerre. Mais, à cet égard, la France se trouvait déjà paralysée. Une fois l’Allemagne anéantie en tant que puissance coloniale et commerciale, et réduite au rang d’État de seconde classe, la guerre était véritablement finie et gagnée pour l’Angleterre. Non seulement elle n’avait aucun intérêt à ce que l’État allemand fût radicalement éliminé du concert européen, mais elle avait même beaucoup de raisons pour désirer que la France trouvât pour l’avenir un rival en Europe. Aussi la politique française fut-elle contrainte de ne plus poursuivre que par une action pacifique résolue ce que la guerre avait commencé, et le mot de Clemenceau disant que, pour lui, la paix n’était que la continuation de la guerre, en vit sa portée accrue.
Constamment, chaque fois que l’occasion s’en présenta, on s’efforça de disloquer l’armature du Reich. À Paris, on comptait avoir raison de sa cohésion en formulant toujours de nouvelles exigences dans les notes réclamant le désarmement de l’Allemagne, et par les spoliations économiques que ce désarmement rendait possibles. Plus les Allemands perdaient le sentiment de l’honneur national, et plus l’oppression économique et la détresse continuelle produisaient en politique des effets meurtriers. Dix ou vingt ans d’un tel système d’asservissement politique et d’exploitation économique ne peuvent manquer de ruiner à la longue l’État le plus solidement organisé et, si les circonstances s’y prêtent, ils peuvent amener sa complète dissolution. Et le but de guerre de la France eût été alors définitivement atteint.
Quand arriva l’hiver 1922-1923, on devait s’être rendu compte depuis longtemps des intentions de la France. Il n’y avait donc que deux alternatives : ou bien la volonté française s’émousserait peu à peu contre la force de résistance du peuple allemand, ou bien l’Allemagne finirait par faire ce qui arrivera inévitablement un jour : un acte d’oppression particulièrement brutal l’amènerait à donner un violent coup de barre et à faire tête. Il est vrai qu’une telle décision impliquait un combat où son existence même serait en jeu ; et elle ne pouvait espérer en sortir vivante que si elle parvenait auparavant à isoler si bien la France que cette seconde guerre ne fût plus une lutte de l’Allemagne contre le monde entier, mais une guerre défensive, menée contre une France qui ne cessait de troubler la paix mondiale.
J’insiste sur ce point et j’ai la conviction profonde que cette seconde partie de l’alternative doit se réaliser et se réalisera un jour. Je ne croirai jamais à une modification des projets que la France nourrit à notre égard ; car ils ne sont, au fond, que l’expression de l’instinct de conservation de la nation française. Si j’étais Français et si, par conséquent, la grandeur de la France m’était aussi chère que m’est sacrée celle de l’Allemagne, je ne pourrais et ne voudrais agir autrement que ne le fait, en fin de compte, un Clemenceau. La nation française, qui meurt lentement, non pas tant par la dépopulation que par la disparition progressive des meilleurs éléments de la race, ne peut continuer à jouer un rôle important dans le monde qu’en démolissant l’Allemagne. Quelques détours que prenne la politique française, elle finit toujours par tendre à ce dernier but qui satisferait ses désirs les plus profonds et les plus ardents. Mais il est faux de croire qu’une volonté purement passive de se maintenir pourra, à la longue, opposer une résistance victorieuse à une autre volonté, non moins résolue et passant activement à l’attaque. Tant que l’éternel conflit mettant aux prises l’Allemagne et la France consistera dans une défensive allemande contre l’agression française, il n’interviendra jamais de décision, mais l’Allemagne perdra de siècle en siècle de nouvelles positions. On n’a qu’à étudier les fluctuations de la frontière linguistique allemande depuis le douzième siècle jusqu’à nos jours, et l’on pourra difficilement compter ensuite sur l’heureuse issue d’un processus qui nous a été jusqu’à présent aussi funeste.
C’est seulement lorsque ceci sera bien compris en Allemagne, quand on ne laissera plus la volonté de vivre de la nation s’égarer dans une défense purement passive, mais qu’on rassemblera toute notre énergie pour une explication définitive avec la France, et pour cette lutte décisive, qu’on jettera dans la balance les objectifs essentiels de la nation allemande, c’est alors seulement qu’on pourra mettre un terme à la lutte interminable et essentiellement stérile qui nous oppose à la France ; mais à condition que l’Allemagne ne voie dans l’anéantissement de la France qu’un moyen de donner enfin à notre peuple, sur un autre théâtre, toute l’extension dont il est capable. Nous comptons aujourd’hui quatre-vingt millions d’Allemands en Europe ! On ne pourra considérer notre politique étrangère comme bien conduite que si, en moins de cent ans, deux cent cinquante millions d’Allemands peuvent vivre sur ce continent, non pas entassés comme les serfs qui travaillent dans les fabriques du Nouveau-Monde, mais en paysans et ouvriers qui assurent réciproquement leur existence par leur labeur.
En décembre 1922, la tension des rapports entre l’Allemagne et la France parut atteindre un degré menaçant. La France méditait de nouvelles et monstrueuses mesures d’extorsion, et elle avait besoin de gages lui garantissant le succès. L’exploitation économique devait être précédée d’une pression politique et un coup violent porté sur un des centres nerveux de tout l’organisme allemand pouvait seul, à l’avis des Français, imposer à notre peuple « rétif » un joug plus lourd. En occupant le bassin de la Ruhr, la France espérait non seulement parvenir enfin à nous briser moralement les reins, mais encore nous réduire à un tel asservissement économique que nous serions obligés de souscrire, bon gré mal gré, à toutes les obligations et jusqu’aux plus lourdes.
Il s’agissait de plier ou de rompre. L’Allemagne commença tout de suite par plier et finit par se trouver complètement rompue.
Par l’occupation de la Ruhr, le destin tendait encore une fois la main au peuple allemand pour l’aider à se relever. Car, ce qui, au premier aspect, semblait être un malheur accablant, contenait, à y regarder de plus près, un moyen de mettre un terme aux souffrances de l’Allemagne. Au point de vue politique, en occupant la Ruhr, pour la première fois la France s’aliénait réellement et profondément l’Angleterre ; et il ne s’agissait pas seulement des milieux diplomatiques anglais – qui n’avaient conclu, apprécié et maintenu l’alliance avec la France que du point de vue pratique de froids calculateurs – mais aussi des couches les plus profondes du peuple anglais. Ce nouvel incroyable renforcement de la puissance française sur le continent provoquait, en particulier dans les milieux économiques d’outre-Manche, un malaise mal dissimulé. Car, la France occupait maintenant en Europe, en tant que puissance militaire et politique, une situation que l’Allemagne elle-même n’avait jamais connue auparavant, et en outre elle acquérait des ressources économiques lui assurant une position privilégiée unique pour concurrencer politiquement l’Angleterre. Les plus importantes mines de fer et de charbon de l’Europe se trouvaient réunies dans les mains d’une nation qui, à la différence de l’Allemagne, avait jusqu’alors défendu ses intérêts vitaux avec autant de décision que d’activité, et qui venait de rappeler au monde entier dans la Grande guerre la confiance qu’elle pouvait avoir dans ses armes. En occupant la Ruhr, la France enlevait aux mains de l’Angleterre tout le profit de la guerre et la victoire ne revenait plus à l’active et souple diplomatie britannique, mais au maréchal Foch et à la France qu’il représentait.
En Italie également, les sentiments qu’inspirait la France et qui, depuis la fin de la guerre, étaient déjà rien moins qu’affectueux, prirent le caractère d’une haine formelle. C’était le grand moment historique où les alliés d’hier pouvaient devenir les ennemis de demain. S’il en fut autrement et si les alliés n’en vinrent pas subitement aux mains, comme il était arrivé pendant la seconde guerre balkanique, ce fut simplement parce que l’Allemagne n’avait pas d’Enver Pacha, mais un chancelier du Reich qui s’appelait Cuno.
Cependant, l’invasion de la Ruhr par les Français n’ouvrait pas seulement à l’Allemagne de grandes perspectives d’avenir en politique étrangère, mais aussi en politique intérieure. Un grand nombre de nos concitoyens auxquels la France avait persuadé, grâce à l’influence mensongère continuelle de sa presse, qu’elle était le champion du progrès et du libéralisme, furent d’un seul coup guéris de cette illusion. L’année 1914 avait dissipé les rêves de solidarité internationale des peuples, qui hantaient le cerveau de nos ouvriers allemands et les avait ramenés dans un monde où règne la lutte incessante et où l’existence du plus fort nécessite la mort du plus faible ; le printemps 1923 joua le même rôle.
Lorsque le Français mit ses menaces à exécution et finit par avancer, d’abord avec beaucoup de prudence et de timidité, dans la région minière de la Basse- Allemagne, l’heure qui venait de sonner à l’horloge du destin était décisive pour l’Allemagne. Si, à ce moment, notre peuple avait adopté une attitude autre que celle qu’il avait observée jusqu’alors, la région allemande de la Ruhr aurait pu devenir pour la France ce que Moscou avait été pour Napoléon. On ne pouvait agir que de deux façons ; ou bien on supportait encore sans mot dire cette humiliation et l’on restait les bras croisés, ou bien l’on éveillait chez le peuple allemand, en attirant ses regards sur cette contrée où rougeoient des forges et fument les hauts fourneaux, l’ardente volonté de mettre un terme à ces affronts incessants, et de s’exposer à toutes les épouvantes de l’heure plutôt que de continuer à subir une éternelle terreur.
La gloire immortelle de Cuno, alors chancelier du Reich, fut de découvrir une troisième issue et nos partis bourgeois allemands se sont acquis de nouveaux titres de célébrité, en admirant et en suivant le chancelier.
Je voudrais maintenant examiner, aussi brièvement que possible, le second des partis qui s’offraient à nous :
En occupant la Ruhr, la France avait, de la façon la plus éclatante, violé le traité de Versailles. Elle s’était ainsi aliéné toute une série de puissances garantes du traité, notamment l’Angleterre et l’Italie. La France ne pouvait plus espérer que ces États lui donneraient un appui quelconque pour exécuter son raid de pillage, qui ne servait que ses propres intérêts et son égoïsme. Il ne lui fallait donc compter que sur ses seules forces pour mener à bien cette aventure, car ce ne fut d’abord pas autre chose. Un gouvernement allemand national ne pouvait prendre que le parti que prescrivait l’honneur. Il était sûr qu’on ne pouvait pas tout de suite opposer à la France une résistance armée ; mais il était aussi indispensable de se rendre compte que toute négociation, sans une force pour l’appuyer, serait ridicule et stérile. S’il était insensé, toute résistance effective étant impossible, de prendre position en déclarant : « Nous refusons de négocier », il était encore plus stupide d’engager finalement des négociations sans avoir entre temps créé cette force.
Ce n’est pas à dire qu’on eût pu empêcher l’occupation de la Ruhr par des mesures militaires. Il aurait fallu être fou pour prôner une pareille décision. Mais on pouvait et on devait mettre à profit et l’impression causée par l’entreprise de la France, et le temps qu’elle mettait à l’exécuter ; et, faisant bon marché du traité de Versailles que la France venait de déchirer, il fallait songer à s’assurer les ressources militaires sur lesquelles les négociateurs représentant l’Allemagne auraient pu ensuite s’appuyer. On devait se rendre compte également que les meilleurs négociateurs ne peuvent guère remporter de succès, lorsque le sol sur lequel ils se tiennent et la chaise sur laquelle ils sont assis ne sont pas sous la protection de leur peuple. Un pauvre petit avorton de tailleur ne peut pas lutter contre des athlètes, et un négociateur sans défense n’a qu’à se résigner quand Brennus jette son glaive dans un des plateaux de la balance, s’il ne peut pas jeter le sien dans l’autre plateau pour rétablir l’équilibre. N’était-il pas désespérant d’assister aux comédies de négociations qui précédaient régulièrement, depuis 1918, les décisions unilatérales et arbitraires de l’ennemi ? C’est pourtant ce spectacle humiliant pour nous que l’on donnait au monde entier en nous invitant d’abord comme par dérision à une table de conférences, pour nous présenter des décisions et des programmes arrêtés depuis longtemps, et sur lesquels nous pouvions bien discourir,
mais que nous devions a priori considérer comme immuables. À vrai dire, nos négociateurs n’ont que très rarement dépassé la moyenne la plus modeste, et la plupart d’entre eux ne justifiaient que trop l’insolent propos de Lloyd George qui, en présence de l’ancien chancelier du Reich Simon, remarquait d’un ton sarcastique « que les Allemands ne savaient pas se donner pour chefs ou représentants des hommes intelligents ». Au reste, même des hommes de génie n’auraient pu obtenir que de maigres résultats, en raison de la volonté d’un ennemi décidé à user de sa force, et de l’impuissance lamentable où se trouvait le peuple sans défense qu’ils auraient représenté.
Cependant, celui qui aurait voulu, au printemps de 1923, profiter de l’occupation de la Ruhr par la France pour reconstituer nos forces armées, aurait dû d’abord rendre à la nation les armes morales, développer sa force de volonté, et anéantir ceux qui avaient détruit en lui cet élément primordial de la puissance d’une nation.
En 1918, nous avions payé de notre sang la faute, commise en 1914 et 1915, quand on avait négligé d’écraser, une fois pour toutes, la tête du serpent marxiste ; nous devions être cruellement punis de la faute commise au printemps de 1923, quand on ne saisit pas l’occasion qui s’offrait de mettre définitivement hors d’état de nuire les marxistes traîtres à leur pays et assassins de leur peuple.
Toute idée d’opposer une résistance effective à l’agression française était une pure folie, si l’on ne déclarait pas la guerre aux influences qui, cinq ans auparavant, avaient, de l’intérieur, brisé la résistance allemande sur les champs de bataille. Seuls, des esprits bourgeois pouvaient concevoir l’idée incroyable que le marxisme avait peut-être évolué et que les immondes créatures qu’étaient les chefs de 1918 – ceux qui à ce moment-là avaient froidement foulé aux pieds deux millions de morts pour se hisser plus commodément aux postes de gouvernement – se trouveraient subitement prêts à payer leur tribut à la conscience nationale. C’était une idée aussi inconcevable que vraiment absurde d’espérer que ceux qui avaient autrefois trahi leur patrie deviendraient en un tournemain les champions de la liberté allemande. Ils étaient bien loin d’y penser ! Pas plus qu’une hyène ne lâche une charogne, un marxiste ne renonce à trahir sa patrie. Qu’on veuille bien ne pas me faire la plus sotte des objections, à savoir que de nombreux ouvriers ont aussi autrefois versé leur sang pour l’Allemagne. Des ouvriers allemands, d’accord, mais c’est qu’alors ils n’étaient plus des internationalistes marxistes. Si la classe ouvrière allemande n’avait été composée, en 1914, que de partisans des doctrines marxistes, la guerre aurait été finie en trois semaines. L’Allemagne se serait effondrée avant même que le premier soldat eût franchi la frontière. Non, pour qu’alors le peuple allemand ait continué à combattre, il fallait que la folie marxiste ne l’eût pas corrodé à cœur. Mais qu’un ouvrier allemand et un soldat allemand fussent, au cours de la guerre, repris en main par les chefs marxistes, cet ouvrier et ce soldat étaient perdus pour la patrie. Si l’on avait, au début et au cours de la guerre, tenu une seule fois douze ou quinze mille de ces Hébreux corrupteurs du peuple sous les gaz empoisonnés que des centaines de milliers de nos meilleurs travailleurs allemands de toute origine et de toutes professions ont dû endurer sur le front, le sacrifice de millions d’hommes n’eût pas été vain. Au contraire, si l’on s’était débarrassé à temps de ces quelques douze mille coquins, on aurait peut-être sauvé l’existence d’un million de bons et braves Allemands pleins d’avenir. Mais la « science politique » de la bourgeoisie consistait justement à envoyer, sans sourciller, des millions d’hommes se faire tuer sur le champ de bataille, tandis qu’elle proclamait hautement que dix ou douze mille traîtres à leur peuple – mercantis, usuriers et escrocs – étaient le trésor le plus précieux et le plus sacré de la nation et que l’on ne devait pas y toucher. On ne sait vraiment pas ce qui l’emporte dans ce monde bourgeois, du crétinisme, de la faiblesse et de la lâcheté ou bien d’un moral complètement délabré. Il représente une classe condamnée à disparaître et qui, malheureusement, entraîne avec elle tout un peuple à l’abîme.
Or, en 1923, on se trouvait devant la même situation qu’en 1918. Quelque mode de résistance qu’on dût adopter, la première mesure à prendre était de débarrasser notre peuple du venin marxiste. Je suis convaincu que le premier devoir d’un gouvernement vraiment national était alors de chercher et de trouver les hommes résolus à déclarer au marxisme une guerre d’extermination, et de leur laisser ensuite le champ libre ; il ne devait pas être le servile adorateur de la formule inepte ; « La paix sociale et le bon ordre », alors que l’ennemi extérieur portait à la patrie le coup fatal, et qu’à l’intérieur la trahison était aux aguets à tous les coins de rue. Non ! un gouvernement vraiment national devait voir d’un bon œil, à ce moment-là, se manifester troubles et désordre, pourvu que cette agitation permît effectivement un règlement de compte complet avec les marxistes, ennemis mortels de notre peuple. Si l’on négligeait cette précaution, c’était pure folie que de penser à résister, de quelque façon que ce fût.
Pour un règlement de compte d’une telle portée historique, on ne pouvait pas se contenter de suivre le plan tracé par quelque conseiller intime, quelque vieux ministre à l’âme desséchée ; il fallait obéir aux lois éternelles de la vie sur terre, qui font de l’existence un combat, un incessant combat. Il ne fallait pas perdre de vue que souvent les guerres civiles les plus sanglantes ont donné naissance à un corps de peuple trempé comme l’acier et foncièrement sain, tandis que plus d’une fois une décomposition, dont la puanteur s’élevait jusqu’au ciel, a été le fruit d’un état de paix artificiellement entretenu. On devait donc, en 1923, saisir d’une poigne brutale les vipères qui rongeaient le corps de notre peuple. Que l’opération réussît, alors la préparation d’une résistance active aurait eu un sens !
Combien de fois me suis-je alors enroué à essayer de faire comprendre clairement, tout au moins aux milieux soi-disant nationaux, quel était cette fois l’enjeu de la partie et notamment que, si l’on commettait les mêmes fautes qu’en 1914 et pendant les années suivantes, l’issue serait fatalement la même qu’en 1918. Je demandais, sans me lasser, qu’on laisse le destin suivre librement son cours, et qu’on donne à notre mouvement la possibilité de s’expliquer avec le marxisme ; mais je prêchais des sourds. Tous, y compris le chef de la force armée, prétendaient savoir mieux que moi ce qu’ils avaient à faire, jusqu’au jour où ils se trouvèrent acculés à la plus lamentable capitulation qu’ait connue l’histoire.
J’acquis alors la conviction profonde que la bourgeoisie allemande est arrivée au terme de sa mission et qu’elle n’est plus appelée à rendre aucun service. Je vis que tous ces partis bourgeois ne se querellent plus avec le marxisme qu’en raison de la jalousie que leur inspire sa concurrence et qu’ils ne veulent pas sérieusement l’anéantir ; ils se sont tous depuis longtemps résignés à voir leur patrie détruite et n’ont plus qu’un seul souci : prendre part eux-mêmes au festin des funérailles. C’est seulement pour cela qu’ils « combattent » encore.
À cette époque – je l’avoue franchement – je fus saisi de la plus profonde admiration pour le grand homme qui, au sud des Alpes, inspiré par l’ardent amour de son peuple, loin de pactiser avec les ennemis intérieurs de l’Italie, s’efforçait de les anéantir par tous les moyens. Ce qui placera Mussolini au rang des grands hommes d’ici-bas, c’est sa résolution de ne pas partager l’Italie avec le marxisme, mais au contraire, le vouant à la destruction, de préserver sa patrie de l’internationalisme.
Comme nos hommes d’État de pacotille font, en comparaison, figure de pitoyables nains, et quel dégoût vous saisit à la gorge quand ces zéros se permettent l’inconvenance de critiquer un homme qui leur est mille fois supérieur ! Et comme il est plaisant de penser qu’on entend de tels propos dans un pays qui, il y a à peine un demi-siècle, avait un Bismarck comme chef !
La position ainsi prise par la bourgeoisie en 1923, et ses ménagements pour le marxisme, avaient fixé d’avance le sort qui attendait toute résistance active dans la Ruhr. Vouloir combattre la France, quand un ennemi mortel se trouvait dans nos propres rangs, c’était une évidente stupidité. Tout ce qu’on ajouta n’était qu’un simulacre de combat, une mise en scène, pour donner quelque satisfaction aux éléments nationaux de l’Allemagne, pour calmer « les bouillonnements de l’âme populaire », en fait, pour la duper. Eût-on agi avec conviction, on aurait dû reconnaître que la force d’un peuple ne réside pas en premier lieu dans ses armes, mais dans sa puissance de volonté, et qu’avant de vaincre les ennemis du dehors, il faut avoir exterminé l’ennemi du dedans ; sinon, malheur au peuple dont la victoire ne récompense pas, dès le premier jour, les efforts. Il suffit que l’ombre d’une défaite passe sur le peuple qui a gardé dans son sein des éléments ennemis, pour que sa force de résistance se trouve brisée, et que l’adversaire du dehors l’emporte définitivement.
C’est ce qu’on pouvait prédire dès le printemps de 1923. Qu’on ne vienne surtout pas parler de l’improbabilité d’un succès militaire contre la France.
Car même si la réaction provoquée par l’entrée des Français dans la Ruhr n’avait eu pour effet que l’anéantissement du marxisme en Allemagne, le succès aurait été pour nous. Une Allemagne, délivrée de ces ennemis mortels de sa vie et de son avenir, posséderait des forces dont personne au monde ne serait plus capable de triompher. Le jour où le marxisme sera brisé en Allemagne, elle verra aussi en vérité ses chaînes brisées pour toujours. Car jamais, au cours de notre histoire, nous n’avons été vaincus par la force de nos adversaires ; nous l’avons toujours été par nos propres défauts et par les ennemis que nous avions dans notre camp.
Comme le gouvernement allemand n’était pas capable, à cette époque, d’un acte aussi héroïque, il aurait dû avoir la sagesse d’opter pour le premier terme de l’alternative (indiquée plus haut), c’est-à-dire de ne rien faire pour le moment, de laisser les choses suivre leur cours.
Mais, à cette heure grave de notre histoire, le ciel gratifia le peuple allemand d’un grand homme, M. Cuno. Ce n’était pas, à proprement parler, un homme d’État ou un politicien de profession et, naturellement, encore moins un homme d’État né ; il jouait le rôle d’une sorte de manœuvre que l’on employait simplement pour effectuer des tâches déterminées ; à part cela, il avait surtout l’expérience des affaires. Et ce fut une malédiction pour l’Allemagne, car ce commerçant qui se mêlait de politique y vit une entreprise commerciale et agit en conséquence.
« La France occupe le bassin de la Ruhr ; qu’y a-t-il dans le bassin de la Ruhr ? Du charbon. Ainsi la France occupe le bassin de la Ruhr pour son charbon. » Et tout naturellement, M. Cuno eut l’idée de décréter la grève pour que les Français n’aient pas le charbon, ce qui, dans l’opinion de M. Cuno, les amènerait certainement un jour à évacuer le bassin de la Ruhr, puisque l’opération ne leur rapporterait pas de bénéfices. Tel fut en gros le raisonnement que tint cet « homme d’État important » et « d’esprit national », auquel on fit prononcer à Stuttgart et ailleurs des discours dans lesquels il s’adressait « à son peuple », tandis que son peuple le regardait avec une admiration béate.
Mais, pour déclencher la grève, on avait naturellement besoin des marxistes, puisque c’étaient surtout les ouvriers qui devaient faire grève. Il était donc nécessaire de faire entrer également les ouvriers dans le front unique formé par tous les autres Allemands (pour un homme d’État de la bourgeoisie, ouvrier et marxiste sont des termes équivalents). Il faut avoir vu briller alors les yeux des représentants de ces partis politiques, sortis de la moisissure bourgeoise, quand ils entendirent donner ce mot d’ordre de génie ! C’était à la fois national et génial. Enfin ! ils avaient trouvé ce qu’ils cherchaient in petto depuis si longtemps ! M. Cuno avait jeté un pont sur le fossé qui nous séparait du marxisme, et le charlatan national put alors, en se donnant pour un enfant de « la vieille Allemagne », et en prononçant de grandes phrases patriotiques, tendre sa main loyale aux internationalistes, traîtres à leur pays. Et ceux-ci s’empressèrent de toper là. Car, si Cuno avait besoin des chefs marxistes pour constituer son « front unique », ceux-ci avaient besoin de l’argent de Cuno. Les deux parties trouvaient donc leur avantage à cette alliance. Cuno eut son front unique formé de bavards nationaux et d’escrocs antinationaux, et les imposteurs internationaux purent, subventionnés par l’État, se consacrer à leur noble mission, c’est-à-dire désorganiser l’économie nationale, et, cette fois, aux frais de l’État. C’était une idée digne de l’immortalité que de sauver une nation en subventionnant une grève générale ; c’était, en tous cas, un de ces mots d’ordre auxquels le vaurien le plus indifférent répond avec le plus grand enthousiasme !
On sait bien, en général, qu’on ne rend pas un peuple libre uniquement par des prières. Mais qu’il fût également impossible de le rendre libre en l’encourageant à la paresse, c’est ce qu’une expérience historique devait encore prouver. Si, à ce moment, M. Cuno, au lieu de provoquer une grève générale subventionnée, et de fonder sur cette grève le « front unique », avait seulement exigé de tout Allemand deux heures de travail supplémentaire, la fumisterie de ce « front unique » aurait pris fin d’elle-même dès le troisième jour. On ne délivre pas les peuples par la fainéantise, mais par le sacrifice.
D’ailleurs, cette prétendue résistance passive ne dura pas longtemps. Il fallait n’avoir aucune idée de la guerre pour se figurer qu’avec des moyens aussi ridicules, on pourrait intimider et faire reculer des armées d’occupation. Il aurait fallu, pour obtenir ce résultat, engager une action dont les frais se seraient élevés à des milliards, et qui aurait ébranlé jusque dans ses fondements la monnaie nationale.
Naturellement, les Français purent s’installer comme chez eux dans le bassin de la Ruhr, dès qu’ils virent de quels moyens on se servait pour organiser la résistance. Ils avaient appris à notre école quels étaient les procédés les plus efficaces pour mettre à la raison une population civile récalcitrante, quand son attitude constitue un danger sérieux pour les autorités procédant à l’occupation. N’avions-nous pas, neuf ans auparavant, dissipé en un tournemain les bandes de francs-tireurs belges, et fait clairement comprendre à la population civile le sérieux de la situation, lorsque leur activité avait fait courir aux armées allemandes des dangers réels. Si la résistance passive dans la Ruhr avait véritablement présenté quelque danger pour les Français, en moins de huit jours, et avec une facilité dérisoire, les troupes d’occupation auraient mis fin d’une façon sanglante à ces troubles puérils. Car il faut toujours en revenir là : que fera-t-on si la résistance passive finit par donner vraiment sur les nerfs de l’adversaire et s’il entreprend alors de la combattre par la force et en versant le sang ? Est-on décidé à poursuivre, en ce cas, la résistance ? Si oui, on doit s’attendre à supporter, bon gré mal gré, les persécutions les plus pénibles et les plus sanglantes. Mais alors on en est au même point qu’au cas d’une résistance active : il faut combattre. Par suite, la résistance dite passive n’a de sens qu’avec la résolution latente de la continuer, en cas de besoin, par une lutte à ciel ouvert ou par une guerre de guérillas. D’une façon générale, une pareille lutte appelle la conviction que le succès est possible. Sitôt qu’une place forte, assiégée et pressée par l’ennemi, doit renoncer à tout espoir d’être dégagée, elle se rend d’elle-même, surtout lorsque les défenseurs sont séduits par la perspective d’avoir la vie sauve au lieu de la mort quasi certaine. Qu’on enlève à la garnison d’une forteresse complètement encerclée la confiance qu’elle nourrit d’être délivrée, et, du coup, toutes ses capacités de résistance s’évanouiront.
C’est pourquoi une résistance passive dans la Ruhr, quand on considérait les dernières conséquences qu’elle pouvait et devait comporter pour aboutir vraiment, n’avait de sens que si l’on organisait derrière elle une défense active. Et on aurait alors pu tirer de notre peuple des ressources infinies. Si chacun des habitants de la Westphalie avait su que l’Allemagne non-occupée avait mis sur pied une armée forte de quatre-vingts ou cent divisions, les Français se seraient trouvés sur des épines. Les hommes courageux sont plus enclins au sacrifice avec la perspective du succès que lorsque l’entreprise est manifestement inutile.
Ce furent ces considérations qui nous conduisirent, nous autres nationaux-socialistes, à prendre résolument position contre un mot d’ordre qui se prétendait patriotique. Et c’est ce que nous fîmes. Pendant les mois qui suivirent, les attaques ne me manquèrent pas de la part d’hommes dont tout le patriotisme n’était que sottise et de fausses apparences, et qui hurlaient avec les loups, parce que leur vanité était agréablement chatouillée de pouvoir tout à coup jouer sans danger les patriotes. J’ai tenu ce pitoyable front unique pour la plus grotesque des manifestations et les événements m’ont donné raison.
Dès que les syndicats eurent à peu près empli leurs caisses avec les subsides versés par Cuno et que la résistance passive en arriva au moment où il fallait passer d’une défensive de paresse à une véritable offensive, les hyènes rouges quittèrent brusquement le troupeau des brebis patriotes et redevinrent ce qu’elles avaient toujours été. M. Cuno retourna à ses vaisseaux sans tambour ni trompette ; l’Allemagne s’était enrichie d’une nouvelle expérience et appauvrie d’une grande espérance.
Jusqu’à la fin de l’été, beaucoup d’officiers, et ce n’étaient sûrement pas les moins bons, n’avaient pu croire que les événements prendraient un tour aussi humiliant. Ils avaient tous espéré qu’on prendrait, sinon ouvertement, du moins en secret, les mesures nécessaires pour que l’insolente incursion des troupes françaises marque un tournant dans l’histoire de l’Allemagne. Nous comptions aussi dans nos rangs beaucoup d’Allemands qui faisaient au moins confiance à l’armée du Reich. Et cette conviction était si profonde qu’elle eut une influence déterminante sur les actes et particulièrement sur l’éducation qu’on donna à d’innombrables jeunes gens.
Mais lorsque le front unique s’effondra honteusement, quand, après avoir sacrifié des milliards en argent, et tant de milliers de jeunes Allemands – qui avaient eu la simplicité de prendre au sérieux les promesses des chefs du Reich – on signa une capitulation honteuse et écrasante, alors l’indignation provoquée par cette trahison de notre pauvre peuple jaillit comme une flamme. Dans des millions de cerveaux se forma subitement la conviction nette et claire que, seule, une transformation radicale, faisant table nette du système politique actuel, pourrait sauver l’Allemagne.
Jamais le moment n’avait été plus propice pour une telle solution, jamais même il ne l’avait plus impérieusement réclamée qu’à cette heure : d’une part, la trahison commise aux dépens de la patrie se montrait à nu avec une franchise éhontée ; de l’autre, les conditions économiques imposées à un peuple le condamnaient à mourir lentement de faim. Puisque l’État foulait lui-même aux pieds tous les préceptes de loyauté et de foi, puisqu’il tournait en dérision les droits des citoyens, escroquait à des millions de ses meilleurs enfants le prix de leurs sacrifices et volait à des millions d’autres leur dernier sou, il n’avait plus le droit d’attendre de ses sujets autre chose que de la haine. Et cette haine envers les mauvais génies du peuple et de la patrie, voulait, de quelque façon que ce fût, trouver un exutoire. J’ai le droit de rappeler ici la conclusion de la dernière déclaration que je fis pendant le grand procès du printemps de 1924 :
« Les juges de cet État peuvent en toute tranquillité nous condamner pour ce que nous avons fait ; l’Histoire, cette déesse qui personnifie une vérité supérieure et un droit plus haut, n’en déchirera pas moins un jour leur sentence en souriant, et nous absoudra tous des fautes qu’on prétend nous faire expier. »
Mais elle citera aussi devant son tribunal ceux qui, possédant aujourd’hui le pouvoir, foulent aux pieds le droit et la loi, condamnent notre peuple à une fin misérable et qui, au milieu des malheurs de la patrie, ont mis leurs intérêts égoïstes au-dessus de l’existence de la communauté.
Je ne vais pas ici décrire les événements qui précédèrent et déterminèrent le 8 novembre 1923. Je ne le ferai pas, parce que je ne m’en promettrais rien d’utile pour l’avenir et surtout parce qu’il n’y aurait aucun intérêt à rouvrir des blessures qui semblent aujourd’hui à peine cicatrisées ; il est, en outre, inutile d’accuser des hommes qui ont peut-être au fond de leur cœur autant d’amour pour leur peuple que j’en ai moi- même, et dont la faute a été de ne pas suivre la même voie que moi ou de ne pas savoir la suivre.
En présence des grands malheurs qui frappent notre patrie et que nous supportons tous en commun, je ne voudrais pas non plus blesser aujourd’hui et diviser ceux qui auront un jour à former le grand front unique des Allemands foncièrement fidèles à leur pays, contre le front commun des ennemis de notre peuple. Car je sais que le temps viendra où même ceux qui, autrefois, nous étaient hostiles se souviendront avec respect des hommes qui, par amour pour leur peuple allemand, se sont engagés sur la route amère qui conduit à la mort.Les dix-huit héros, auxquels j’ai dédié le premier volume de cet ouvrage, je veux, en terminant le second, les donner en exemple aux partisans et aux champions de notre doctrine, comme des héros qui, en pleine conscience, se sont sacrifiés pour nous tous. Il faut qu’ils ne cessent de rappeler aux faibles et à ceux dont le courage chancelle qu’ils doivent remplir leur devoir, ce devoir dont ils se sont acquittés eux-mêmes avec une foi entière et jusque dans ses dernières conséquences. Et je veux ranger parmi eux, comme un des meilleurs, l’homme qui a consacré sa vie à réveiller son peuple, notre peuple, par la poésie et par la pensée, et finalement par l’action : Dietrich Eckart.
Conclusion
Le 9 novembre 1923, dans sa quatrième année d’existence, le Parti ouvrier allemand national-socialiste fut dissous et frappé d’interdit dans tout le pays. Aujourd’hui, en novembre 1926, nous le retrouvons jouissant d’une pleine liberté dans le Reich entier, plus puissant et plus solidement organisé que jamais.
Toutes les persécutions du parti et de ses chefs, toutes les imputations calomnieuses dont il fut l’objet n’ont rien pu contre lui. Grâce à la justesse de ses idées, à la pureté de ses intentions, à l’esprit de sacrifice de ses partisans, il est sorti plus fort que jamais de toutes les épreuves.
Si, au milieu de la corruption du parlementarisme actuel, ce parti se rend de mieux en mieux compte des raisons profondes du combat qu’il mène, s’il sent qu’il constitue la pure personnification de la valeur de la race et de l’individu, et s’organise en conséquence, il doit, avec une rigueur quasi mathématique, remporter un jour la victoire. De même, l’Allemagne doit nécessairement recouvrer la situation qui lui revient sur cette terre, si elle est gouvernée et organisée d’après les mêmes principes.
Un État qui, à une époque de contamination des races, veille jalousement à la conservation des meilleurs éléments de la sienne, doit devenir un jour le maître de la terre.
Que nos partisans ne l’oublient jamais, si, en un jour d’inquiétude, ils en viennent à mettre en regard les chances de succès et la grandeur des sacrifices que le parti exige d’eux.
Fin du deuxième et dernier tome